— Par Selim Lander —
Après un prologue qui faisait appel à quatre élèves d’une école de danse – si nous avons bien compris – et sur lequel il vaut mieux jeter un voile pudique, les danseurs de Difé Kako sont entrés en scène, sept vrais danseurs, plus cinq musiciens-animateurs capables également de bouger avec les danseurs tout de blanc vêtus, pour une pièce intitulée Cercle égal – demi-cercle – au carré, laquelle comme le nom l’indique, fera appel aux danses traditionnelles antillaises issues du quadrille métropolitain, soit notre haute taille martiniquaise (autrement appelée boulangère en Guyane et, plus simplement, quadrille en Guadeloupe). Il s’agit pourtant bien dans cette pièce de danse contemporaine, même si elle est inspirée, innervée, instillée par des réminiscences du quadrille à l’Antillaise. La troupe, guadeloupéenne, mêle des danseurs noirs et blancs, une configuration dont les compagnies martiniquaises devrait s’inspirer, tant le mélange des cultures et des manières d’aborder l’art chorégraphique se révèle, ici, fécond.
On ne sait pas si la pièce dessine vraiment – comme indiqué dans la présentation écrite – « la possibilité d’un ‘Tout-monde’ fécond et jubilatoire ».



 Représentation scolaire le 21 février à 9h30
Représentation scolaire le 21 février à 9h30
 Comme une épiphanie « All that glitters is not gold » est la dernière phrase qui s’affiche en fond de scène à la fin de « Kalakuta Republik » la superbe chorégraphie de la Cie Serge Aimé Coulibaly. Sur le plateau un désordre de chaises renversées dans la dévastation figurée d’un naufrage pluridimensionnel. Il y a ce blanchiment de l’espace et des objets qui transpirent par ce fait leur origine, il y a ce chef de troupe, la moitié du visage couverte d’un masque de pierrot lunaire, seul, désespérément seul, il y a des corps désarticulés et épars se défaisant de leurs oripeaux, à jamais perdus comme une illustration à la Durkheim de l’anomie. Le chorégraphe et danseur le criait et le répétait lancinant il y a peu sur le plateau :« Nous avons peur, peur de nous battre pour la justice, pour la liberté, pour le bonheur ». Et pourtant tout avait commencé dans un ordonnancement régi par un maître de cérémonie reconnu et adulé, objet vingt ans après sa mort d’une vénération sans bornes.
Comme une épiphanie « All that glitters is not gold » est la dernière phrase qui s’affiche en fond de scène à la fin de « Kalakuta Republik » la superbe chorégraphie de la Cie Serge Aimé Coulibaly. Sur le plateau un désordre de chaises renversées dans la dévastation figurée d’un naufrage pluridimensionnel. Il y a ce blanchiment de l’espace et des objets qui transpirent par ce fait leur origine, il y a ce chef de troupe, la moitié du visage couverte d’un masque de pierrot lunaire, seul, désespérément seul, il y a des corps désarticulés et épars se défaisant de leurs oripeaux, à jamais perdus comme une illustration à la Durkheim de l’anomie. Le chorégraphe et danseur le criait et le répétait lancinant il y a peu sur le plateau :« Nous avons peur, peur de nous battre pour la justice, pour la liberté, pour le bonheur ». Et pourtant tout avait commencé dans un ordonnancement régi par un maître de cérémonie reconnu et adulé, objet vingt ans après sa mort d’une vénération sans bornes. Inspiré par Fela Kuti, l’inventeur nigérian de l’afrobeat, compositeur, saxophoniste, chef d’orchestre et homme politique contestataire, le chorégraphe originaire du Burkina Faso, crée un spectacle dans lequel la politique n’est pas seulement un accent dramaturgique vague. Sept danseurs sur scène, pour des variations infinies de figures et de mouvements comme des métaphores rageuses d’une urgence de vivre… Une réflexion politique qui passe par les corps. Un langage de mouvements marqué par le répertoire traditionnel, par les déhanchés de boîtes de nuit et par le jazz, mais surtout une toute nouvelle danse dont on ne connaît pas d’où elle vient.
Inspiré par Fela Kuti, l’inventeur nigérian de l’afrobeat, compositeur, saxophoniste, chef d’orchestre et homme politique contestataire, le chorégraphe originaire du Burkina Faso, crée un spectacle dans lequel la politique n’est pas seulement un accent dramaturgique vague. Sept danseurs sur scène, pour des variations infinies de figures et de mouvements comme des métaphores rageuses d’une urgence de vivre… Une réflexion politique qui passe par les corps. Un langage de mouvements marqué par le répertoire traditionnel, par les déhanchés de boîtes de nuit et par le jazz, mais surtout une toute nouvelle danse dont on ne connaît pas d’où elle vient. Disons tout de suite la réussite de cette pièce, résultat des efforts conjoints de Josiane Antourel et David Milôme à la chorégraphie, avec Chantal Thine et à nouveau David Milôme sur le plateau. Une seule réserve :
Disons tout de suite la réussite de cette pièce, résultat des efforts conjoints de Josiane Antourel et David Milôme à la chorégraphie, avec Chantal Thine et à nouveau David Milôme sur le plateau. Une seule réserve :  Création
Création

 Saison sèche
Saison sèche

 Salut mon frère & I’m a Bruja
Salut mon frère & I’m a Bruja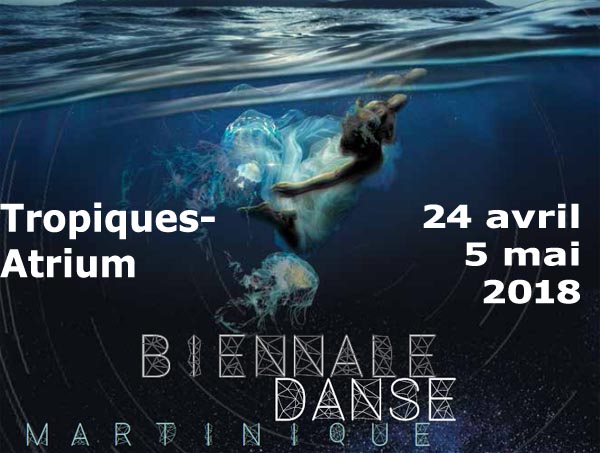

 Dans sa dernière création, « Questcequetudeviens? », […]] Aurélien Bory propose un spectacle inventif et brillant qui met en scène la solitude de I’être et la vanité de l’existence. De I’enfance aux années d’apprentissage à la vie active – « on commence a bosser » – à la maturité et à la mort, en 50 min défile le parcours d’une rose rouge comme le flamenco à la vie encore plus brève que celle de Ronsard.
Dans sa dernière création, « Questcequetudeviens? », […]] Aurélien Bory propose un spectacle inventif et brillant qui met en scène la solitude de I’être et la vanité de l’existence. De I’enfance aux années d’apprentissage à la vie active – « on commence a bosser » – à la maturité et à la mort, en 50 min défile le parcours d’une rose rouge comme le flamenco à la vie encore plus brève que celle de Ronsard. C’est, après ma déception de ne pas voir danser la AD Compagnie, qui dans Balansé II aurait su nous parler de culture universelle autant que de culture antillaise, c’est donc, après cette annulation inattendue, au chorégraphe Thomas Lebrun que revint le soin d’adoucir ma frustration.
C’est, après ma déception de ne pas voir danser la AD Compagnie, qui dans Balansé II aurait su nous parler de culture universelle autant que de culture antillaise, c’est donc, après cette annulation inattendue, au chorégraphe Thomas Lebrun que revint le soin d’adoucir ma frustration. Entropic now
Entropic now Elles seront quatre, ou deux, ou trois, parfois une seule sur le plateau, et paradoxalement c’est cette présence unique qui pour moi fera naître un lien avec la salle, parce que dans sa solitude soudaine la danseuse saura de son corps et de ses gestes exprimer ce qu’elle est, ou ce qu’elle n’est pas, ce qu’elle cherche et qu’elle voudrait saisir. Quatre jeunes femmes diverses, de couleurs, de costumes et de postures, mais toutes le visage tragique, comme muré dans son intérieur, le regard fixé là-bas sur l’horizon, et jamais ne se regardant vraiment. Quatre aux mouvements démultipliés, et qui cependant ne comblent pas le vide installé entre elles, quatre bonnes volontés qui ne font vibrer ni l’air autour d’elles ni mes émotions, ces dernières comme absorbées dans ce trou blanc d’une scène soudain devenue trop vaste. Ni les corps rapprochés pour soutenir celui qui tombe, ni la chute commune plusieurs fois jouée, ni le duo joliment amoureux et sensuel, interprété avec conviction par deux des danseuses dans un double mouvement d’attraction-répulsion, ne parviendront à nouer ces individualités en un corps que l’on sentirait unique et porté vers le même idéal.
Elles seront quatre, ou deux, ou trois, parfois une seule sur le plateau, et paradoxalement c’est cette présence unique qui pour moi fera naître un lien avec la salle, parce que dans sa solitude soudaine la danseuse saura de son corps et de ses gestes exprimer ce qu’elle est, ou ce qu’elle n’est pas, ce qu’elle cherche et qu’elle voudrait saisir. Quatre jeunes femmes diverses, de couleurs, de costumes et de postures, mais toutes le visage tragique, comme muré dans son intérieur, le regard fixé là-bas sur l’horizon, et jamais ne se regardant vraiment. Quatre aux mouvements démultipliés, et qui cependant ne comblent pas le vide installé entre elles, quatre bonnes volontés qui ne font vibrer ni l’air autour d’elles ni mes émotions, ces dernières comme absorbées dans ce trou blanc d’une scène soudain devenue trop vaste. Ni les corps rapprochés pour soutenir celui qui tombe, ni la chute commune plusieurs fois jouée, ni le duo joliment amoureux et sensuel, interprété avec conviction par deux des danseuses dans un double mouvement d’attraction-répulsion, ne parviendront à nouer ces individualités en un corps que l’on sentirait unique et porté vers le même idéal. Ce qu’ils vont raconter n’est que la suite d’une histoire commencée il y a bien longtemps, dans un autre lieu, dans un autre pays, dans une autre culture et donc quand les portes de la salle s’ouvrent, ils sont déjà en scène, sur laquelle côté jardin trône une énorme sculpture noire. Lui le père, coté cour, assis droit comme uni sur sur une des chaises noires qui bordent le plateau, elle la fille, au milieu, esquisse quelques pas, doigts de pieds écartelés, le haut du corps immobile, tandis que la bande son dévide la litanie des questions dans lesquelles se mêlent futilité, intimité et gravité :: « Pourquoi tu manges la nuit ? », « Pourquoi quand je suis là, tu es toujours fatigué ? » « As-tu déjà trompé ma mère ? », « Tu as peur que je ne sois plus ta fille ? ». « Pourquoi les gens ne se disent pas la vérité? A quoi ça sert de vivre?» La brutalité des formulations est la forme que prennent la timidité pour se dissimuler et la pudeur pour se dévoiler quand l’émotion déborde les mots qui ne peuvent la contenir.
Ce qu’ils vont raconter n’est que la suite d’une histoire commencée il y a bien longtemps, dans un autre lieu, dans un autre pays, dans une autre culture et donc quand les portes de la salle s’ouvrent, ils sont déjà en scène, sur laquelle côté jardin trône une énorme sculpture noire. Lui le père, coté cour, assis droit comme uni sur sur une des chaises noires qui bordent le plateau, elle la fille, au milieu, esquisse quelques pas, doigts de pieds écartelés, le haut du corps immobile, tandis que la bande son dévide la litanie des questions dans lesquelles se mêlent futilité, intimité et gravité :: « Pourquoi tu manges la nuit ? », « Pourquoi quand je suis là, tu es toujours fatigué ? » « As-tu déjà trompé ma mère ? », « Tu as peur que je ne sois plus ta fille ? ». « Pourquoi les gens ne se disent pas la vérité? A quoi ça sert de vivre?» La brutalité des formulations est la forme que prennent la timidité pour se dissimuler et la pudeur pour se dévoiler quand l’émotion déborde les mots qui ne peuvent la contenir.


