— par Janine Bailly —
 Nous faire, en sus des « films dont on parle », découvrir et aimer des cinémas nouveaux et différents, ou des cinéastes trop peu connus du grand public, loin des blockbusters à l’américaine qui remplissent régulièrement et (trop ?) longuement les salles, telle est une partie de la mission que s’est donnée Steve Zébina, à la tête des RCM. Et quand en début de séance, souvent essoufflé d’avoir couru à ses tâches diverses et variées, il nous livre de façon si communicative ses émotions et coups de cœur, nous ne pouvons qu’adhérer à ses propositions ! J’aimerais en donner pour preuve trois films vus ces lundi et mardi de printemps, trois films qui m’ont émue, interpellée, enrichie et donné un regard neuf sur le monde.
Nous faire, en sus des « films dont on parle », découvrir et aimer des cinémas nouveaux et différents, ou des cinéastes trop peu connus du grand public, loin des blockbusters à l’américaine qui remplissent régulièrement et (trop ?) longuement les salles, telle est une partie de la mission que s’est donnée Steve Zébina, à la tête des RCM. Et quand en début de séance, souvent essoufflé d’avoir couru à ses tâches diverses et variées, il nous livre de façon si communicative ses émotions et coups de cœur, nous ne pouvons qu’adhérer à ses propositions ! J’aimerais en donner pour preuve trois films vus ces lundi et mardi de printemps, trois films qui m’ont émue, interpellée, enrichie et donné un regard neuf sur le monde.
Lundi il y eut, à Madiana, de Claudia Sainte-Luce, Jazmin et Toussaint, film venu du Mexique, et dont les rôles-titres sont avec maestria tenus par la réalisatrice elle-même et par le parrain du festival, un Jimmy Jean-Louis étonnamment véridique en sexagénaire malade et déclinant. C’est bien là la magie du cinéma, que de nous faire croire à une transformation radicale de l’acteur, dans l’acceptation d’une personnalité si loin de son âge, si différente de son aspect et de sa condition physiques véritables ! De

 Faute de temps, et parce que d’autres activités culturelles fort intéressantes s’offrent à nous, peu nombreux sont ceux qui pourraient dire « Aux RCM, j’ai tout vu ! ». Consolons-nous en pensant que la qualité est souvent préférable à la quantité !
Faute de temps, et parce que d’autres activités culturelles fort intéressantes s’offrent à nous, peu nombreux sont ceux qui pourraient dire « Aux RCM, j’ai tout vu ! ». Consolons-nous en pensant que la qualité est souvent préférable à la quantité ! À l’heure où, sur les ondes venues de « là-bas », les voix enjôleuses de la station radiophonique France Inter nous incitent à rédiger une lettre de motivation dans l’espoir un peu fou d’être sélectionnés au Jury du Livre Inter à Paris, sachant que nous serons des milliers, doux rêveurs, à répondre à l’appel, tournons-nous plutôt vers le pays Martinique, et regardons où il serait loisible d’exercer notre esprit, critique ou pas, et nos talents de « lecteurs-scripteurs », si tant est que nous en possédions quelques soupçons…
À l’heure où, sur les ondes venues de « là-bas », les voix enjôleuses de la station radiophonique France Inter nous incitent à rédiger une lettre de motivation dans l’espoir un peu fou d’être sélectionnés au Jury du Livre Inter à Paris, sachant que nous serons des milliers, doux rêveurs, à répondre à l’appel, tournons-nous plutôt vers le pays Martinique, et regardons où il serait loisible d’exercer notre esprit, critique ou pas, et nos talents de « lecteurs-scripteurs », si tant est que nous en possédions quelques soupçons… Le spectacle Samo, a tribut to Basquiat, proposé à Tropiques-Atrium, fut unique, en ce sens qu’il n’eut lieu qu’une seule fois, en ce sens surtout qu’il a donné à voir une création de forme particulièrement inventive et novatrice. Nécessaire travail de mémoire, étrange poème en prose, ode au peintre si tôt disparu, sorte d’opéra-rock, opéra-jazz tirant sur le hip-hop, tragi-comédie musicale aussi… et pourquoi pas ?
Le spectacle Samo, a tribut to Basquiat, proposé à Tropiques-Atrium, fut unique, en ce sens qu’il n’eut lieu qu’une seule fois, en ce sens surtout qu’il a donné à voir une création de forme particulièrement inventive et novatrice. Nécessaire travail de mémoire, étrange poème en prose, ode au peintre si tôt disparu, sorte d’opéra-rock, opéra-jazz tirant sur le hip-hop, tragi-comédie musicale aussi… et pourquoi pas ?
 C’est un samedi soir peu ordinaire sur la terre. À l’extérieur, le Carnaval se déploie. Dans la nuit foyalaise, la « Bet a fé » déroule ses anneaux, et ses luminescences font surgir de l’obscurité les lisières de la Savane. Il nous faut donc louvoyer, un œil sur les groupes chamarrés qui se déchaînent au rythme endiablé des percussions, l’autre sur les aiguilles de la montre, pour être sûrs de rejoindre à temps la scène de Tropiques-Atrium. Car là, à l’intérieur nous attendent d’autres lumières, d’autres chants, d’autres danses, et les mots de ces femmes-feu, femmes-filles, femmes-volcans qui laissent couler une parole libérée, brûlante de sincérité et d’énergie vitale.
C’est un samedi soir peu ordinaire sur la terre. À l’extérieur, le Carnaval se déploie. Dans la nuit foyalaise, la « Bet a fé » déroule ses anneaux, et ses luminescences font surgir de l’obscurité les lisières de la Savane. Il nous faut donc louvoyer, un œil sur les groupes chamarrés qui se déchaînent au rythme endiablé des percussions, l’autre sur les aiguilles de la montre, pour être sûrs de rejoindre à temps la scène de Tropiques-Atrium. Car là, à l’intérieur nous attendent d’autres lumières, d’autres chants, d’autres danses, et les mots de ces femmes-feu, femmes-filles, femmes-volcans qui laissent couler une parole libérée, brûlante de sincérité et d’énergie vitale. L’actualité nous en donne régulièrement des échos, les médias s’emparent de leurs odyssées, transcontinentales ou européennes, de préférence si elles se font tragiques, et puis on s’habitue, on vit près d’eux sans les voir sans les regarder sans leur faire même l’aumône d’un sourire, d’un signe de reconnaissance, d’une parole, qui viendraient à l’appui d’une possible aide matérielle.
L’actualité nous en donne régulièrement des échos, les médias s’emparent de leurs odyssées, transcontinentales ou européennes, de préférence si elles se font tragiques, et puis on s’habitue, on vit près d’eux sans les voir sans les regarder sans leur faire même l’aumône d’un sourire, d’un signe de reconnaissance, d’une parole, qui viendraient à l’appui d’une possible aide matérielle. Sur les tréteaux foyalais, trois figures de femmes ont pris corps et vie en ce mois de janvier, si différentes dans leur singularité, et pourtant si proches dans leur combat pour être au monde : il y eut l’Antigone, de Sorj Chalandon, à ressusciter dans Beyrouth soumise à la fureur guerrière des hommes, sœur de l’Antigone antique qui, bravant la volonté du roi Créon, de ses mains grattait la terre pour donner à son frère Polynice une digne sépulture. Puis vint la Médée Kali de Laurent Gaudé, figure triangulaire revisitant les mythes, faite de Méduse à la chevelure de serpents qui pétrifie les hommes, de Kali la déesse meurtrière aux multiples bras, de Médée enfin, amante, épouse et mère assassine, qui par son crime fait expier à Jason sa trahison, qui revient chercher les corps de ses enfants et de ses mains nettoie compulsivement le marbre du tombeau. La troisième, mais non la moindre, se nomme Jaz, qui nous ramène à des temps plus universels.
Sur les tréteaux foyalais, trois figures de femmes ont pris corps et vie en ce mois de janvier, si différentes dans leur singularité, et pourtant si proches dans leur combat pour être au monde : il y eut l’Antigone, de Sorj Chalandon, à ressusciter dans Beyrouth soumise à la fureur guerrière des hommes, sœur de l’Antigone antique qui, bravant la volonté du roi Créon, de ses mains grattait la terre pour donner à son frère Polynice une digne sépulture. Puis vint la Médée Kali de Laurent Gaudé, figure triangulaire revisitant les mythes, faite de Méduse à la chevelure de serpents qui pétrifie les hommes, de Kali la déesse meurtrière aux multiples bras, de Médée enfin, amante, épouse et mère assassine, qui par son crime fait expier à Jason sa trahison, qui revient chercher les corps de ses enfants et de ses mains nettoie compulsivement le marbre du tombeau. La troisième, mais non la moindre, se nomme Jaz, qui nous ramène à des temps plus universels.
 Le festival des petites formes, deuxième du nom, proposé par Tropiques Atrium Scène Nationale, met heureusement en lumière(s) les artistes antillais, que leur voix emprunte, pour se faire entendre, la forme théâtrale, la forme poétique ou la forme musicale. Et les femmes y ont cette année plus que droit de cité, une place de choix !
Le festival des petites formes, deuxième du nom, proposé par Tropiques Atrium Scène Nationale, met heureusement en lumière(s) les artistes antillais, que leur voix emprunte, pour se faire entendre, la forme théâtrale, la forme poétique ou la forme musicale. Et les femmes y ont cette année plus que droit de cité, une place de choix ! Lire est un acte solitaire, où celui qui lit se crée, au-delà des mots et des pages, ses propres représentations, qui puisent dans son vécu, mais aussi dans ce que déjà il sait ou pressent de ce qui va lui être dit. Le texte ne s’imprime par sur un esprit vierge, mais il vient compléter, corriger, ou confirmer, débusquer aussi ce qui y dort. Être spectateur est au contraire un acte qui se partage, fait vibrer chacun à l’unisson des autres, et qui offre, sur les mots de l’écrivain, les images, les gestes, les couleurs et les sons choisis par une compagnie d’acteurs. Et le miracle a une fois encore eu lieu ce jeudi soir, au théâtre Aimé Césaire, où le silence quasiment recueilli de la salle, les rires bienvenus aux traits d’humour, destinés à relâcher un peu la tension générée par la gravité du propos, les vibrations enfin d’un public conquis, ont salué le travail de la Compagnie Les Asphodèles.
Lire est un acte solitaire, où celui qui lit se crée, au-delà des mots et des pages, ses propres représentations, qui puisent dans son vécu, mais aussi dans ce que déjà il sait ou pressent de ce qui va lui être dit. Le texte ne s’imprime par sur un esprit vierge, mais il vient compléter, corriger, ou confirmer, débusquer aussi ce qui y dort. Être spectateur est au contraire un acte qui se partage, fait vibrer chacun à l’unisson des autres, et qui offre, sur les mots de l’écrivain, les images, les gestes, les couleurs et les sons choisis par une compagnie d’acteurs. Et le miracle a une fois encore eu lieu ce jeudi soir, au théâtre Aimé Césaire, où le silence quasiment recueilli de la salle, les rires bienvenus aux traits d’humour, destinés à relâcher un peu la tension générée par la gravité du propos, les vibrations enfin d’un public conquis, ont salué le travail de la Compagnie Les Asphodèles. Un beau jour, ils sont revenus, en Roumanie, chez eux donc, après la chute de Ceausescu en 1989 (suivie de la promulgation d’une constitution en 1991). Ils étaient en ce temps-là tout emplis d’espoir, l’avenir radieux s’ouvrait devant eux, ils croyaient leur pays inscrit sur la partition des lendemains qui chantent. Et puis le rêve a tourné court, car rien n’avait réellement changé, tant il est vrai que les vieilles habitudes délétères de l’ancien régime étaient restées vivaces, dans un pays gangréné encore et toujours par la corruption, au niveau des puissants mais aussi au quotidien, dans la vie des gens ordinaires.
Un beau jour, ils sont revenus, en Roumanie, chez eux donc, après la chute de Ceausescu en 1989 (suivie de la promulgation d’une constitution en 1991). Ils étaient en ce temps-là tout emplis d’espoir, l’avenir radieux s’ouvrait devant eux, ils croyaient leur pays inscrit sur la partition des lendemains qui chantent. Et puis le rêve a tourné court, car rien n’avait réellement changé, tant il est vrai que les vieilles habitudes délétères de l’ancien régime étaient restées vivaces, dans un pays gangréné encore et toujours par la corruption, au niveau des puissants mais aussi au quotidien, dans la vie des gens ordinaires. Paterson, c’est bien le titre du film, nom à la graphie à demi passée apparu très vite sur le plan d’un pan de mur urbain dégradé. Mais Paterson, c’est tout à la fois, c’est d’abord le nom de cette petite ville ouvrière quelque peu appauvrie du New Jersey, comme démodée et figée dans un passé industriel révolu, celui aussi des grands poètes dont elle est le berceau, mais ville vibrante d’une vie simple et quotidienne pour qui sait la regarder, l’entendre, écouter battre son coeur tranquille. Paterson, c’est le patronyme du personnage masculin conducteur d’autobus, bus-driver joué par Adam Driver, et dont la caméra suit en longs travellings verticaux les tribulations, chauffeur au volant ou promeneur à pied du chien Marvin. Paterson, grâce auquel on ne cessera de la parcourir, cette ville qui se donne, superbement reflétée en images lumineuses dans les vitres du véhicule. Paterson, c’est encore le titre d’un long poème de William Carlos Williams, ode à la ville elle-même, et Jim Jarmusch dit avoir nommé ainsi son personnage après en avoir lu le début, qui compare la cité à un homme couché sur le flanc, car l’homme dans sa complexité est la ville autant que la ville est l’homme.
Paterson, c’est bien le titre du film, nom à la graphie à demi passée apparu très vite sur le plan d’un pan de mur urbain dégradé. Mais Paterson, c’est tout à la fois, c’est d’abord le nom de cette petite ville ouvrière quelque peu appauvrie du New Jersey, comme démodée et figée dans un passé industriel révolu, celui aussi des grands poètes dont elle est le berceau, mais ville vibrante d’une vie simple et quotidienne pour qui sait la regarder, l’entendre, écouter battre son coeur tranquille. Paterson, c’est le patronyme du personnage masculin conducteur d’autobus, bus-driver joué par Adam Driver, et dont la caméra suit en longs travellings verticaux les tribulations, chauffeur au volant ou promeneur à pied du chien Marvin. Paterson, grâce auquel on ne cessera de la parcourir, cette ville qui se donne, superbement reflétée en images lumineuses dans les vitres du véhicule. Paterson, c’est encore le titre d’un long poème de William Carlos Williams, ode à la ville elle-même, et Jim Jarmusch dit avoir nommé ainsi son personnage après en avoir lu le début, qui compare la cité à un homme couché sur le flanc, car l’homme dans sa complexité est la ville autant que la ville est l’homme.
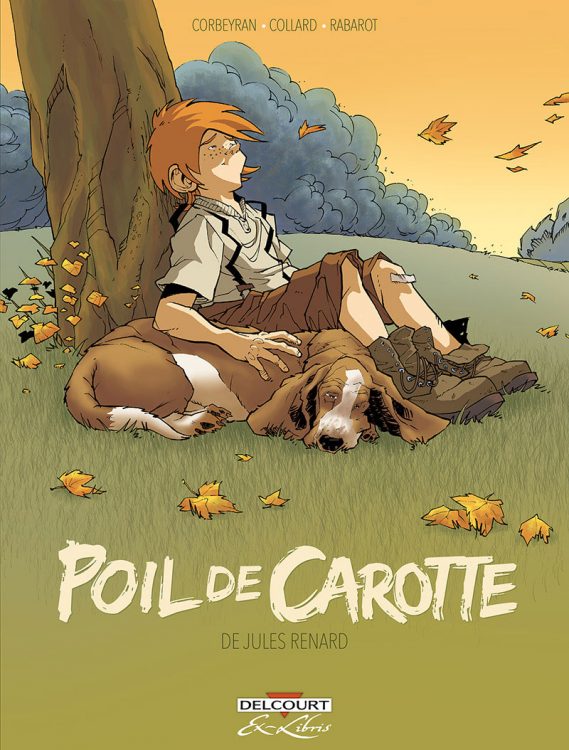 Maître de la formule incisive, Sacha Guitry, dans son ouvrage intitulé Toutes réflexions faites, écrit ceci : « Lorsqu’on vient d’entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui ». Bien qu’elle paraisse galvaudée, j’ose reprendre à mon compte cette jolie déclaration, puisqu’au sortir du spectacle de Fábio Lopez, Poil de Carotte, hantée par les images qu’il a si joliment créées, je suis allée nuitamment dans ma bibliothèque déterrer ce vieil ouvrage écorné, qu’autrefois je fis lire, non sans frémir, à de chères têtes, blondes ou pas. Et remettant ainsi des noms plus précis sur les personnages dansés, me remémorant les scènes vues sur le plateau de la salle Frantz Fanon, lieu enchanté ce soir-là d’arabesques, sauts, entrelacements et autres figures parfaites, j’ai retrouvé toute la cruauté et toute la saveur du récit — autobiographique ? — de Jules Renard.
Maître de la formule incisive, Sacha Guitry, dans son ouvrage intitulé Toutes réflexions faites, écrit ceci : « Lorsqu’on vient d’entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui ». Bien qu’elle paraisse galvaudée, j’ose reprendre à mon compte cette jolie déclaration, puisqu’au sortir du spectacle de Fábio Lopez, Poil de Carotte, hantée par les images qu’il a si joliment créées, je suis allée nuitamment dans ma bibliothèque déterrer ce vieil ouvrage écorné, qu’autrefois je fis lire, non sans frémir, à de chères têtes, blondes ou pas. Et remettant ainsi des noms plus précis sur les personnages dansés, me remémorant les scènes vues sur le plateau de la salle Frantz Fanon, lieu enchanté ce soir-là d’arabesques, sauts, entrelacements et autres figures parfaites, j’ai retrouvé toute la cruauté et toute la saveur du récit — autobiographique ? — de Jules Renard.
 Comme chaque année, le Martinique Jazz Festival nous est revenu avec le mois de novembre, riche de découvertes ou de re-découvertes musicales. Et lors même qu’il bat son plain, non seulement à Fort-de-France mais aussi égrenant ses notes sur tout le territoire de l’île, trois films documentaires, en lien avec l’événement, nous sont gracieusement proposés par Tropiques-Atrium, et ce pour la première fois dans la salle Frantz Fanon.
Comme chaque année, le Martinique Jazz Festival nous est revenu avec le mois de novembre, riche de découvertes ou de re-découvertes musicales. Et lors même qu’il bat son plain, non seulement à Fort-de-France mais aussi égrenant ses notes sur tout le territoire de l’île, trois films documentaires, en lien avec l’événement, nous sont gracieusement proposés par Tropiques-Atrium, et ce pour la première fois dans la salle Frantz Fanon. Je voudrais, en réponse polie à l’article un tantinet injurieux de Selim Lander, — paru sur ce site le 22 novembre sous le titre élégant de Cinéma : En avoir ou pas (Bellochio et Gomes) —, et qui m’a personnellement touchée, simplement retranscrire cet article de Télérama : il y est dit ce que j’ai ressenti lors de la projection du film à Madiana, et je tiens à remercier ceux qui ont eu le courage de le programmer tout en sachant que l’inédit, toujours, a commencé par faire hurler et fuir les foules… Quel est le contexte de l’œuvre ? La crise a frappé de plein fouet le Portugal, l’un des quatre pays européens dont la situation était si grave qu’ils durent faire appel, pour survivre, à la troïka. Le réalisateur Miguel Gomes décide donc de parler de son pays, soumis à une sévère austérité, et de suggérer/analyser les troubles qu’il traverse. Dans le premier volume d’un film constitué de trois opus, où, à la façon du recueil persan Mille et Une Nuits, il déroule une succession d’histoires différentes, le cinéaste contera, entre autres, celle de représentants européens venus en mission d’observation au Portugal, et qui souffriront d’étranges problèmes de virilité…
Je voudrais, en réponse polie à l’article un tantinet injurieux de Selim Lander, — paru sur ce site le 22 novembre sous le titre élégant de Cinéma : En avoir ou pas (Bellochio et Gomes) —, et qui m’a personnellement touchée, simplement retranscrire cet article de Télérama : il y est dit ce que j’ai ressenti lors de la projection du film à Madiana, et je tiens à remercier ceux qui ont eu le courage de le programmer tout en sachant que l’inédit, toujours, a commencé par faire hurler et fuir les foules… Quel est le contexte de l’œuvre ? La crise a frappé de plein fouet le Portugal, l’un des quatre pays européens dont la situation était si grave qu’ils durent faire appel, pour survivre, à la troïka. Le réalisateur Miguel Gomes décide donc de parler de son pays, soumis à une sévère austérité, et de suggérer/analyser les troubles qu’il traverse. Dans le premier volume d’un film constitué de trois opus, où, à la façon du recueil persan Mille et Une Nuits, il déroule une succession d’histoires différentes, le cinéaste contera, entre autres, celle de représentants européens venus en mission d’observation au Portugal, et qui souffriront d’étranges problèmes de virilité… — Par Janine Bailly —
— Par Janine Bailly — Il existe en Martinique des lieux un peu secrets, et que l’on découvre au hasard d’une rencontre, ou encore d’une navigation aventureuse sur Facebook. Il en est ainsi de la Bodeguita, une maison blanche aux rideaux orange qui signalent des balcons ouverts, un lieu pas toujours facile à dénicher quand on y vient premièrement la nuit tombée, un petit coin d’Espagne qui a jeté l’ancre au dos de la rocade et s’est niché au fond de l’impasse du Lareinty, pour le plus grand bonheur des amateurs de bonne chaire et de bons vins autant que de belles expositions. Un régal donc pour le corps et l’esprit !
Il existe en Martinique des lieux un peu secrets, et que l’on découvre au hasard d’une rencontre, ou encore d’une navigation aventureuse sur Facebook. Il en est ainsi de la Bodeguita, une maison blanche aux rideaux orange qui signalent des balcons ouverts, un lieu pas toujours facile à dénicher quand on y vient premièrement la nuit tombée, un petit coin d’Espagne qui a jeté l’ancre au dos de la rocade et s’est niché au fond de l’impasse du Lareinty, pour le plus grand bonheur des amateurs de bonne chaire et de bons vins autant que de belles expositions. Un régal donc pour le corps et l’esprit ! A l’heure où le Brésil, victime de bouleversements tragiques, rongé par la corruption, la spéculation et les luttes de pouvoir, s’achemine peut-être vers ce qui ressemblerait à une nouvelle dictature, il est bon de voir ou de revoir le film Aquarius. Deuxième long métrage de Kleber Mendonça Filho après Les bruits de Recife, injustement boudé par le jury du festival de Cannes, mais plébiscité par le public et encensé par une bonne partie de la critique, Aquarius connaît sur les écrans de Madiana, dans le cadre de la séance VO, un tel succès que Steve, notre Monsieur Cinéma de Tropiques-Atrium, nous en promet pour bientôt une nouvelle projection.
A l’heure où le Brésil, victime de bouleversements tragiques, rongé par la corruption, la spéculation et les luttes de pouvoir, s’achemine peut-être vers ce qui ressemblerait à une nouvelle dictature, il est bon de voir ou de revoir le film Aquarius. Deuxième long métrage de Kleber Mendonça Filho après Les bruits de Recife, injustement boudé par le jury du festival de Cannes, mais plébiscité par le public et encensé par une bonne partie de la critique, Aquarius connaît sur les écrans de Madiana, dans le cadre de la séance VO, un tel succès que Steve, notre Monsieur Cinéma de Tropiques-Atrium, nous en promet pour bientôt une nouvelle projection.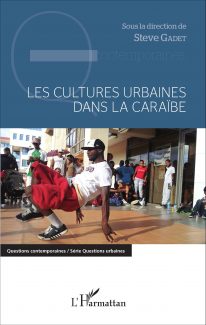 Ce 17 octobre, dans le cadre des rendez-vous du lundi à la Bibliothèque Universitaire, Steve Gadet, rejoint en dernière partie de son intervention par Corinne Plantin, nous présentait un ouvrage au titre prometteur, réalisé sous sa direction et publié en 2016 chez L’Harmattan, Les cultures urbaines dans la Caraïbe. Et cette double communication fut si riche, si enthousiaste et motivante que l’on peut sans doute regretter son caractère par trop confidentiel.
Ce 17 octobre, dans le cadre des rendez-vous du lundi à la Bibliothèque Universitaire, Steve Gadet, rejoint en dernière partie de son intervention par Corinne Plantin, nous présentait un ouvrage au titre prometteur, réalisé sous sa direction et publié en 2016 chez L’Harmattan, Les cultures urbaines dans la Caraïbe. Et cette double communication fut si riche, si enthousiaste et motivante que l’on peut sans doute regretter son caractère par trop confidentiel. Qu’elle fut belle, cette dernière après-midi de vacances, quand avant de reprendre, un peu nostalgique, le chemin de l’école, on a pu rêver encore et voguer dans l’imaginaire sous la houlette de Jean l’Océan ! Comme un sursis accordé, comme un dernier voyage immobile au pays des arbres et des sorcières, qui hantent les nuits noires et les forêts profondes.
Qu’elle fut belle, cette dernière après-midi de vacances, quand avant de reprendre, un peu nostalgique, le chemin de l’école, on a pu rêver encore et voguer dans l’imaginaire sous la houlette de Jean l’Océan ! Comme un sursis accordé, comme un dernier voyage immobile au pays des arbres et des sorcières, qui hantent les nuits noires et les forêts profondes.
 C’est aussi sur les écrans de Madiana, dans des conditions matérielles un peu plus confortables, que sont projetés d’autres films des RCM.
C’est aussi sur les écrans de Madiana, dans des conditions matérielles un peu plus confortables, que sont projetés d’autres films des RCM.