— Par Robert Lodimus —
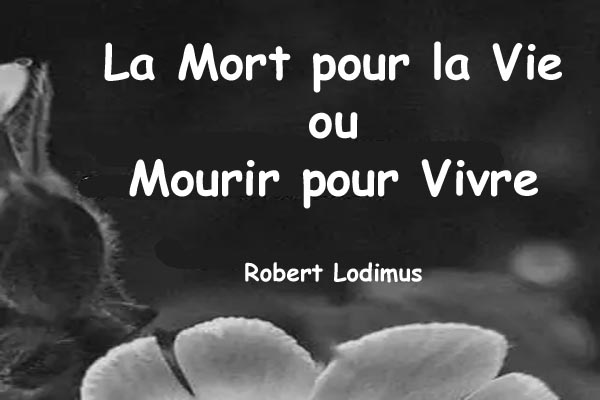 Chapitre IX
Chapitre IX
LA RÉVÉLATION
Gisèle décéda le 7 août 1945, un jour après Hiroshima et deux jours avant Nagasaki. L’Allemagne nazie avait déjà capitulé avec l’entrée triomphale des russes à Berlin le 15 avril 1945, précédée du suicide du chef suprême du 3e Reich. Le largage des deux bombes atomiques sur les villes susmentionnées contraignit le Japon à signer sa reddition. Ce geste désespéré mit totalement fin à cette guerre absurde et meurtrière qui ravagea l’Europe durant six ans. Grâce au « plan Marshall », les moteurs des machines économiques des pays durement éprouvés avaient redémarré. Ils étaient parvenus tant bien que mal à reprendre leur vitesse de croisière. Les pays de l’ « Axe du mal », tels le Japon, l’Allemagne, l’Autriche… étaient devenus des butins de guerre que les « Alliés de l’axe du bien » avaient décidés de partager entre eux, sans gêne, au palais Livadia, à Yalta, en Crimée.
Entre-temps, la petite Francesca avait atteint l’âge de douze ans. Orpheline de père et de mère, elle était devenue une jeune adulte prématurée, confrontée à toutes les formes d’insécurité et d’incertitude. Le froid, la faim, la maladie, l’angoisse du lendemain, la solitude prirent totalement possession de son corps d’enfant et tourmentèrent son esprit fragile. Tout cela, soit dit en passant, par la faute de l’Espagne de Charles II et de la France de Louis XIV. En se partageant l’île par le fameux acte concessionnaire de 1697, les deux puissances coloniales créèrent deux pays sur un seul territoire, fondèrent deux nations au sein d’un même peuple, provoquèrent la fécondation de deux cultures dans un seul ovaire culturel. Et il aurait fallu encore additionner à la constatation néfaste, toute cette violence, toute cette aversion, toute cette animosité qui dégradèrent au fil du temps les relations entre deux populations qui, originellement, ne furent en réalité qu’une… Juste avant de déménager de la terre pour aller habiter dans les vastes prairies des « esprits » de Guinée, comme auraient dit les « serviteurs » ou « servantes » des « loas », Gisèle, dont la santé montrait considérablement des signes évidents de détérioration, avait senti la nécessité d’avoir une conversation franche avec sa petite nièce à propos du sort véritable fait à son père Selondieu et à sa mère Acélia. Il fallait, pensa-t-elle, fermer la vanne de ce fol espoir qui arrosait le cœur de l’adolescente continuellement exposé à l’attente longue et douloureuse d’un retour qui n’arrivait pas, qui ne serait, en toute réserve, pas arrivé. Il avait été important qu’elle l’eût fait avant d’avoir rejoint Capois et ses deux enfants au royaume des morts… Étendue sur le dos, dans le grabat de son agonie, elle s’était emparée de la main de Francesca et commençait à lui parler de sa voix devenue considérablement atone :
– Francesca, je sens que je n’en ai plus pour longtemps. Dieu m’a appelée. Ma mission est terminée ici-bas. Je suis arrivée au bout de mon voyage… Cela va se passer très bientôt. Je veux que tu demeures la petite fille courageuse… que tu as toujours été. Je sais que ce ne sera pas facile pour toi, tu es encore trop jeune… Mais il y a des chemins que l’on ne peut pas éviter, comme ceux tracés devant nous par le destin et qui conduisent aux ténèbres qui marquent la fin du parcours de l’individu, la fin de l’être humain dans le monde matériel. Selondieu et Acélia ne reviendront pas… Il y a eu un grave malheur qui est tombé sur les Haïtiens en République dominicaine. Tu étais trop petite pour que j’aie pu t’en parler à l’époque. Je crois que tes parents ont été eux aussi frappés par la foudre de la haine des militaires dominicains qui ont commis ce massacre sous l’ordre de leur président. Lorsque j’ai réalisé qu’ils n’avaient pas été parmi les congos qui avaient fui l’Est de l’île, et qui étaient retournés dans leurs villages, j’avais compris que mes neveux, leurs concubines et leurs enfants n’avaient pas eu cette chance, que leurs têtes avaient été décapitées ou leurs corps mitraillés par les bourreaux de cet assassinat sans précédent dans l’histoire de la Caraïbe. Ma petite Francesca, il va falloir que tu luttes seule, toute seule, pour survivre à Savane Chaude. Le vieux Simon qui habite près de la rivière veillera sur toi. Cette habitation est désormais à toi. Si tu l’abandonnes, les enfants d’Édouard trouveront là un bon prétexte pour la reprendre, alors que Capois a donné son sang pour la mériter. Nous avons travaillé pendant de longues années, vingt-neuf ans, et même plus, avant que le défunt propriétaire n’ait accepté de nous la concéder, sous contrat verbal… Il paraît que cela existe dans la loi; en tout cas, c’est ce que M. Thermitus avait dit à mon homme à l’époque… Et puis, les enfants de M. Thermitus comprendront que ce serait un péché de te faire du mal, de t’enlever ta seule source de survie, quand tu n’as personne d’autre sur qui compter en dehors de toi-même… Je ne me sens plus appartenir à ce monde…
Émile Michel Cioran affirma que « L’on ne comprend la mort qu’en ressentant la vie comme une agonie prolongée, où vie et mort se mélangent. »
Francesca eut subitement l’impression que tout le village s’était transformé en un manège géant qui n’arrêtait pas de tournoyer avec elle. La terre noirâtre croula sous ses pieds. Elle perdit l’équilibre momentanément, mais se reprit bien vite. Elle n’avait pas voulu surtout laisser apparaître sa faiblesse dans une situation qui exigeait son courage et sa détermination. Et puis, tante Gisèle avait été sur le point de mourir, ce n’était pas du tout le moment de flancher devant ce corps faible, fatigué, agonisant qui se retirait tranquillement, lentement du monde des vivants. Cependant, sa nature sereine et joviale était fouettée et emportée d’un seul coup par une bourrasque de chagrins. Toute sa gaieté enfantine avait fondu sous la chaleur de son ébahissement craintif et prémonitoire. La mort l’avait sevrée d’un père qui l’affectionnait, d’une mère qui la cajolait, jouait aux osselets avec elle, la berçait, la nourrissait, chantait avec elle des comptines paysannes, plongeait avec elle dans les eaux fraîches et cristallines de la rivière ombrageuse, restait couchée à ses côtés sur la petite natte de joncs jusqu’à ce qu’elle se fût endormie pour s’être réveillée au petit matin. Elle parlait peu. Elle se remettait entièrement à ses activités journalières dans les champs. À toutes les fois que le vieux Simon était passé rendre visite à sa vieille amie malade, il eut toujours la gentillesse de lui offrir son aide précieuse, et ainsi, elle parvenait à compléter les travaux les plus compliqués; par exemple, il l’instruisit sur la distance à respecter ou la profondeur du trou à considérer pour semer les grains ou déposer les plantules. Simon vivait seul dans sa cabane avec son vieux chien squelettique, tellement maigre, qu’on aurait pu dénombrer tous les os de l’animal et arriver au bon compte sans se tromper une seule fois… À les regarder vivre ensemble, et inséparables comme ils le furent, quiconque aurait facilement deviné que c’étaient le temps et le destin qui les avaient tenus soudés l’un à l’autre. Ils avaient vieilli côte à côte dans cet environnement de délabrement et de souffrances muettes qu’était devenu l’espace existentiel de Simon depuis le décès de sa compagne Félie, emportée par une mauvaise fièvre et une maudite diarrhée qui avaient duré sept jours… Les gens de Savane Chaude avaient ironiquement prédit que l’animal et son maître allaient mourir le même jour et à la même heure, et cela arriva étonnamment, treize mois et dix-sept jours après le départ ultime de tante Gisèle. Un matin, on avait retrouvé Simon étendu raide mort dans sa couche de misère, et Solitude qui reposait à ses pieds, avait cessé aussi de respirer. Suarez ou Simon était né dans la partie orientale de l’île. Mais il avait décidé de changer de nom et de s’installer à Savane Chaude, parmi les paysans les plus démunis de l’hémisphère. « Je me sens plus proche des Haïtiens que des Dominicains qui cherchent encore leur identité culturelle ailleurs et qui rejettent l’Afrique », répétait-il, avec sa grande sagesse et son calme perpétuel. Les villageois avaient fouillé un trou dans la terre, derrière le chêne centenaire et ils y avaient déposé les corps inertes, sous la grisaille d’une journée d’automne pluvieuse. Ils avaient chanté des refrains folkloriques lyriques, récité la prière des loas, bu du clairin, échangé sur le sort des indigents du bas-monde, enfin, ressassé l’un après l’autre tous les cas qui ressemblaient à celui de Simon et de Solitude, pour conclure finalement que l’homme, aussi puissant, aussi faible, aussi riche, aussi pauvre, aussi savant, aussi illettré, aussi grand, aussi petit, aussi beau, aussi laid, aussi élégant, aussi négligé, aussi blanc, aussi foncé, aussi jaune, aussi rouge… qu’il fût, n’était rien, sinon qu’une masse de boue animée par le soufle du Grand-Maître du ciel et de la terre, et destinée à retourner dans les entrailles du néant éternel. Ainsi soit-il!
Chapitre X
LA SOLITUDE ET LE VIOL
La maladie de Gisèle l’avait clouée dans la mansarde. Le samedi, dès l’aube, Francesca suivait les paysannes jusqu’au grand marché public pour vendre quelques produits qui lui permettaient de soigner et de nourrir la vieille tante qui avait indulgemment remplacé auprès d’elle Selondieu et Acélia. 20 kilomètres séparaient Savane Chaude de la ville. Ses petits pieds nus trottaient sans repos sur la route étroite et caillouteuse. Gisèle n’était pas originaire de ce lieu perdu dans les plaines et les montagnes, où elle avait vécu quand même heureuse avec son mari, ses deux enfants, ses sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et ses nièces. Elle et Capois venaient de La Roche, une autre région rurale qui était située complètement à l’opposé de Savane Chaude. Ils avaient émigré à cet endroit dans l’espoir de se faire une nouvelle vie. Le couple était originaire d’un village côtier où la petite population pratiquait la pêche de poisson, de homard, de crevette, de crabe et d’anguille. Lorsque la mer n’arrivait plus à leur donner grand-chose, ils avaient décidé d’aller tenter leur chance ailleurs, et de se recycler dans le domaine de la production agricole. Tout d’abord, pour survivre, ils adhérèrent au métayage, le travail de deux moitiés. Seize heures à sarcler, à désherber les terres d’un latifundiste qui ne se gênait pas pour les saigner à blanc, les extorquer et exploiter leur force de travail. Parfois, ce propriétaire vénal, disgracieux ne respectait pas les règles du contrat verbal. Au lieu de la moitié, il accaparait à lui seul les 7/8 de la récolte, et pour acheter les semences dont il avait besoin pour démarrer la prochaine saison agricole, le couple malheureux était obligé d’emprunter de l’argent chez l’usurier spéculateur, Bernard Décasse, un français lettré, toujours élégamment vêtu de blanc, installé dans une villa royale dressée au cœur de Savane Chaude, et qui n’arrêtait pas de scintiller dans les méandres de la pauvreté exténuante. Cet aristocrate avait élu domicile dans ce lieu bizarre qui ressemblait pourtant à un petit morceau de l’enfer. Gisèle et Capois n’arrivaient même pas à rembourser les prêts qu’ils avaient contractés. Et puis un jour, par miracle du ciel, Capois rencontra M. Thermitus, un grand propriétaire terrien lui aussi, un mulâtre dans la soixantaine avancée, aux cheveux de couleur rousse, bien ondulés, le nez pointu comme une pique de glace, un peu grassouillet, les yeux marron, la bouche plate, surmontée d’une fine moustache, qui était venu assister aux funérailles d’un paysan décapité par un concubin jaloux qui l’avait soupçonné d’avoir séduit sa « femme-jardin [13]». Ce fut Espérandieu, le cousin du défunt, qui avait présenté Capois à M. Thermitus. C’était comme cela que Capois put obtenir ce petit lopin de terre pour lequel il avait bourriqué durant dix-neuf ans. Au début, ils s’en tiraient plus ou moins à bon compte. Les difficultés avaient commencé vraiment à surgir lorsque les américains du Nord prirent possession du pays et astreignirent les paysans à la « corvée », c’est-à-dire aux travaux forcés.
Tante Gisèle avait appris à sa petite nièce à coiffer les cheveux secs et crépus de la misère, à faire des tresses de résistance et de résignation à la pauvreté, pour qu’elle ne succombât point aux tentations qui pouvaient l’aveulir et l’entraîner sur le terrain du déshonneur et de l’avilissement. Dès l’aurore, elle se tenait déjà sur ses petites jambes… Elle laboura la terre, planta quelques légumes, sema des grains de petit mil, de maïs, pour essayer de survivre dans un paysage austère, maltraité par les longues périodes de sécheresse… L’adolescente vécut dans sa solitude durant une année et demie, sans avoir jamais pensé à abandonner la vieille chaumière à l’odeur d’indisposition qu’elle avait partagée avec la tante de son père, et qui demeura le témoin silencieux des vicissitudes de leur existence morne… Sans saveur. Enfin, sans rien… Rien qui eût été ici digne de mention, sans avoir couru soi-même le risque de soulever l’émotion et d’arracher quelques larmes aux cœurs sensibles. Elle allait couper du bois dans la forêt, ramasser des brindilles au pied de la colline pour allumer le feu de cuisson. La nuit, elle se recroquevillait sur le paillasson dur et tremblait de peur en pensant aux loups-garous qui se déplaçaient, aux dires des habitants, à minuit dans le village. Et quand elle entendait les battements des tambours qui se rapprochaient de plus en plus de la maisonnette que la clarté de lune perçait et traversait sans effort, elle fermait les yeux très fort et récitait la seule « prière » qui lui venait à l’esprit dans un moment pareil, celle qu’elle avait retenue de la bouche du « père de savane », Augustin Levaillant, qui conduisait les neuvaines, chantait le libéra des morts, célébrait les mariages, baptisait les enfants… à travers toute la vallée.
« Notre peure qui vous êtes aux cié,
Que votré lon soit sancdifeu!
Que votré reil viel…
Donneu-nous notré pain quotudian…
Né nous leussez pas siccombeu à la tentation…
Délivreu-nous di mal…
Amen! »
C’est peut-être parce que les paysans étaient incapables de prononcer les mots justes des prières… que leurs vœux ne fussent jamais exaucés!
Le poète Jacques Prévert nous avait habitués lui-même à prier différemment. « Notre père qui êtes aux cieux, restez-y ! », s’exclamait l’homme de Lettre des îles Baladar, de Paroles et Des Bêtes, sous les soubresauts provoqués par des moments libertins de délires avisés… Le Ciel aux croyants, la Terre aux impies. Difficile pour Francesca de savoir elle-même comment débroussailler toutes ces doctrines envahissantes dont elle ignorait formellement le fondement et l’existence, pour dénicher un drageon de valeurs religieuses sur lequel elle aurait pu véritablement accrocher en son âme et conscience sa piété pubère. Alors, sa foi flottait, oscillait entre la peur, le doute, l’incertitude, l’ignorance… Entre l’esprit débonnaire d’un Christ Rédempteur, les sentiments de méchanceté incomparable d’un Lucifer vaniteux et rusé, et les fantasmagories d’une mythologie africaine envoûtante.
Ti Jésus continua à intercéder auprès des loas vaudou pour les supplier de se porter au secours de la paysanne affolée, persécutée, décontenancée. Impossible de déterminer dans quelle langue le « houngan » baragouinait les supplications rituelles; tantôt cela ressemblait à du latin, tantôt à du grec, de l’allemand, du russe, du chinois, de l’hébreu, de l’arabe… Sa voix devenait grave, suffocante et émettait un son désagréable de fer-blanc que des gamins turbulents se seraient amusés à froisser…
« Papa Danbala
Francesca vous réclame
Les arbres n’ont plus de feuillages
Les rivières sont desséchées
Les malheurs ravagent le cœur
De votre fidèle servante
Comme les termites
Rongent les bois des galetas
Erzulie aux yeux rouges
Prenez la défense de cette pauvre femme
Qui réclame votre pitié et votre assistance
Montrez-lui le chemin de la délivrance
Chassez les mauvais esprits
Qui envoûtent le corps malade
De son homme handicapé
Serviteur zélé des mystères du Bénin…»
Mais Francesca n’entendait plus la voix éraillée de Ti Jésus. Elle était complètement enfoncée, perdue dans la forêt désenchantée de son enfance, en train de faire le trajet raviné de sa vie hachurée en marche arrière…
Si Édouard ne l’avait pas chassée de l’habitation de tante Gisèle, Francesca ne serait jamais retournée à La Roche. Et probablement, elle n’aurait pas rencontré Lebon. Elle répétait souvent aux voisins : « À quelque chose, malheur est bon…! » C’était ce jeune homme courageux, franc, sincère et laborieux qui lui avait redonné le « gustum vitae [14]». Édouard avait menti à sa tante mourante à qui elle avait pourtant donné sa parole. Et puis, ce n’était pas une question de faveur. Capois avait payé de son sang et de sa sueur le petit lopin de terre sur lequel il s’était installé avec Gisèle et les enfants, avant de partir rejoindre les cacos aux fronts.
Les scènes d’horreur de ce matin-là étaient encore toutes fraîches dans la mémoire de Francesca. Elle vécut un véritable cauchemar. Thermitus était arrivé très tôt à Savane Chaude, sur son cheval blanc. Le reste de la nuit retenait encore le soleil prisonnier des nuages gris. La journée allait se noyer dans les eaux pluviales. Et vraisemblablement les gouttes n’allaient pas tarder à se détacher du ciel pour matraquer les terres assoiffées du village. La jeune fille était arrivée finalement à surmonter la peur de la solitude avec le début de l’éclaircissement de la nuit, et la fatigue profonde l’avait vite transportée au royaume du fils d’Hypnos et de Nyx. Son ronflement s’infiltrait par les fissures de la vieille fenêtre pour se mélanger aux sons mélodieux des vents au cours de leur passage à travers les feuillages touffus des arbres encore endormis. Édouard souleva la porte du taudis, la referma derrière elle et se jeta sur la petite fille. Il posa une main sur sa bouche, et de l’autre souleva la petite jupe qui protégeait son intimité et commença à la violer sauvagement. L’enfant se débattit de son mieux. Francesca ne comprenait même pas pourquoi M. Édouard, comme elle avait l’habitude de l’appeler, lorsqu’elle allait l’annoncer à sa tante, était en train de lui faire du mal. Le sauvage s’enfonçait en elle avec rage, folie et obsession. Elle avait le feu au bas du ventre. Et lui, le monstre, était grisé de plaisir, hurlait, bégayait, crachait le venin des insanités… Le psychopathe avait choisi son heure pour accomplir son odieux forfait. L’enfant perdit connaissance. C’était dans cet état presque comateux que la vieille Christine l’avait découverte dans le vieux lit de tante Gisèle où le « bourreau de Savane Chaude » venait de la crucifier.
La voix de l’Ati de Phaéton continua de héler les loas qui ne se manifestaient toujours pas… Mauvais signe, en vérité…!
« Mystères de Guinée…
Pitié pour nous!
Pitié pour la servante!
Francesca vous réclame…
Pitié Papa Dambalawèdo!
Ô Vierge d’amour!
Ô Erzulie Dantor!
Venez au secours
De la femme en détresse.
Pardon papa,
Nous sommes dans le besoin… »
Papa Dambalawèdo, Erzulie Dantor, enfin la horde des « mystères » au grand complet avait boudé les appels répétés du houngan. Ils avaient refusé de se manifester… Ti Jésus avala une gorgée de clairin clair mélangé à des feuilles d’arbres, le tout conservé dans une bouteille noire. Le « bokor » paraissait contrarié. Il se baissa solennellement pour empoigner les onze gourdes et les dix-sept centimes dans l’assiette émaillée d’une blancheur sale. Il plissa son front, cligna des yeux, fronça ses sourcils, retroussa ses lèvres épaisses qui formaient avec le mouvement raidissant de sa bouche une fine fente où l’on pouvait entrevoir ses dents rougeâtres. Le « houngan » déposa les pièces de monnaie qui devaient payer la « leçon [15] » dans les mains moites de Francesca. La chaleur qui se dégageait de la chaumière était insupportable. Les yeux de Pauline sortaient de leurs orbites. Chaque œil ressemblait à un grand cercle lunaire plaqué sur la nappe grisâtre d’un ciel blêmi, masqué par des nuages mobiles. Celle-ci savait dans son for intérieur ce que le « médium » voulait exprimer comme message par la succession des gestes lents, calculés, presque robotisés. Ti Jésus essaya de reprendre son calme. Le « maître sorcier » parla d’un air grave. Son langage fut submergé de confusion, de mysticité, d’herméticité…
– Madame Francesca, je vous parle oui… Je vous parle au nom du Roi des rois, Celui qui règne dans les airs, sur la terre, sur la mer, sous les eaux des rivières, des étangs et des fleuves… Je prête ma bouche aux « Esprits de Dahomey » afin qu’ils puissent vous transmettre le message que vous êtes venue chercher pour la délivrance de votre homme. Que ce soit bien, que ce soit mal, c’est le « Mbamawu » qui décide… Oh, oh, Francesca, je vous dis foutre, je vous dis tonnerre de Brest, vers de terre que nous sommes, personne ne peut éviter la route de son destin. Elle est tracée avant la naissance même. La vôtre aussi, Francesca… La vôtre aussi est devant vous…! Elle indique le commencement et elle marque la fin… La fin de votre voyage, avant de traverser [16], pour rejoindre le royaume d’Alada [17]… Les mortels n’ont pas le pouvoir de détourner leur marche du chemin de leur destinée. Pas même de se reposer un moment, pour reprendre un peu de leur souffle. Marcher sans cesse, escalader les monts et traverser les vallées, sous le soleil, sous la pluie, sous le vent, voilà le lot des fourmis de terre que nous sommes devant la « Grandeur » de Celui qui s’est fait lui-même « le plus Grand » de tous. La souffrance, la maladie, la joie éphémère, la tristesse, le chagrin, la faim, la pauvreté, la richesse, voilà l’héritage auquel les femmes et les hommes sont soumis dès leur naissance! Oh, Francesca, Lui seul règne dans les airs, sur la terre, sur la mer, sous les eaux… Lui seul a le pouvoir de faire lever le jour, de répandre les ténèbres, de donner ou d’enlever la vie, d’arrêter le soleil dans sa course, de faire tomber la pluie sur les plantes, de ramener le beau temps, de dire oui ou non à jamais, de ressusciter de la mort… Francesca, foutre, je vous parle au nom de Celui qui transmet la « vérité absolue » par ma bouche indigne. Vous avez porté dans vos entrailles dévastées le glaive et la foudre de la guerre. Vous personnifiez la douceur et la force. Ô femme des douleurs, vous êtes la « sagesse » qui fera lever le vent de l’espérance… Je vois des oiseaux de feu qui survolent le firmament embrouillé. Je vois un cimetière. Une foule de gens. La mer. La police. Puis un homme mystérieux venu des profondeurs des eaux. Un miracle. Le miracle de la vie. Le corps d’une dame ressuscitée. Régénérée. Je vois le soleil s’installer à la place des ténèbres. Le bonheur recouvrir le champ des malheurs. Une vieille dame rajeunie. La renaissance d’un village. De l’eau qui coule en abondance pour noyer la sécheresse. Ô Francesca, J’entends des chants de consolation. Une multitude de voix qui racontent une histoire de réconciliation, après avoir fait couler le sang des impurs et des traîtres. Je perçois des foules lâchées à la poursuite des « esprits malfaisants », et qui les détruisent comme les paysans arrachent et brûlent l’ivraie. Enfin, des pleurs de souffrances noyés dans des larmes de joie…! Je contemple les sept couleurs de l’arc-en-ciel dans un ciel qui s’éclaircit graduellement, pour laisser finalement apparaître le soleil régénérateur et rassembleur… Francesca, écoutez avec moi le glapissement des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards qui arrivent des quatre coins du monde, et qui chantent tous en chœur l’hymne joyeux et solennel du retour dans la patrie de leurs aïeux… Ils ont traversé les rivières, survolé les nuages, coupé dans le désert, marché comme des pèlerins pour se rencontrer à la croisée de l’histoire… Francesca, les « Mystères » vous libèrent… Partez! Et surtout ne vous retournez pas pour regarder en arrière, jusqu’à ce que vous franchissiez les barrières de votre habitation! Évitez de contrarier la volonté des « Esprits ». Prenez cette chandelle noire, apportez-la avec vous, tout au cours du chemin, vous adresserez vos prières à Saint Jean le Baptiste, et après avoir traversé la troisième passe d’eau, vous allumerez la mèche, si elle tient la flamme jusqu’aux portes de votre case, c’est l’indice d’une bonne nouvelle, si au contraire elle s’éteint en cours de route, c’est une mauvaise nouvelle qui vous attend, mais tout cela ne doit pas vous effrayer, car de tous les temps, comprenez bien, ce qui est, fut… pour le bonheur et pour le malheur, pour la joie et pour la tristesse, pour la vie et pour la mort! Francesca, ma fille, en vous sont incarnés l’ancien et le nouveau. C’est par vous que tout cela s’accomplira ! Par vous et en vous, dis-je, en vous seule et par vous seule…! Loko [18], le chef des guérisseurs, celui qui règne sur les plantes, l’époux d’Ayizan, prendra le chemin devant vous. Ayibobo [20] !
Robert Lodimus
(Prochain extrait : Le décès)
***
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre I
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre II
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre III
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre IV
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre V
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitres VI & VII
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitres VII & VIII
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitres IX & X
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre XI
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre XII
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre XIII
