— Par Robert Lodimus —
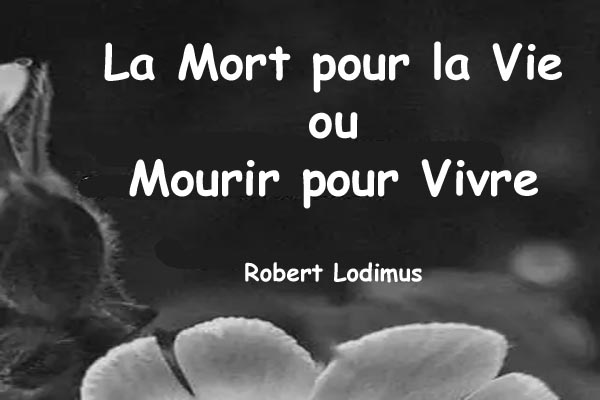 Chapitre XII
Chapitre XII
LA DISPARITION
« La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l’affirme,
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte,
Une fenêtre éclairée,
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler, Faim à satisfaire,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager. »
(Paul Éluard, La vie n’est jamais complète)
Le métèque dévisagea en silence, longuement, le macchabée qui venait de s’enfoncer quelque part dans les dédales de la dormition perpétuelle. On pouvait ânonner dans le livre de son existence misérable les marques indélébiles des souffrances que la « Création » lui infligea. La sénescence due au phénomène de vieillissement précoce avait estampillé son âme éprouvée. Francesca n’était pourtant pas rassasiée de jours. C’étaient les ciseaux des chagrins du malvivre qui avaient, depuis l’adolescence, sculpté prématurément l’adynamie sur son corps avachi et affaibli les muscles essentiels qui auraient permis à ses fonctions vitales – contrairement à « Rossinante », le canasson de Don Quichotte – d’aller à l’amble.
L’agent de chambre mortuaire n’avait pas voulu laisser l’inconnu pénétrer dans la grande salle pénombreuse, aiguayée dans une odeur forte de cadavres, malgré les opérations fréquentes de désinfection de l’air avec des produits parfumés et par le brûlage de l’encens. Quelques individus, des corps inertes d’enfants, de femmes et d’hommes, étaient encore sanglés sur des brancards posés à même le sol cimenté, attendant d’être rangés dans les cellules réfrigérantes. Plusieurs dépouilles, à en juger par la sérénité qui englobait leur visage et la souplesse qui édulcorait leur chair, laissaient deviner que les regrettés disparus venaient tout juste de faire le saut inévitable et ultime dans le monde immatériel… L’homme insista, prétextant qu’il s’agissait d’une parente proche qui s’était occupée de lui à son jeune âge, et qu’il était venu lui rendre un dernier hommage bien mérité. Le coordonnateur du pavillon funèbre prit quelque temps pour visser son menton, puis obtempéra. L’homme lui laissa aussitôt entendre que, comme dans les Écritures sacrées, la mort allait donner naissance aujourd’hui à une « nouvelle vie ».
«– Dans quelques minutes, poursuivit-il, un évènement inimaginable va se produire sous vos yeux… Longtemps encore, les humains continueront d’en parler dans les contes oraux et dans les livres d’histoire…. Mais cela ne devra pas être vu et compris comme un « miracle »; c’est la volonté du « Grand Invisible » qui s’accomplira devant vous… »
*
* *
Le soleil montait dans le ciel. La chaleur du mois de mai plombait le village accablé, morne, rivé dans son état de prostration. Le vent avait déserté les plantes et leurs feuillages un peu brouis, en dépit de l’arrivée nouvelle de l’époque du débourrement. Le printemps, s’il aurait fallu encore l’appeler de cette manière, arriva sur la pointe des pieds, sans se faire remarquer. Aucun bouleversement climatique ne marqua la transition saisonnière. Nous étions avant tout au pays de l’été sempiternel. Les terres sèches et alcalines de La Roche fondaient comme certains métaux sous les chalumeaux soudeurs. Toutes les récoltes étaient compromises. Les Rochois coupaient les arbres pour fabriquer du charbon que leurs compagnes se chargeaient de vendre dans les marchés publics environnants, ne serait-ce que pour apporter des semoules de maïs, du savon et du kérosène à la maison.
Ce matin-là, Lebon était parti tôt dans les halliers pour assembler le bois qui se raréfiait dans la région. Il en tirait tous les jours des gaillettes de charbon, en le brûlant sous des mottes de terre empilées les unes sur les autres. Francesca, de son côté, était allée chercher de l’eau à une source qui suintait sans arrêt au pied de la montagne. Une chance que la sécheresse endémique ne l’avait pas tarie, sinon le village entier aurait crevé de soif. Le prochain point d’eau se trouvait au moins à une dizaine de kilomètres. Au retour, la surprise attendait Francesca. Le petit Sauveur avait disparu sans laisser de traces. Les villageois organisèrent une battue pour essayer de retrouver le gamin de deux ans. Ils se repartirent en petit groupe, fouillèrent toute la zone, ratissèrent les fonds des falaises, mais le petit Sauveur n’avait pas répondu à l’appel. Lebon était bouleversé. Il avait du mal à pardonner à sa compagne. « Une légèreté, une négligence blâmable », répétait-il, en se grinçant les dents. Francesca expliqua plusieurs fois à son homme qu’elle pensait avoir le temps de revenir avant que le gosse se réveillât. Et puis, ce ne fut pas la première fois qu’il lui était arrivé de profiter du sommeil de son fils pour aller remplir ses calebasses à la « Source des amoureux », qui devait son nom à une belle histoire d’amour entre un colon de vingt-cinq ans et une jeune esclave de dix-neuf ans. Ils s’étaient rencontrés pour la première fois, selon la légende, à cet endroit où l’eau limpide prit sa source dans la montagne. L’homme était le fils d’un riche propriétaire terrien, un sexagénaire français qui possédait de vastes plantations de café, de cacao et de tabac, sur lesquelles trimaient des esclaves africains presque sans récréation. La jeune femme scintillait de sa beauté hellénique. Le Parisien tomba tout de suite sous les charmes angéliques d’Idala. Légèrement vêtue sous le soleil doux d’un bel après-midi d’été, elle avançait solennellement, lançant ses hanches de gauche à droite – à la manière des top-modèles – sur le sentier bordé de fleurs d’hibiscus, de roses rouges et blanches, de lilas…, avec une élégance princière qui rappelait les grandes stars féminines du cinéma de la nouvelle vague. Son sourire envoûtant découvrait une denture de blancheur éclatante. Idala avait appris la langue de Racine, en suivant les conversations de ses maîtres. Elle lisait couramment et écrivait sans trop de difficulté. Son père, esclave lui-même, ancien souverain d’une tribu africaine, avait été capturé et vendu avec sa famille dans l’île de Saint-Domingue. Diderot de Libertat était étudiant de troisième année en médecine à la Sorbonne, et vivait avec ses grands-parents en France. Il était venu pour la première fois passer les vacances d’été avec son père et sa mère, le duc Alphonse de Libertat et la duchesse Géraldine de Libertat qui, eux-mêmes, demeuraient dans la colonie. Diderot n’avait pas pu résister à l’envie d’aborder la jeune esclave. Il descendit de cheval et se mit à la courtiser séance tenante. Idala succomba aussitôt sous le charme envoûtant du jeune Européen, qu’elle avait eu l’occasion d’observer quelquefois, son buste dressé de la même façon que celui d’Alexandre le Grand juché sur Bucéphale. Les mots galants, qui dévalaient en cascade de la bouche du soupirant audacieux, faisaient tournoyer le paysage hilare sous ses yeux stupéfiés, paniqués même, et déjà conquis. Les courants de frissons qui traversaient le corps du futur Hippocrate trahissaient également des désirs mal dissimulés, mais bien intentionnés. Ses paroles transpiraient au travers d’une poétique aphrodisiaque. Idala répondit par un sourire érotique et un regard enfiévré d’envie et de passion. Aux compliments que lui avait faits Diderot, elle réagissait timidement, avec des pincements de lèvres qui trahissaient le fond de ses pensées subitement affadies. Sans la moindre hésitation – on aurait même dit qu’il la connaissait depuis toujours – le Lancelot de la colonie française se pencha légèrement sur sa Guenièvre de l’Afrique, la prit par les deux épaules et déposa sur ses lèvres pures et vierges le premier baiser d’un homme profondément et réellement épris d’amour… Diderot la coucha tendrement dans l’herbe fine et docile, la déshabilla, prit ses seins délicats dans ses mains tremblantes, couvrit son corps de baisers magnétiques, électrisants, frictionnés avec une concoction mystique de désirs sexuels, pour finalement assauter son intimité conservée avec précaution, et surtout protégée jalousement, durant toutes ces années, contre les élans pervers de la rapacité masculine. Ce fut dans cette position de flagrance stupéfaite qu’Alphonse, le père de Diderot, surprit son fils, le « dépuceleur » fiévreux, tremblant, et sa « victime » séraphique, immaculée, flottant dans une bulle de soupirs consentants et partagés. Les spasmes de jouissance des tourtereaux devinrent des lancinations de douceur immaîtrisables, des sursauts de sensation incontrôlables. Le tonnerre gronda. Les oiseaux abandonnèrent leurs branches de perchage et les crissements de leurs ailes propulsées par l’air d’affolement vampirisèrent la nature ordinairement pittoresque et apaisante. Alphonse se mettait à rugir comme un lion blessé… À cracher du feu comme un dragon dans un péplum…
– Diderot, vous avez déshonoré ma maison et dégradé la fiancée de votre rang, Madame la duchesse Bérengère de Ferdinand, avec une « sale négresse… » Vous êtes indigne de porter le nom de Libertat. Vous n’êtes même pas digne de continuer à respirer l’air de la noblesse parisienne. Vos yeux doivent cesser de voir les rayons du soleil, de contempler la lumière de la lune, d’observer les scintillements des étoiles dans le firmament… Vous êtes l’opprobre de notre famille…!
– Laissez-moi vous expliquer père…! Idala et moi, nous nous sommes rencontrés en ces lieux par hasard. C’est l’effet d’un coup de foudre, je l’aime vraiment… Pardonnez-moi, père, je…
– Ingrat! Je ne veux plus vous écouter…!
Indigné, courroucé, blessé dans sa jactance de riche et son immodestie de noble, Alphonse dégaina ses armes et abattit froidement Diderot et Idala. Il rejoignit sa monture blanche, prit la pelle attachée au troussequin, creusa une fosse commune et inhuma les deux jeunes gens à l’endroit même où il les avait surpris en pleins ébats sexuels. Rentré chez lui, le meurtrier ordonna à ses domestiques de lui amener le père, la mère d’Idala, ainsi que le grand frère et la sœur cadette. Il les fit attacher à des arbres et les transperça de plombs mortellement. Le sang qui coula sur leur poitrine arrosa la terre ébranlée.
Après quelques mois, une source d’eau douce, claire et limpide perça dans la montagne, à quelques centimètres de l’emplacement sépulcral où gisaient les deux cadavres. Les habitants qui étaient au courant du récit légendaire le baptisèrent « Source des amoureux »…
Plus tard, ce fut Miracia, la vieille gouvernante noire qui éventa la mèche de l’affaire Diderot et Idala, ainsi que celle du suicide d’Alphonse. Le père assassin ne survécut que quelques heures après le sextuple meurtre. Le coup de pistolet était parti dans sa chambre, alors qu’on emportait les corps des parents d’Idala pour les enterrer quelque part, sous les caféiers ombragés par les ormes… Les cris perçants de son épouse Géraldine ameutèrent toute l’habitation. Elle-même avait échappé de peu à la funeste tragédie. La pauvre duchesse, devenue complètement folle, psychotique, quitta l’existence terrestre dans la tourmente, après avoir rendu son dernier souffle dans un hôpital psychiatrique implanté dans une banlieue de Paris.
La vieille Miracia avait fini par révéler que c’était la jalousie qui avait démonisé le « magnat des plantations ». M. Alphonse ne pouvait pas supporter l’idée de voir Idala tomber sous l’emprise des pulsions libidinales de quelqu’un d’autre, même s’il s’agissait de son fils unique, alors que celle-ci résistait à toutes ses avances. Il avait même juré de tuer un jour celui qui aurait osé toucher l’« objet sacré de sa convoitise charnelle ». Cinq fois, le colon maniaque, rogue et irascible, en l’absence de la comtesse, avait essayé d’entraîner Idala dans sa chambre pour la maculer contre son gré, mais la jeune femme était toujours arrivée à se défaire des étreintes de son bourreau, et à échapper à la honte et au déshonneur. Il la menaçait même de la faire flageller toute nue sous le soleil et de la vendre au marché des esclaves, pour attiser ses souffrances et ses chagrins. Le goujat obsédé aurait ainsi séparé la jeune femme des membres de sa famille, qui seraient demeurés eux-mêmes captifs dans ses cannaies et dans sa guildiverie. Ce fut vraiment une crise de colère et de jalousie qui avait poussé Alphonse à assassiner son unique fils Diderot, la virginale Idala et ses parents, pour s’enlever ensuite la vie.
Robert Lodimus
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre, roman
(Prochain extrait : Les échanges)
***
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre I
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre II
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre III
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre IV
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre V
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitres VI & VII
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitres VII & VIII
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitres IX & X
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre XI
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre XII
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre : Chapitre XIII
