Un entretien de A. Jacquard et J-B Pontalis
 Albert Jacquard – Pour moi c’était évident, au moment où nous préparions le premier numéro du Genre humain, il fallait le consacrer à La science face au racisme. On y admettait, a priori, que le racisme est une tare. A l’époque, il me semblait clair que, pour lutter contre le racisme, comme contre n’importe quoi, contre le diable en général, la meilleure arme, c’est la science. Pourquoi? Parce que la science est ce merveilleux effort de l’homme pour se mettre en accord avec l’univers, pour voir clair en lui, pour être cohérent, rigoureux, lucide… Et puis, grâce à la biologie, on apportait avec le constat de l’impossibilité d’une définition de races humaines, un argument décisif. C’était sans doute prétentieux. En fait, grâce à la biologie, moi le généticien, je croyais permettre aux gens de voir plus clair en leur disant: «Une race, vous en parlez, mais de quoi s’agit-il?» Et je leur montrais qu’on ne peut pas la définir sans arbitraire ni sans ambiguïté. Cette démarche s’apparente aux théorèmes les plus fondamentaux, ceux qui démontrent qu’une question est mal posée, que telle affirmation est indécidable. Autrement dit, le concept de «race» n’est pas fondé et par conséquent le racisme doit disparaître. Il y a quelques années, j’aurais admis qu’ayant énoncé cela, j’avais bien fait mon travail de scientifique et de citoyen. Et pourtant, s’il n’y a pas de «races», le racisme existe bel et bien! N’y aurait-il en France que des gens ayant tous la même forme de nez, la même forme d’yeux, la même couleur de peau, qu’il y aurait encore des attitudes racistes du type: «Ces gens-là ne sont pas comme nous, ils ne sont pas comme moi. » Il ne s’agirait plus du critère de la couleur de la peau, de la forme du crâne ou du nez. On choisirait n’importe quel critère et on constituerait un groupe cohérent marqué par une caractéristique le particularisant. S’il n’y a pas de races, on en invente pour pouvoir justifier un mépris. Comme si on avait toujours besoin de mépriser, comme si c’était un besoin profond. Arrivé à ce point, je suis amené à me dire: «Moi, bien sûr, je ne suis pas raciste, pourtant, est-ce que je n’ai pas, moi aussi, besoin de mépriser?» Quand je m’interroge sur la façon dont je me suis fait, je m’aperçois que ce qui m’a «fait» le plus, c’est ce qui m’a fait mal, et que parmi les choses qui m’ont fait mal, il y en. a beaucoup qui ont sécrété en moi un besoin de mépris.
Albert Jacquard – Pour moi c’était évident, au moment où nous préparions le premier numéro du Genre humain, il fallait le consacrer à La science face au racisme. On y admettait, a priori, que le racisme est une tare. A l’époque, il me semblait clair que, pour lutter contre le racisme, comme contre n’importe quoi, contre le diable en général, la meilleure arme, c’est la science. Pourquoi? Parce que la science est ce merveilleux effort de l’homme pour se mettre en accord avec l’univers, pour voir clair en lui, pour être cohérent, rigoureux, lucide… Et puis, grâce à la biologie, on apportait avec le constat de l’impossibilité d’une définition de races humaines, un argument décisif. C’était sans doute prétentieux. En fait, grâce à la biologie, moi le généticien, je croyais permettre aux gens de voir plus clair en leur disant: «Une race, vous en parlez, mais de quoi s’agit-il?» Et je leur montrais qu’on ne peut pas la définir sans arbitraire ni sans ambiguïté. Cette démarche s’apparente aux théorèmes les plus fondamentaux, ceux qui démontrent qu’une question est mal posée, que telle affirmation est indécidable. Autrement dit, le concept de «race» n’est pas fondé et par conséquent le racisme doit disparaître. Il y a quelques années, j’aurais admis qu’ayant énoncé cela, j’avais bien fait mon travail de scientifique et de citoyen. Et pourtant, s’il n’y a pas de «races», le racisme existe bel et bien! N’y aurait-il en France que des gens ayant tous la même forme de nez, la même forme d’yeux, la même couleur de peau, qu’il y aurait encore des attitudes racistes du type: «Ces gens-là ne sont pas comme nous, ils ne sont pas comme moi. » Il ne s’agirait plus du critère de la couleur de la peau, de la forme du crâne ou du nez. On choisirait n’importe quel critère et on constituerait un groupe cohérent marqué par une caractéristique le particularisant. S’il n’y a pas de races, on en invente pour pouvoir justifier un mépris. Comme si on avait toujours besoin de mépriser, comme si c’était un besoin profond. Arrivé à ce point, je suis amené à me dire: «Moi, bien sûr, je ne suis pas raciste, pourtant, est-ce que je n’ai pas, moi aussi, besoin de mépriser?» Quand je m’interroge sur la façon dont je me suis fait, je m’aperçois que ce qui m’a «fait» le plus, c’est ce qui m’a fait mal, et que parmi les choses qui m’ont fait mal, il y en. a beaucoup qui ont sécrété en moi un besoin de mépris.
Jean-Bertrand Pontalis – Vous dites avoir eu trop de confiance dans l’efficacité de votre travail de scientifique. Je ne pense pas que vous étiez aussi naïf, à l’époque, que vous le dites. Jamais une passion ne cède à une argumentation, aussi irréfutable qu’elle puisse être, jamais même elle ne cède devant les faits, aussi probants qu’ils soient, jamais des savoirs n’ont raison d’une conviction. Je ne crois pas non plus que vous deviez vous montrer aujourd’hui désenchanté à ce point. Cela me paraît important en effet que le racisme ne puisse plus se réclamer de la science. Le racisme comme fait demeure mais comme doctrine il est mort, et il est mort en partie sous les coups que les scientifiques, en particulier les généticiens – mais n’oublions pas les ethnologues -, lui ont portés. Un discours sur l’inégalité des races comme celui de Gobineau n’est plus tenable, du moins à voix haute. C’est un acquis. Ne perdez donc pas courage… Ce qui me trouble davantage, et là je vous rejoins, c’est que nous connaissons relativement bien les mécanismes du racisme et que nous restons pourtant sans prise sur lui, sur son éclosion, sur son développement. Nous en connaissons les mécanismes sociaux – les conditions économiques, politiques qui en facilitent l’émergence -, nous croyons en déceler les ressorts psychologiques. On a beau savoir qu’il ne suffit pas d’avoir défini les déterminants d’un phénomène pour s’en rendre maître, surtout quand il s’agit de phénomènes humains, on n’en est pas moins à chaque fois décontenancé devant la récurrence du racisme. Pourquoi la récusation scientifique, pourquoi la condamnation morale, pourquoi les innombrables analyses qu’on en a données ne portent-elles pas davantage?
Deuxième point: vous mettez l’accent sur le mépris, sur le besoin de mépriser auquel le racisme, entre autres, fournirait une issue sur mesure. Certainement, dans le racisme, il entre du mépris’ plus ou moins avoué, envers un autre groupe humain. Mais je n’y verrais pas une réaction première, je la placerais plutôt au bout de la-chaîne. Ce qui me paraît premier, c’est l’effroi devant l’étranger, la xénophobie au sens littéral. Mais il faut tout de suite nuancer: cet effroi est une fascination, donc aussi une attirance. Et tout de suite corriger: cet étranger n’est pas n’importe quel étranger, il ne provoque un sentiment d’étrangeté que parce qu’il est aussi mon semblable. Les psychologues ont décrit ce qu’ils ont appelé l’angoisse du huitième mois, celle qui saisit l’enfant quand un visage qui n’est pas celui de sa mère ou d’une personne de son entourage s’approche du sien. On peut faire l’hypothèse que ce visage est perçu, non dans sa singularité, mais simplement comme n’étant pas celui de la mère. Or, cette angoisse, qui peut aller jusqu’à la panique, l’enfant né la manifeste pas devant un «objet» qui diffère bien plus du visage maternel qu’un autre visage humain, devant un animal par, exemple autre est
Quand donc intervient l’angoisse devant l’étranger? Quand l’autre est à la fois semblable et différent.’ C’est pourquoi je tiens pour fausse tout cas pour incomplète, l’idée admise selon laquelle le racisme témoignerait d’un refus radical « de l’autre, d’une intolérance foncière aux différences, etc. Contrairement à ce que l’on croit, l’image du semblable, du double, est infiniment plus troublante que c elle de l’autre. Voyez les films d’horreur: ils ne sont opérants que s’ils nous mettent en présence de monstres humains, d’êtres qui pourraient être nous et qui ne nous paraissent difformes que parce qu’ils ont presque notre forme. Nous faisons tous cette expérience a minima quand nous apercevons sans le vouloir, en marchant dans une rue, notre reflet sur la vitre d’un magasin: «C’est moi, ça? » Un moi qui est un autre. Je ne peux nier que ce soit moi et, pourtant, je ne me reconnais pas dans cette image.
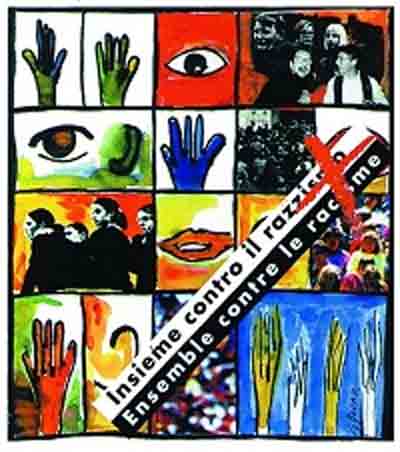 A. Jacquard – Savoir qu’il est autre et ne pas être sûr de pouvoir le distinguer de moi? C’est ce «flou» qui serait pour vous au départ. Mais on est loin du racisme qui aboutit à des haines, à des destructions.
A. Jacquard – Savoir qu’il est autre et ne pas être sûr de pouvoir le distinguer de moi? C’est ce «flou» qui serait pour vous au départ. Mais on est loin du racisme qui aboutit à des haines, à des destructions.
J.-B. Pontalis – A mon avis, c’est là le début du processus. C’est’ l’expérience que je situerais au point de départ. A l’autre bout, on aura non seulement le mépris et la haine, mais la destruction réelle.
A. Jacquard – Mais ce que vous décrivez, c’est purement individuel. C’est un individu qui me fait cet effet-là, alors que dans le racisme, il y a une collectivisation de cette peur. Il faut que ce soit tout l’ensemble des x qui me crée cette peur.
J.-B. Pontalis – J’ai pris cet exemple chez l’individu mais sans en inférer une généralisation qui se propagerait d’individu à individu pour devenir un phénomène collectif. Je pense cependant qu’on trouverait au plan collectif l’équivalent de ce phénomène du miroir qui me renvoie une image à la fois semblable et pas semblable.
A. Jacquard – Donc, il faut commencer par définir «mon groupe», «ma race».
J.-B. Pontalis – Un groupe se définit, peut-être – on –se pose en s’opposant – dans ce moment où il rencontre un semblabie-dissemblable. Prenons un exemple simple: quand voit-on surgir des phénomènes racistes? Presque toujours quand un groupe est menacé, ou se sent menacé, par un groupe voisin qui pourrait lui prendre sa place ou lui faire perdre ce qu’il perçoit comme ses privilèges. Généralement dans une situation de crise où l’identité d’un groupe est moins assurée, et c’est alors qu’il va dénoncer comme responsable de cette crise le groupe voisin. Actuellement, en France, du fait du chômage réel ou virtuel, le phénomène raciste est de nouveau actif, d’autant que certains politiciens s’entendent à l’exploiter, en commençant, bien entendu, par proclamer: «Je ne suis pas raciste, mais quand même… Trouvez-vous normal que vous, Français, soyez privés d’emploi alors que les immigrés en ont un? » Sous-entendu: ce sont eux qui vous en privent, qui vous le prennent. C’est ce racisme populaire qui est le plus difficile à extirper. C’est aussi celui qui nous laisse le plus démunis, nous autres intellectuels, dont l’identité n’est jamais uniquement sociale tandis qu’un ouvrier sans emploi, un petit commerçant contraint dé fermer boutique, ont le sentiment de n’être plus rien.
A. Jacquard – Dans cette défense contre ceux qui nous semblent menaçants, qui veulent prendre «notre territoire», il arrive que l’on se trompe complètement d’ennemis. En 1940, ce qui nous menaçait, c’était bien les Allemands. Ils étaient chez nous avec leurs troupes et leurs chars. On n’a pas dit «quelle mauvaise race». Il y avait, au contraire, une espèce de fascination pour des soldats si bien habillés, qui marchaient si bien au pas, et on s’est retourné contre les juifs et les francs-maçons. Or, ce n’était pas eux qui nous menaçaient.
Une fois encore, nous sommes devant le double constat d’une opposition entre les causes objectives d’un comportement et le contenu de ce comportement. J’en reviens à mon point de départ: pour la génétique contemporaine la notion de «race humaine» n’existe plus. Le racisme, lui, sévit. Comment comprendre?
 J.-B. Pontalis – Il y a une notion que nous n’avons pas encore évoquée. Elle a beau ne pas être neuve, elle me paraît toujours fournir une clé pour comprendre le phénomène raciste, tant chez l’individu que dans la collectivité, c’est la notion de projection. Le mot a deux sens qui peuvent d’ailleurs se rejoindre. Dans l’état amoureux, par exemple, je vais projeter dans le monde ambiant mon sentiment d’élévation, m’émerveiller d’un rien. A l’inverse, si je suis déprimé, tout me paraît, au mieux, indifférent, au pire une offense à ma douleur. On peut dire, dans les deux cas, que je projette, que je mets au dehors ma joie ou ma peine sans opérer de distinction stable entre moi et les autres.
J.-B. Pontalis – Il y a une notion que nous n’avons pas encore évoquée. Elle a beau ne pas être neuve, elle me paraît toujours fournir une clé pour comprendre le phénomène raciste, tant chez l’individu que dans la collectivité, c’est la notion de projection. Le mot a deux sens qui peuvent d’ailleurs se rejoindre. Dans l’état amoureux, par exemple, je vais projeter dans le monde ambiant mon sentiment d’élévation, m’émerveiller d’un rien. A l’inverse, si je suis déprimé, tout me paraît, au mieux, indifférent, au pire une offense à ma douleur. On peut dire, dans les deux cas, que je projette, que je mets au dehors ma joie ou ma peine sans opérer de distinction stable entre moi et les autres.
Et puis, il y a un sens plus radical de la projection: mettre au dehors ce que je ne veux ni ne puis admettre en moi, ce que je perçois comme mauvais, coupable, dangereux. Je le dépose en l’autre. C’est bien là ce qu’on observe dans les réactions racistes: «Ils investissent nos villes, ils prennent nos biens, ils violent nos femmes etc … » Ce que je pensais confusément comme «mauvais» en moi, comme excès possible de sexualité et d’agressivité, je l’attribue à l’autre qui devient le «mauvais objet», l’agent du Mal. On voit le «bénéfice» de l’opération. Tout ce qu’un individu refuse ou méconnaît en lui – la contradiction interne, la violence, le pulsionnel – il l’expulse hors de lui, il l’expulse dans l’autre. Et, finalement, c’est l’expulsion de l’autre, qui va du rapatriement dans le pays d’origine jusqu’à l’élimination physique en passant par l’enfermement.
A. Jacquard – C’est donc moins du mépris qu’une peur de soi. Mais, s’il n’y a pas de mépris, d’où vient, chez le raciste, ce besoin de dire: «Je suis supérieur à … ?»
J.-B. Pontalis – Mais ce qu’on expulse de soi, on ne peut que le mépriser, ou plutôt que vouloir le mépriser. Et la violence même de ce mépris ou de cette supériorité proclamée révèle qu’on attribue à l’autre une puissance extraordinaire.
Mais quelque chose me gêne dans notre discussion: en cherchant comme nous le faisons des motivations psychologiques au comportement raciste, ne sommes-nous pas en train de le comprendre, presque de le justifier? Nous humanisons la «bête immonde.»
A. Jacquard – Ce n’est pas justifier le racisme que tenter de l’expliquer.
J.-B. Pontalis – Admettons. Nous sommes donc partis de votre constat: les arguments scientifiques et la protestation morale sont sans effet sur le racisme. Démontrer que ça ne tient pas debout, en dénoncer l’ignominie n’empêchent pas que ça existe, que ça resurgit. Et même le racisme ose invoquer parfois, sinon des justifications scientifiques, du moins des «valeurs de civilisation. » Car il arrive que cette passion basse se donne des allures de noble cause, que la défense haineuse, crispée, des intérêts d’un groupe social se nomme «défense de l’Occident.»
Nous avons donc été amenés à comprendre cet état de fait. Au fond nous ne voulions pas nous décharger sur la personne du raciste du phénomène raciste, comme si nous répugnions à lui appliquer le traitement qu’il inflige aux autres, comme si c’était trop simple d’en faire à notre tour notre mauvais objet, notre bouc émissaire! D’où un retour sur nous-mêmes, d’où la question: «Où peut bien s’inscrire en chacun de nous l’origine d’un processus dont le racisme risque d’être le produit final?» Peut-être entre-t-il à cet égard dans le discours scientifique ou éthique un certain déni.
Mais revenons un instant à la notion de territoire que vous avez brièvement évoquée. Qu’il faille la manier avec précaution, qu’il faille en particulier se méfier des extrapolations de l’éthologie animale à la sociologie humaine, c’est sûr: l’éléphant qui défend son territoire n’autorise pas le bulldozer! Mais je suis frappé par une chose: le même homme qui aura plaisir à voyager, qui vantera éventuellement par exemple les qualités des Maghrébins après avoir séjourné dans leur pays, peut fort bien tenir des propos racistes une fois rentré dans son quartier. Je me souviens d’avoir dit autrefois à Sartre, avec une naïveté que je me pardonne encore mal aujourd’hui (c’était l’année où il écrivait La putain respectueuse qui dénonce, comme vous le savez, le racisme contre les Noirs aux États-Unis): «Mais en France, ce racisme n’existe pas.» «Parbleu, me répondit Sartre, il n’y a pas de raison qu’il existe. » Le fait est qu’à Paris, à l’époque, nous ne rencontrions que quelques étudiants africains. Nous n’en avions pas encore fait nos éboueurs et nos O.S. Autrement dit, le phénomène raciste ne surgit que lorsque l’«étranger» est dans la cité, dans la place. D’ailleurs, ce sont généralement les derniers venus qui sont la cible de prédilection. On peut penser que le racisme anti-arabe s’effacera un jour au bénéfice, si l’on peut dire, d’une autre population. J’ai donc le sentiment que le racisme trouve une de ses sources et un motif de sa relance dans une opposition dont nous sous-estimons la portée: l’opposition du propre et de l’étranger, opposition qui, chez le raciste, se redouble dans celle du propre et du sale, du pur et de l’impur. J’ai parlé de xénophobie comme signifiant à la fois répulsion et attirance vis-à-vis de l’étranger. Oui, les deux mouvements contraires coexistent.
A. Jacquard – Vous en arrivez à admettre que «tout le monde est raciste.» Le problème c’est de savoir si on lutte contre cela, si on le maîtrise. le groupe honni. Il me semble que la xénophobie peut rester une affaire individuelle alors que le racisme est une affaire de groupe, qu’il appelle nécessairement une violence massive.
A. Jacquard – Vous parliez également d’un déni…
J.-B. Pontalis – Oui, un déni qui limite, peut-être, l’efficacité de la lutte contre le racisme. Je m’explique: actuellement, nous nous trouvons confrontés à deux exigences contradictoires. D’une part, des groupes de plus en plus nombreux – cela va d’un continent jusqu’au village – revendiquent leur identité culturelle, ce qui conduit nécessairement à exacerber les différences. D’autre part, il nous est demandé, au nom de toute la tradition humaniste, de tenir ces différences pour nulles. Claude Lévi-Strauss a récemment scandalisé pour avoir rappelé dans sa préface au Regard éloigné l’existence de cette contradiction.
 Prenons un exemple quotidien. Un enfant, revenant de l’école, dit que son voisin a la peau noire. Faudra-t-il aussitôt le faire taire pour tuer dans l’oeuf un racisme possible, ou lui faire la leçon: «Mais quelle importance’? C’est un enfant comme toi». Ce serait nier une perception. Ce serait un peu comme si le petit garçon, découvrant que la petite fille n’est pas faite comme lui, s’entendait répondre: «Nous appartenons tous au… genre humain». La comparaison qui me vient là n’est pas fortuite: il se pourrait que la suraccentuation de la différence entre les «races», les ethnies ‘ou les groupes viennent compenser une déficience de sa propre identité sexuelle. Voyez comme souvent la race méprisée est qualifiée de « femelle» alors même qu’on lui attribue une puissance sexuelle hors du commun.
Prenons un exemple quotidien. Un enfant, revenant de l’école, dit que son voisin a la peau noire. Faudra-t-il aussitôt le faire taire pour tuer dans l’oeuf un racisme possible, ou lui faire la leçon: «Mais quelle importance’? C’est un enfant comme toi». Ce serait nier une perception. Ce serait un peu comme si le petit garçon, découvrant que la petite fille n’est pas faite comme lui, s’entendait répondre: «Nous appartenons tous au… genre humain». La comparaison qui me vient là n’est pas fortuite: il se pourrait que la suraccentuation de la différence entre les «races», les ethnies ‘ou les groupes viennent compenser une déficience de sa propre identité sexuelle. Voyez comme souvent la race méprisée est qualifiée de « femelle» alors même qu’on lui attribue une puissance sexuelle hors du commun.
Quand je parle de déni, j’ai en vue certaines formes de discours anti-raciste assurément bien, intentionnées mais qui, tout à leur combat, discréditent comme étant d’emblée raciste ce qu’on a pu appeler, dans un autre contexte, l’«épreuve de l’étranger». Cette épreuve n’est pas à écarter, chacun doit la faire pour son compte, à distance de toute doxa, afin de l’élaborer, d’en transformer les données, comme, par nécessité de métier, le font l’historien des mentalités, l’ethnologue des sociétés «primitives»… ou le psychanalyste. C’est parce qu’une psychanalyse est la rencontre de deux inconnus qu’elle offre une chance de découvrir en soi l’inconnu, sans qu’il y soit répondu par le rejet ou la terreur.
A. Jacquard – Une fois encore, le généticien que je suis doit donc reconnaître ce double fait: montrer en quoi la notion de race n’a plus cours aujourd’hui c’est sans doute utile, mais ça n’élimine pas le racisme. D’autre part, les «bons sentiments» ne suffisent pas plus que les arguments scientifiques pour lutter contre ce qui a pu être, ou qui sait, peut redevenir un jour, un fléau social. Pour le psychanalyste, le phénomène de racisme prendrait sa source chez l’individu, dans la haine de soi. Et celle-ci déterminerait finalement l’expulsion sociale de l’autre. Est-ce une manière d’affirmer que lorsqu’on dit: «Cette tête ne me revient pas», ce n’est pas de la tête d’autrui dont il s’agit, mais de la sienne propre … ?
J.-B. Pontalis – Nous voici à nouveau face au miroir… «Ma tête me revient» si le miroir me renvoie une image dans laquelle je peux me reconnaître. Si une tête ne me revient pas, c’est donc qu’elle reste au dehors et c’est peut-être ma tête, une tête que je ne parviens pas à me réapproprier et qui cependant a tout l’air d’être la mienne. La tête: précisément ce qui me définit le plus (on ne dit pas: ce corps, ces bras ne me reviennent pas). D’où cet effort dont j’ai parlé pour mettre cette tête de plus en plus loin de moi, pour la tenir à l’écart, pour l’exclure puisqu’elle ne peut pas faire retour en moi. L’épreuve de l’étranger, c’est un aller et retour: je fais mien un pays-inconnu,me le rends peu à peu familier, après quoi je découvre de l’inconnu dans mon pays familier. Si cet aller et retour ne s’opère pas, il y a le risque que là tête se fasse de plus en plus étrangère jusqu’à ce que soient annihilés les gens qui ont cette tête-là.
A. Jacquard – Est-ce que dans les travaux cliniques qui ont pu être faits par les psychologues sur le racisme, on a pu constater un cheminement parallèle entre la haine de soi et le racisme?
J.-B. Pontalis – C’est la paranoïa. On peut certainement soutenir que le racisme, au moins dans ses manifestations extrêmes, est une paranoïa collective. Alors, se protéger du «mauvais», le tenir à l’écart, l’expulser même ne suffit plus. Il faut le détruire une fois pour toutes. Ce délire paranoïaque peut conduire jusqu’au meurtre.
Vous allez sans doute m’objecter à nouveau que je passe bien facilement de l’individuel au collectif. Pourtant ce n’est pas tout à fait ainsi que je vois les choses. Il y a pour moi une équivalence entre la masse (ou le groupe qui peut être une masse à l’état réduit) et le moi. Le moi, comme forme, comme belle totalité, est déjà une masse. Et la masse peut tenir lieu de moi. Voyez le titre de l’essai de Freud Massenpsychologie und Ichanalyse (Psychologie des masses et analyse du Moi). Il indique un parallélisme entre le fonctionnement du moi et celui de la masse. Mais il indique aussi une disparité: le moi peut s’offrir à l’analyse; la masse ne peut être l’objet que d’une psychologie. La masse, cette forme moderne, incarnée, de la psyché, de l’âme. Je pense aussi à un terme que l’on trouve souvent sous la plume de Freud: «inconciliable» (unvertrâglich). Certaines représentations sont inconciliables avec le moi, avec le groupe de représentations qu’il constitue et qui ne vise qu’à maintenir son unité. Or, que constatons-nous dans les grands phénomènes de masse? Une abolition des différences. L’individu, dit-on, se noie dans la masse. L’hétérogénéité est niée. Non seulement on ne reconnaît plus de différence entre soi et les autres, on n’en reconnaît plus en soi. Tous pareils et chacun pareil à soi. Du pareil au même, c’est la devise de la masse, ce dieu couché! Triomphe de l’homogène, évacuation de l’inconciliable. L’inconciliable, celui qui n’appartient pas à la masse, est alors jeté dehors.
A. Jacquard – Il y aurait donc dans le groupe, dans la collectivité, un mécanisme qui s’appelle le racisme et dont on pourrait découvrir symétriquement à l’intérieur de soi-même l’équivalent. En d’autres mots, il y aurait en moi des contradictions qui seraient équivalentes à celles provoquant le racisme. C’est cela que j’appelais sans doute le mépris. Au fond de moi, je suis une vision du monde. Or cette vision n’est pas tout à fait cohérente. Je m’efforce désespérément de la rendre cohérente, mais enfin ce n’est jamais tout à fait réussi. Alors, si je me définis comme une vision du monde multiple, à l’intérieur de cette vision du monde, il y aurait donc place pour des mécanismes homologues au racisme?
 J.-B. Pontalis – Oui.
J.-B. Pontalis – Oui.
A. Jacquard – Que serait en moi cet équivalent du racisme qui existe dans la collectivité? Des zones de moi que je n’aime pas?
J.-B. Pontalis – Croyez-vous que les êtres humains, individuellement, vivent en bonne harmonie avec eux-mêmes?
A. Jacquard – Ah non! Ce serait trop beau. Mais il y a en moi comme un «sur-individu» qui essaie de mettre de l’ordre dans tous les aspects contradictoires de ma personne.
J.-B. Pontalis – Et si ça ne colle pas? Si cet effort de synthèse est sans cesse contrecarré par autre chose qui y provoque du désordre, et qui fait apparaître de plus en plus cet ordre comme une superstructure arbitraire et fragile? C’est la différence entre le rêve et le cauchemar. Vous avez des rêves qui sont l’étranger bien assimilé, qui se bornent à réveiller une vie psychique quelque peu inerte, les «bons» rêves qui vous mettent en communication avec votre passé, avec d’autres aspects de vous-même que ceux que vous montrez au grand jour. Et puis vous avez le cauchemar qui est absolument inintégrable et qui souvent se réduit à des images très élémentaires: il n’y a pas ici de mise en scène, ni d’histoire ni de dramatisation. Il n’y a pas de scénario. Du cauchemar, vous sortez par un cri . Vous ne pouvez rien en dire sinon quelque chose comme: «Une bête énorme fondait sur moi. » Le racisme serait un cauchemar social.
C’est pourquoi il est comme lui tellement élémentaire et brutal dans ses manifestations. Le discours n’a pas prise sur le cauchemar. On ne peut pas l’analyser. On essaie de voir ce qui a pu le déclencher, mais son contenu est trop massif, là aussi, trop pauvre et trop intense pour être soumis à un ordre quelconque du discours et du sens. Le cauchemar, c’est une explosion, une implosion. C’est un dehors, un intrus qui fait irruption dans notre douce intériorité.
Quand chacun aujourd’hui, non sans complaisance, parle de «son» inconscient, il fait appel à un inconscient bien tempéré, à une réalité dont il reconnaît certes l’altérité – l’inconscient, cet autre en moi – mais avec laquelle il peut négocier, qu’il peut, tout compte fait, gérer. Un rêve angoissant, un symptôme gênant, même la répétition mortifiante d’une situation d’échec finiront bien par prendre sens. Mais il y a une autre expérience de l’inconscient infiniment plus troublante, celle que Freud a désignée sous le nom d’Unheimlichkeit (L’inquiétante étrangeté) quand le plus familier vire soudainement au plus étrange. Une expérience qui peut être très passagère, comme un bref moment de dépersonnalisation où le moi perd ses assises. Un rêve, messager de l’inconscient, vous arrivez toujours, plus ou moins, à l’élaborer ou même à l’oublier. Tandis qu’une expérience comme celle-là ne se laisse pas intégrer. Elle met fondamentalement en cause « notre sentiment d’identité, elle brouille les frontières entre le dedans et le dehors. Pourquoi évoquer cela alors que nous parlons du racisme? Parce que le racisme transpose sur la scène sociale, place au dehors ce qui n’est pas, élaboré entre soi et soi.
A. Jacquard – Ce découpage intérieur est tout de même en permanence angoissant. Ce que j’espère c’est que «moi je» est unitaire. Bien sûr, on peut toujours l’analyser en morceaux. Mais ce que j’appelle je, c’est quelque chose de profondément unitaire qui domine tout le reste. Vous me raconterez des choses sur tous ces morceaux de moi, mais ils ne m’intéressent guère, c’est ce qui les unit que j’appelle moi. Comme dans l’individu, n’est-ce pas cette dissociation qui mène, dans la société, au racisme? Cette espèce de découpage où on n’arrive pas à intégrer tout? J’existe quand j’arrive à intégrer tout ce qui est en moi, y compris ce que je ne trouve pas admirable. Peu importe. J’en prends mon parti; je me constitue en disant: tous les aspects partiels, en fait, ce n’est pas moi. Ce n’est même pas l’addition de tout ça qui est moi. C’est ma capacité à les intégrer qui est moi. Alors une nation aussi, c’est la capacité à intégrer l’ensemble. Et elle se dissocie quand elle rejette des morceaux d’elle-même.
Pour en revenir au racisme, une vision sans doute un peu angélique,mais pour moi la France, c’est justement ce qui est capable d’être, en tant qu’être unitaire, avec des gars et des filles qui sont nés à Paris ou dans le Jura, mais aussi qui viennent d’ailleurs. Ce quelque chose, je l’appelle la «France» justement parce que ce n’est pas fait que de Français.
J.-B. Pontalis – Vous êtes extraordinairement je ne dirai pas optimiste, mais confiant dans votre pouvoir d’intégration personnelle. Vous paraissez vivre en coexistence pacifique avec vous-même. Vous dites: «Je ne suis pas Albert Jacquard depuis toujours, je suis arrivé à devenir Albert Jacquard, j’ai encore à devenir Albert Jacquard.»
A. Jacquard – Exactement. Pour moi la personne est toujours évolutive. Albert Jacquard est toujours à faire, à construire. Un peu comme un pays est toujours à construire. Et le jour où je me dirai: maintenant Albert Jacquard auquel je suis parvenu, c’est vraiment l’idéal de ce que je pouvais imaginer, je serai mort. Vous me trouvez optimiste. Sans doute cet optimisme est-il gratuit. Il vient d’avoir entendu le discours sur la Montagne; et d’être ébloui par la richesse de tout homme, Les conflits ne sont que des péripéties, ou plutôt on n’y voit des conflits que parce qu’on ne sait pas y voir une construction. La voile peut-elle être décrite comme en conflit avec le vent?
J.-B. Pontalis – Au fond, vous faites l’économie de la crise, de la crise économique, mais aussi de la crise psychologique. Comme si au moment de la crise, vous saviez déjà que vous avez la solution. C’est comme dans un film policier. On ignore ce qui va se passer mais on se dit que l’acteur principal, il faut bien qu’il soit là jusqu’au bout, donc on se rassure: le héros ne disparaîtra pas dans les cinq premières minutes du film. Pour un enfant-spectateur, ça ne marche pas comme ça, car il ne sait pas que l’acteur doit rester jusqu’au bout. Il peut avoir une peur bleue, dans les cinq premières minutes, que le héros ne meure. Eh bien vous, vous êtes un peu comme cet acteur qui serait convaincu qu’il se retrouvera au bout du film, donc que, même s’il est menacé de meurtre, il sera encore Albert Jacquard, le héros de sa propre vie. Mais justement, les groupes sociaux qui se croient menacés ne sont pas du tout sûrs d’être les héros de l’histoire. Ils redoutent d’être les dindons de la farce.
A. Jacquard – Le fait de prendre toute différence pour une supériorité ou une infériorité, ne serait-ce pas une maladie infantile de l’humanité? C’est sans doute trop optimiste de penser que l’humanité qui a à peine cent mille ans, ou cinquante mille ans selon la manière de compter, sort à peine de son acné juvénile et que la peur de l’autre est un complexe qui se surmontera un jour. A force de le dire, même si ça doit encore mettre cinquante mille ans – ce qui est peu pour l’histoire de notre espèce – l’être humain n’arrivera-t-il pas à surmonter cette peur de l’étranger?
J.-B. Pontalis – Il se peut que l’espèce humaine parvienne un jour à se vivre, et non seulement à se penser, comme un tout non hiérarchisé dont chaque partie serait une composante. Est-ce vraiment ce que nous devons souhaiter? Car le prix à payer pour cette sorte de réconciliation générale risque fort d’être une réduction à l’homogène. Ce que certains appellent un peu vite civilisation planétaire a en effet toute chance d’être une extension d’un seul modèle de civilisation, le nôtre, toujours plus axé sur le développement économique. Quoi qu’il en soit, si ce jour vient, il est probable que l’espèce humaine tiendra à se différencier d’une autre espèce, comme elle l’a longtemps fait vis-à-vis du monde animal, en oubliant qu’elle en faisait partie. Il se trouvera alors de «bons esprits», comme nous aujourd’hui, pour dénoncer, par exemple, un «racisme» anti-martien.
A. Jacquard – Vous semblez dire qu’il faut toujours à l’individu humain un autre étranger, au groupe humain une autre espèce pour se définir. Sans doute faut-il poser son identité face à un autre, mais ne peut-on pas le faire sans s’opposer à lui? Faut-il toujours que la rencontre avec autrui soit violente? A vous entendre, on a le sentiment que face à mon «idéalisme» croyant au changement, vous voyez les problèmes de racisme dont nous parlons dans les termes d’une permanence immobile.
J.-B. Pontalis – Absolument pas. La difficulté à laquelle nous nous heurtons est de penser ensemble, c’est-à-dire sans effacer un des termes de la contradiction, d’une part le maintien des différences, dans ce qu’elles ont d’irréductible (je m’adresse ici à l’auteur de l’Eloge de la différence), d’autre part l’unité du genre humain (je m’adresse au rédacteur de la revue qui porte ce nom). C’est d’autant plus difficile et nécessaire aujourd’hui que nous sommes les témoins et parfois les acteurs d’un mouvement très fort en faveur des différences, mouvement qui déborde et conteste l’idée «classique» de nation: chaque groupe humain revendique son histoire propre, sa tradition linguistique ou religieuse, sa culture locale, son mode de vie. Vous évoquiez à l’instant l’intégration, votre confiance en une intégration progressive. Mais l’intégration ne se fait-elle pas toujours à partir d’un centre intégrateur? Ce que vous soutenez là, c’est la thèse de l’assimilation dont les violences de l’Histoire contemporaine ont montré la fragilité. Croyez-vous qu’on puisse la reprendre telle quelle aujourd’hui? Car qui dit assimilation dit, sans toujours s’en apercevoir, assimilation à soi-même. Effectivement, si ceux qui ont bien raison de ne pas vouloir renoncer à des aspects, pour eux essentiels, de leur identité se reconnaissent dans «votre France», il n’y a plus, à terme, de problème. Mais pourquoi devrions-nous, au bout du compte, être tous idéalement semblables si nous sommes tous, en réalité, différents? Le paradoxe, c’est qu’on ne peut trouver son identité à soi qu’en n’étant pas identique aux autres. Le racisme comme phénomène de masse ne disparaîtra qu’avec la résolution de ce paradoxe, ce qui suppose des identités multiples, hétérogènes, mobiles, et non le triomphe de l’Un, nécessairement destructeur.
Le Genre humain n° 11 : « La société face au racisme », 1984
