— Par Philippe Dagen —
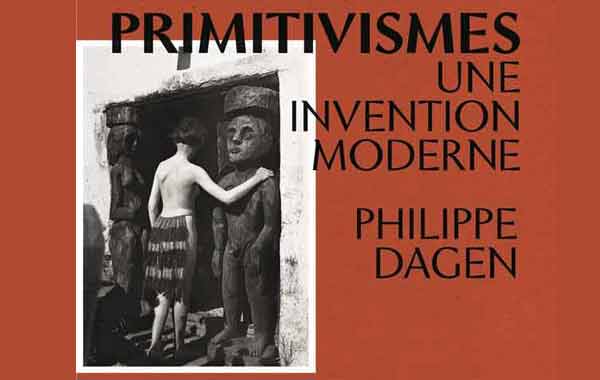
Dans un moment où l’histoire des cultures est en cours de réécriture et ne peut plus être réduite à la chronique des avant-gardes occidentales, et alors que les études postcoloniales ont plusieurs décennies d’ancienneté, une notion est demeurée jusqu’ici à l’abri de toute révision critique : primitivisme. Le mot est d’usage courant dans la langue de l’histoire de l’art autant que dans celle de la critique et du marché de l’art actuel. La notion dont il est dérivé, primitif, ne saurait plus être employée. Mais primitivisme résiste, fort de l’autorité qu’acheva de lui conférer une exposition célèbre du MoMA de New-York en 1984 et les noms de ses plus fameux artistes – Gauguin, Matisse, Picasso, Kirchner, Nolde, Kandinsky, Klee, Miró, Giacometti, etc. – et de ses plus illustres écrivains – Jarry, Apollinaire, Cendrars, Tzara, Breton, Éluard, etc. Aussi est-il nécessaire de mettre à nu tout ce qu’il contient de sous-entendus et de stéréotypes depuis que primitif, dans le dernier tiers du XIXe siècle, est une notion centrale de la pensée occidentale. Premier constat flagrant : le colonialisme des puissances européennes, avec ce qu’il suppose de racisme et de conquêtes, est la condition nécessaire du développement de l’ethnologie, de l’anthropologie et des musées. Sans colonies, pas de collections africaines et océaniennes à Berlin, Londres et Paris ; ni de « village canaque » ou « du Congo » dans les Expositions Universelles. Moins attendu : par primitif, cette époque entend évidemment les « sauvages », mais aussi les enfants, les fous et les préhistoriques. Qu’ont-ils en commun ? De n’être ni civilisés, ni rationnels au sens où l’époque veut l’être : ces primitifs sont le contraire des hommes modernes, urbains, savants, industrialisés et surpuissants. En un mot, le primitif est l’envers du moderne, son opposé, sa négation, ce qui résiste au mouvement général qu’on nomme progrès. Freud est l’un de ceux qui l’a écrit le plus tôt. Ph. D
Préface
La belle chose qu’une tête de sauvage ! Je me souviens de deux qui étaient là, noires et luisantes à force d’être boucanées, superbes en couleurs brunes, avec des teintes d’acier et de vieil argent. La première (celle d’un habitant du fleuve des Amazones) porte des dents qu’on lui a enfoncées dans les yeux ; parée d’ornements d’un goût inouï, couronnée de toutes sortes de plumages, et les gencives à nu, elle grimace d’une façon horrible et charmante. […] On a mis près d’elle une tête d’homme de la Nouvelle-Zélande, sans autre ornement que les tatouages qui l’ont engravée comme des hiéroglyphes et que les soleils que l’on distingue encore sur le cuir brun de ses joues, sans autre coiffure que ses longs cheveux noirs, débouclés, pendants, et qui semblent humides comme des branches de saule. Avec ses plumes vertes sur les tempes, ses longs cils abaissés, ses paupières demi-closes, elle a un air exquis de férocité, de volupté et de langueur. On comprend en la regardant toute la vie du sauvage, ses sensualités de viande crue, ses tendresses enfantines pour sa femme, ses hurlements à la guerre, son amour pour ses armes, ses soubresauts soudains, sa paresse subite et les mélancolies qui le surprennent sur les grèves en regardant les flots.
Tout cela existe encore, ce n’est pas un conte, il y a encore des hommes qui marchent nus, qui vivent sous les arbres, pays où les nuits de noces ont pour alcôve toute une forêt, pour plafond le ciel entier. Mais il faut partir vite, si vous voulez les voir ; on leur expédie déjà des peignes d’écaille et des brosses anglaises pour nettoyer leur chevelure, écumeuse de la sueur des courses, plaquée de rouge par le sang caillé des bêtes fauves, on leur taille des sous-pieds pour les pantalons qu’on leur fait ; on leur prépare des lois pour les villes qu’on leur bâtit ; on leur envoie des maîtres d’école, des missionnaires et des journaux1.
Primitivisme
Primitivisme est aujourd’hui un mot courant. S’il ne l’était pas encore avant l’exposition qui eut lieu au Museum of Modern Art de New York en 1984 sous ce titre, Primitivism, celle-ci a achevé de le répandre, ce qui ne signifie pas que son ou ses sens aient été mieux définis grâce à elle. Plusieurs critiques ont alors observé qu’il n’aurait pas dû aller de soi que primitif2 soit employé ainsi sans que l’on prenne conscience de ce qu’il énonce : que des sociétés et leurs cultures sont considérées comme primitives par rapport à d’autres qui sont tenues pour développées et modernes. Ces auteurs, dont James Clifford, ont constaté que cette façon de penser et d’écrire l’histoire plaçait les arts primitifs sous l’autorité des arts occidentaux et qu’ils recevaient de ceux-ci l’autorisation symbolique de prendre part désormais à une histoire universelle dont ils avaient été jusqu’alors absents. « Le fait que, assez abruptement, en quelques décennies une grande partie des artefacts non occidentaux aient finalement été redéfinis comme de l’art, est une mutation taxinomique qui appelle un débat historique critique, pas une célébration3. » La réflexion que Clifford appelait de ses vœux est l’un des objets de cet ouvrage.
Un peu plus de trente ans plus tard, où en est-on ? À peu près au même point. Des recherches ont apporté des précisions sur des points de détail. Elles ont contribué à renforcer l’autorité du récit habituel, prononcé sur un mode épique ou héroïque, celui des avant-gardes. Réduit à sa trame, ce récit est le suivant : au début du XXe siècle, de jeunes artistes, en Allemagne et en France d’abord, se prennent soudain d’intérêt pour des objets venus principalement d’Océanie en Allemagne et d’Afrique en France. Ces artistes sont les fondateurs des mouvements d’avant-garde nommés Die Brücke à Dresde, fauvisme et cubisme à Paris et, peu après, Der Blaue Reiter à Munich. Leurs noms sont les plus connus de leur temps : Henri Matisse, André Derain, Pablo Picasso, Georges Braque, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Max Pechstein, Paul Klee, Vassily Kandinsky, Franz Marc. Ils ont été précédés par Paul Gauguin, dont tous connaissent alors les voyages et les œuvres. Grâce à eux, des artefacts qui, jusqu’alors, étaient relégués dans des musées ethnographiques ou circulaient par les voies aléatoires de la brocante, cessent d’être des curiosités plus ou moins monstrueuses ou grotesques et accèdent au statut d’œuvres d’art, susceptibles d’exercer quelque influence sur les travaux de leurs découvreurs et admirateurs. Après la Première Guerre mondiale, ce processus, s’élargissant, gagnant un public plus nombreux, recommence avec le mouvement Dada et le surréalisme, André Breton, Paul Éluard, Jean Arp, Joan Miró, Alberto Giacometti ou André Masson. Voici, sommairement formulée, l’action et ses principaux protagonistes. Histoire mille fois répétée.
Si l’on se place du point de vue de ce que Clifford désigne comme « artefacts non occidentaux », la diffusion de ce récit, sous des formes savantes ou abrégées, les maintient donc sous l’autorité de la culture occidentale, à laquelle ils doivent d’avoir été promus au rang artistique en Occident et qui conditionnerait leur perception. « Le primitivisme moderniste est une affaire occidentale florissante », écrit Clifford4. Les décennies écoulées depuis ces mots ont confirmé la formule, autant pour « occidentale » que pour « florissante ». Il n’est pas de catalogue d’exposition ou de vente aux enchères d’objets africains ou océaniens qui ne rappelle combien les artistes du début du XXe siècle ont contribué de manière décisive à la reconnaissance des civilisations dont ces objets sont issus. Leurs noms font office de cautions indiscutables – comme s’il fallait des cautions – et contribuent à leur valorisation financière5. Cette présentation a en effet pour conséquence d’augmenter la valeur marchande des objets pris dans cette rhétorique. Celle-ci multiplie et rapprochements et appréciations tous aussi flatteurs, du moins selon le point de vue occidental. À une sculpture dogon, la qualité de « cubiste » est attribuée. Une pièce de la plaine du fleuve Sepik ou de Nouvelle-Irlande se découvre « expressionniste » ou « surréaliste », à moins qu’elle ne bénéficie de l’un et l’autre adjectifs. À Samoa, on serait plutôt « minimaliste ». Des historiens de l’art et des anthropologues appuient de leur autorité ces argumentaires. Ces effets de langage et d’exposition sont si puissants que l’on se soucie peu de mesurer à quelles appropriations et requalifications il est ainsi procédé.
Primitif ?
Notre dessein n’est pas6 de compléter et préciser l’inventaire de ces « affinités du tribal et du moderne », pour reprendre le sous-titre de l’exposition new-yorkaise. Il est d’étudier les processus par lesquels le moderne invente le primitif, son contraire, pour quels besoins ou nécessités, par quelles opérations intellectuelles et artistiques. Autrement dit : comment se forme et agit la fiction du primitif ?
Comment se forme-t-elle ? Apporter quelque clarté sur ce point suppose que l’on réponde d’abord à deux questions qui, au plus simple, se formulent ainsi : que connaît-on et comment considère-t-on les arts primitifs dans les dernières décennies du XIXe siècle ? Et, interrogation inséparable, quelle est l’étendue de cette notion, à quoi s’applique-t-elle ? Si l’on s’en tient au récit habituel, ces arts ont été révélés au début du XXe siècle par quelques artistes pionniers, ceux que l’on a énumérés précédemment. Et primitif signifie : venu d’Afrique, d’Océanie et des peuples amérindiens. Ces deux affirmations ne résistent pas à l’examen.
Le premier point, celui du degré de connaissance et de compréhension, ne peut être étudié qu’en introduisant immédiatement le phénomène central de l’époque, l’expansion coloniale des puissances européennes. Le primitivisme en est indissociable parce que la colonisation crée les conditions de l’afflux croissant et très abondant des artefacts des régions colonisées vers les pays colonisateurs et crée aussi les conditions d’un autre afflux, celui des rapports et des descriptions ethnographiques sur lesquels se fondent les travaux de l’anthropologie naissante ; et parce que la colonisation et le racisme déterminent en grande partie le type de regard et de jugement que les Européens portent sur ces objets, y compris celui de la majorité, sinon de la totalité des anthropologues et historiens des religions. Le processus colonial et ses corollaires – activités missionnaires, implantation d’administrations, commerces, etc. – est la condition première de l’accès aux primitifs, donc du primitivisme. Et donc ces peuples sont primitifs : des peuples dont les vêtements, les habitats, les mœurs, les instruments, etc. sont considérés, sans discussion, comme inférieurs à ceux des pays européens. Le primitif n’est dit tel que par comparaison et classement : une société et une culture seraient primitives par rapport à d’autres sociétés et cultures tenues pour plus avancées ou plus développées selon l’échelle du progrès technique. Les modes de vie des Aborigènes, des « négrilles » ou des Indiens d’Amazonie diffèrent profondément de celui des pays industrialisés au XIXe siècle, où ces différences sont tenues pour les preuves d’une évidente supériorité – donc de la légitimité de la conquête et de la possession. Très rares sont ceux qui se dégagent de cette conception de l’humanité répartie en rangs et en races – ce dernier mot étant d’un usage aussi fréquent que primitif jusque dans l’entre-deux-guerres. Primitif est le nom de la catégorie dans laquelle se trouvent précipitées des sociétés dont le point commun est de ne pas fonctionner comme les sociétés modernes. Celles-ci appliquent systématiquement ce qualificatif du haut de la certitude qu’elles ont de leur antériorité et de leurs résultats dans l’histoire des progrès scientifiques et techniques. Le mot semble ainsi aller de soi pour caractériser les peuples d’Afrique et d’Océanie, ainsi que ceux d’une partie du Sud-Est asiatique et des régions encore indiennes des Amériques.
Mais primitif est appliqué à d’autres états, qui se différencient de celui de l’homme moderne d’autres manières. C’est la raison pour laquelle le primitivisme doit s’employer au pluriel et son analyse ne pas se restreindre à ce que Primitivism désigne comme tribal, terme impropre au regard de l’ethnographie et chargé de sous-entendus péjoratifs. Ce fait est patent pour quiconque s’arrête sur les ouvrages des anthropologues de la fin du XIXe siècle, quelle que soit leur nationalité. Un comparatisme systématique cherche et trouve des analogies non seulement entre Nouvelle-Guinée et Gabon, ou Alaska et Marquises, mais encore entre ces peuples tenus pour sauvages d’une part et, de l’autre, les préhistoriques, les enfants, les fous et les populations européennes non encore affectées par le progrès. Ignorer la pluralité des usages de primitif, c’est s’en tenir à une compréhension de la notion si incomplète qu’elle en devient inopérante7. Ces usages pluriels varient selon les auteurs et les ouvrages, mais il n’en demeure pas moins que ce sont là des modes du primitif aussi souvent étudiés dans ces décennies que le mode qui est alors dit sauvage. Ce qui les unit, ce qui paraît autoriser analogies et assimilations, est que, dans tous les cas, il en va d’un écart : d’un écart dans le temps pour les préhistoriques, d’un écart dans le développement de l’individu pour les enfants, d’un écart dans l’état des connaissances pour les rustiques et d’un écart par rapport à la rationalité pour les fous. De Tylor à Hamy, de Lang à Reinach, ces jeux d’assimilations sont constants : ainsi s’accomplit l’extension de la notion de primitif bien au-delà des seuls sauvages. Entre tant d’autres exemples de ce processus, Marcel Réja, avec L’Art chez les fous, paru en 1908, dont le chapitre « Dessins d’enfants et de sauvages » commence ainsi :
Le dessin des fous ne constitue pas une forme absolument unique, un monstre isolé parmi les productions du reste de l’humanité. Parmi les aspects divers qu’il présente, quelques-uns paraissent des pastiches des formes archaïques de l’art, d’autres évoquent la ressemblance de dessins dus à des catégories très spéciales d’individus : les prisonniers, les médiums, les enfants et les sauvages8.
Primitif est compris ici dans l’ensemble de ces applications, qualifiant des états qui, aujourd’hui, ne sauraient être tenus pour équivalents, pas même pour comparables. Il est donc compris et employé tel qu’il l’est dès le titre par John Lubbock dans son traité The Origin of Civilisation and the Primitive Condition of Man, publié à Londres en 1870, et par Edward Burnett Tylor dans Primitive Culture : Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom dont la première édition paraît, à Londres encore, en 1871. Ceci signifie tout autant qu’une autre acception, qui est absente de leurs travaux et de tous ceux qui les suivent jusqu’au début du XXe siècle, ne sera pas prise en considération afin de maintenir l’adéquation la plus étroite avec les usages de primitif dans cette période et afin d’éviter des confusions qui s’observent souvent. Un emploi de primitif ne sera donc pas examiné, bien qu’il ait eu cours dans les musées, celui qui suppose une majuscule, pour les Primitifs italiens, flamands ou français. Ces artistes ne sont pas des primitifs – sans majuscule – au sens où ethnologues et anthropologues entendent le mot. Ils appartiennent très évidemment à l’histoire des arts occidentaux, avant la Renaissance, mais après les siècles de la civilisation gréco-romaine. Aussi n’intéressent-ils pas les théoriciens du primitif.
Afin d’écarter toute autre confusion et en se fondant sur ces mêmes données, il faut encore affirmer une autre distinction : l’attention que des artistes et des écrivains européens manifestent à l’égard des arts du Japon, de la Chine, du Sud-Est asiatique, de l’Inde et des pays musulmans du Moyen-Orient ne relève pas non plus de notre étude. Aucun auteur ne tiendrait pour primitifs les graveurs des estampes de l’ukiyo-e chères à la vogue japoniste, les sculpteurs d’Angkor et de Borobudur, les miniaturistes moghols ou les architectes du temps des Omeyyades. Leurs créations sont celles de cultures qui peuvent paraître lointaines – encore que de moins en moins – et, à ce titre, exotiques. Mais elles émanent de civilisations qui ne le cèdent en rien à celle de l’Europe médiévale ou renaissante pour ce qui est de leur développement – celui-ci étant évidemment mesuré par comparaison avec celui de l’Europe elle-même. Primitif et exotique ne sont pas synonymes.
Il faut donc commencer par étudier la pensée et la connaissance du primitif en le considérant selon ces cinq modes : le sauvage, le fou, l’enfant, le préhistorique et le rustique. Ce primitif est une construction – une invention, autrement dit, ou une fiction – de la modernité occidentale et ce n’est qu’après avoir analysé l’histoire matérielle et intellectuelle de cette construction qu’il peut être possible de revenir vers les manifestations artistiques des primitivismes, pluriel de rigueur puisqu’il y a plusieurs modes du primitif. Resteront à comprendre les causes de cette invention, dont on peut d’ores et déjà soupçonner qu’elles sont à chercher dans l’histoire même de cette modernité. Les primitivismes, dont l’histoire a été écrite en la confondant avec celles des avant-gardes, ne seraient-ils pas les manifestations d’une pensée intensément critique de la modernité9, profondément hostile à ce que l’Europe devient au XIXe siècle et dont la Première Guerre mondiale est l’apothéose criminelle ? Cette hypothèse sera mise à l’épreuve des œuvres et des écrits.
Méthode
La réflexion ici tentée réunit et s’efforce d’articuler ensemble des données qui relèvent, si l’on se reporte à la cartographie habituelle des sciences humaines, de l’histoire des faits politiques et sociaux, de celle des arts visuels, de celles de la littérature, de l’ethnographie, de l’anthropologie, de la psychanalyse et encore de la philosophie de l’histoire. Or la constatation se vérifie sans cesse et devrait paraître banale : la création plastique d’une époque, quelle que soit cette époque, n’est pas plus détachée de la situation générale de la société qu’elle ne l’est de ce qu’on nommait jadis le mouvement des idées. Toute étude qui ignore ces synchronies et leurs effets se voue à manquer tout ou partie de son objet. La notion de contexte est trop vague pour suggérer l’intrication serrée, difficile à démêler souvent, des relations entre divers champs de l’activité humaine, la prolifération des résonances, les curiosités et les aspirations communes ou contradictoires à tel moment de l’histoire, moment dont elle constitue la spécificité.
Il y a, assez souvent, unité d’action et de temps, mais une unité si l’on peut dire inconsciente. Que les artistes qui en passaient par la création de formes picturales et sculpturales aient su ou ignoré combien certains de leurs contemporains étaient d’accord avec eux dans leurs livres, chacun à sa manière, selon son mode d’expression particulier et avec ses singularités, qu’ils aient ou non perçu ces correspondances, cette homogénéité du contemporain : ce point importe bien moins que la perception de cette unité aujourd’hui, telle qu’une histoire aussi complète que possible – en tout cas moins incomplète que d’autres – y introduit. On pourrait nommer convergences aveugles ces rencontres, méconnues de celles et ceux qu’elles réunissent sous le regard de l’historien.
Elles rapprochent des peintres et des écrivains qui vivent les mêmes temps en des lieux proches ou éloignés par ce qu’ils ont en commun. Ainsi de Emil Nolde, Robert Louis Stevenson et Hermann Hesse, d’accord entre eux sans qu’ils l’aient su et sans qu’il soit nécessaire d’établir que Nolde a lu Stevenson et Hesse ou que Hesse a regardé Nolde – mais parce qu’en voyage dans les mers du Sud, ils tombent d’accord sur les conséquences de la colonisation et la disparition des mythes et des arts autochtones. De même, des affinités de pensée et de cocomportement convainquent de considérer ensemble Vassily Kandinsky et D. H. Lawrence, alors que rien n’autorise à affirmer que Lawrence ait vu des Kandinsky en passant par Munich en 1912, ni que Kandinsky ait, à cette date, lu quoi que ce soit de l’écrivain britannique. Il se peut même qu’un commentaire pertinent d’une toile de Paul Gauguin se trouve dans Les Religions des peuples non-civilisés de l’historien des religions Albert Réville, qui, probablement, aurait été scandalisé par l’art de Gauguin. Ce ne sont que trois exemples de la manière qui a été la nôtre de faire ce livre. Le phénomène qu’il étudie étant idéologique et politique autant que culturel et artistique, il aurait été inconséquent de ne pas tenter d’en parcourir les ramifications fort au-delà de ce que l’on entend par histoire de l’art. Une sculpture ou un dessin pensent d’une autre manière qu’une chorégraphie ou un poème, qui pensent selon leurs modalités spécifiques – mais n’en sont pas moins pensées. Et, dans une situation commune, leurs pensées se rejoignent. Pensées de quoi ? De la condition humaine moderne, de l’histoire des civilisations, du présent qui est irrésistiblement le leur, du passé que la plupart d’entre eux regrettent et mythifient.
Cette méthode suppose d’aller voir loin des références habituelles, car c’est la seule façon de décrire cet ensemble complexe d’expériences, de réflexions, d’attitudes et de créations qui constitue les primitivismes.
Un cas d’école : Aby Warburg chez les Hopis
De cette manière de procéder et, simultanément, de quelques-uns des principaux enjeux de ces recherches, on achèvera cette préface par un exemple qui a qualité d’emblème, en s’attachant à un cas que sa célébrité devrait détourner de réexaminer : le voyage d’Aby Warburg dans des villages indiens des mesas du sud-ouest des États-Unis de décembre 1895 à janvier 1896, puis d’avril à mai 1896, occasion pour lui d’assister à Oraibi à une cérémonie dansée des Indiens mokis. Son itinéraire, ce qu’il vit, ce qu’il acheta et plus encore ce qu’il en déduisit ultérieurement ont été abondamment commentés de nombreux points de vue et la conférence que Warburg prononça le 21 avril 1923 à la clinique Bellevue à Kreuzlingen, Le Rituel du serpent, est devenue son texte sans doute le plus connu. Il serait présomptueux de prétendre en proposer une interprétation nouvelle, mais en raison de la date du voyage et de la conjonction entre ethnographie, anthropologie, histoire des religions et histoire des arts qu’opère Warburg, Le Rituel du serpent apparaît comme un cas d’école dans l’étude du primitif. Il permet d’exposer à la fois la diversité des sources auxquelles il faut se référer et quelques-uns des thèmes et notions examinés au long du livre. On fera, à son propos, cinq observations.
Première observation : les danses des Mokis, Hopis, Zuñis et des autres populations indiennes pueblos sont, à la fin du XIXe siècle, largement connues des savants. Elles le sont par les contributions de Frank Hamilton Cushing, qui a séjourné plusieurs années dans les villages indiens des mesas et publié de nombreuses études dans les annales du Bureau of American Ethnology. Warburg rencontre Cushing à Washington le 24 octobre 1895 ainsi qu’il le note dans son journal10. Leur conversation a lieu au siège de la Smithsonian Institution, dont Warburg cite plusieurs chercheurs, dont James Mooney et Franz Boas, « pionniers de la recherche sur les indigènes qui m’ouvrirent les yeux sur la signification universelle de l’Amérique préhistorique et sauvage », écrit-il dans le brouillon de sa conférence, employant donc le vocabulaire de son temps et le comparatisme entre « préhistorique » et « sauvage » tout aussi caractéristique de l’époque11. Il cite le roman ethnographique d’Adolf Francis Badelier The Delight Makers, publié en 1890. Il prend connaissance à Washington de l’ouvrage rassemblant des photographies de Gustaf Nordenskiöld The Cliff Dwellers of the Mesa Verde, Southwestern Colorado, paru en 1893. Mais la bibliographie sur le sujet est plus vaste et plus ancienne. Bien que ni Warburg ni ses commentateurs ne le mentionnent, l’officier et ethnologue nord-américain John Gregory Bourke a publié dès 1884 à New York et Londres simultanément un long ouvrage accompagné de planches dont le titre complet est The Snake-Dance of the Moquis of Arizona, being a narrative of a journey from Santa Fé, New Mexico, to the villages of the Moqui Indians of Arizona, with a description of the manners and customs of this peculiar people, and especially of the revolting religious rite, the snake-dance12. Bourke est également l’auteur de Scatologic Rites of All Nations, publié à Washington en 1891, dont le retentissement est alors considérable en raison du sujet et des comparaisons entre cultures des différents continents, Europe incluse, que Bourke systématise conformément aux usages de l’anthropologie contemporaine et sans craindre d’offusquer la pudeur de ses lecteurs. Son ouvrage s’ouvre sur le chapitre « La danse de l’urine chez les Zuñis », cérémonie que l’auteur a observée le 17 novembre 1881 en compagnie de Cushing13. Il n’est guère aventureux de supposer que Warburg a pu prendre connaissance de ce livre, dans lequel Bourke fait référence à son premier opus ethnographique, et cela d’autant plus qu’il y mentionne son séjour dans le village d’Oraibi14, où Warburg se rend quinze ans plus tard.
À ces travaux consacrés aux Indiens des mesas s’ajoutent, à la date du voyage de Warburg, ceux qui s’attachent aux symboliques du serpent à travers religions et époques, parmi lesquels, de James Fergusson en 1868, Tree and Serpent Worship, or Illustrations of Mythology and Art in India, qui se fonde sur la civilisation de l’Inde ancienne, et l’essai publié à New York en 1877 par Hyde Clarke et Charles Staniland Wake, Serpent And Siva Worship And Mythology, In Central America, Africa, And Asia. And The Origin Of Serpent Worship ; ainsi que les essais de synthèse et les hypothèses d’interprétation de Lubbock15, Lang ou Frazer. Il ne s’agit pas de sous-entendre que la démarche de Warburg serait moins neuve qu’on ne l’a dit, mais d’observer qu’elle s’inscrit à sa date dans le vaste développement de l’anthropologie qui s’accomplit à partir des ouvrages de Lubbock et de Tylor. Son voyage et sa réflexion sont ainsi tributaires de la vogue générale du primitif dans les sciences humaines dans le dernier tiers du XIXe siècle en général et de la célébrité de la danse du serpent plus particulièrement. Ceci nous introduit à l’étude de cette vogue et de la conception du primitif qui s’y constitue16.
Deuxième observation : la notoriété de la cérémonie des serpents n’est pas circonscrite au monde des savants. Si Warburg n’y a pas assisté17, de plus anonymes voyageurs l’ont vue. Elle est si fameuse que, par exemple, en novembre 1896 la revue de vulgarisation française La Nature publie, illustré de dessins d’après des photographies, le récit « Les Indiens moki et leur “danse du serpent” » par Charles Marsillon. Sa description, bien qu’elle sacrifie au pittoresque et soit de seconde main, écrite d’après un article du Harper’s Weekly, n’en est pas moins assez précise, conforme à ce que Bourke en a écrit. Marsillon suit l’ordre du rituel. Il fait assister le lecteur à l’arrivée des serpents enfermés dans des sacs par les officiants : « Avec mille précautions, ils déposent les sacs renfermant les crotales et, en chœur, ils entonnent un chant guttural sauvage, souhaitant ainsi la bienvenue à leurs “frères aînés”. Les sacs s’ouvrent et laissent échapper leurs prisonniers qui s’élancent à travers la Kiva en sifflant et agitant furieusement la crécelle qu’ils portent […]18. » Puis vient l’instant de la procession : « On aperçoit alors, sortant de la Kiva, le grand pontife Kopeli ; lentement il s’avance. Dans la bouche il tient un crotale qui se tord sans chercher cependant à le mordre ; sa main droite porte un bouquet de plumes d’aigle, sa main gauche soutient deux énormes reptiles dont les anneaux brillants s’enroulent autour de son bras19. » Marsillon s’interroge enfin sur l’énigmatique entente qui semble s’établir entre les danseurs et les reptiles.
Dix jours durant ces prêtres singuliers ont vécu entourés des reptiles les plus dangereux, rendus furieux par un jeûne prolongé. Par une sorte d’influence occulte exercée par eux sur ces serpents, ils ont pu, sans faire emploi d’artifices quelconques, les manier impunément, les porter à la bouche […]. L’immunité dont jouissent ces hommes ne laisse pas de surprendre et d’émerveiller celui qui a eu l’heureuse chance d’assister aux diverses péripéties de ce spectacle inoubliable20.
Cette ultime phrase se comprend par rapport au premier paragraphe du récit :
Cérémonie bien étrange que cette « Danse du serpent » à laquelle se livrent tous les deux ans les Indiens Moki. À l’époque fixée pour la célébration de cette solennité religieuse, souvenir d’une antique légende qui parmi ces peuplades se transmet d’âge en âge, arrivent en foule, pour assister à ces fêtes, d’innombrables touristes. Cette partie de la vieille province de Tusayan voit affluer toute une population bruyante à laquelle ces vastes solitudes sont de vrais sujets d’émerveillement21.
« D’innombrables touristes » en 1896 : c’est dire d’une part qu’Américains et Mexicains d’origines européennes se rendent à Oraibi et Walpi pour assister à ce qui devient dès lors, du seul fait de leur présence, un spectacle ; et que, d’autre part, les Indiens des mesas sont loin d’être purs de toute présence occidentale. Ce que note Bourke dès 1884 se confirme.
Ainsi apparaissent ces sujets connexes : la diffusion auprès d’un public de plus en plus vaste de récits et descriptions qui popularisent des imageries des primitifs et la transformation des modes de pensée et de vie de ces derniers à mesure que leurs contacts avec le monde moderne deviennent de plus en plus fréquents. Autrement dit : la popularité du sujet primitif et, simultanément, la progressive destruction par acculturation de ces sociétés, victimes des missionnaires, des trafiquants22 et, désormais, du tourisme. C’est dans cette situation que les primitivismes se développent, alimentés en informations et objets par ceux qui sont, du fait de leur présence sur place et de leur action, les principaux agents de l’acculturation.
La troisième remarque se fonde sur la conférence prononcée par Warburg en 1923 afin de démontrer à Ludwig Binswanger et ses confrères qu’il a retrouvé la raison et qu’il est désormais en mesure de quitter la clinique Bellevue où il est interné depuis deux ans. On n’en garde ici que peu de phrases et de sujets : l’unité avec la nature, l’enfance, la mort du mythique. L’unité de l’homme et de la nature est incarnée par le serpent.
Ici les danseurs et l’animal vivant forment une unité magique. Le plus surprenant est que, dans ces cérémonies dansées, les Indiens ont su manier le plus dangereux de tous les animaux, le serpent à sonnettes, de telle sorte qu’ils le maîtrisent sans employer la force, et que la créature participe de son plein gré – ou du moins sans faire usage de ses facultés d’animal féroce si elle n’est pas excitée – à des cérémonies qui durent des jours entiers, ce qui, dans la main d’Européens, entraînerait certainement des catastrophes23.
« Unité magique » : notion majeure des travaux de Mauss sur les formes de magie, associée par lui comme par Warburg et bien d’autres à celle de totémisme, elle-même comprise comme une relation d’ordre familial et intime entre l’humain et le non-humain, animal ou végétal. Or cette relation atteste, du simple fait de son existence et de son intensité, un état de l’humanité dans lequel la séparation entre humain et nature n’est pas encore accomplie, comme elle l’est dans le monde moderne – théorisée, pratiquée, généralisée autant par les sciences que par les industries. Aussi la remarque lancée à propos de ces Européens que les serpents n’auraient pas manqué de mordre, qui pourrait paraître anodine ou superflue, compte-t-elle. Warburg y suggère, comme en passant, que les Européens sont devenus incapables de toute « unité magique ». On verra combien ce constat et les regrets qu’il fait se lever importent à la compréhension de Hesse, Kirchner, Kandinsky ou Conrad – simples exemples.
Autre thème : l’association du sauvage et de l’enfant, deux modes du primitif. L’enfant est présent dans le Rituel du serpent selon deux modalités. La première est le dessin. Warburg s’intéresse aux dessins des enfants de la Moki Industrial School de Keams Canyon au point d’en intégrer dans sa collection, à côté des costumes de danse, des poteries – 52 – et des vanneries – 11 – qu’il acquiert pour constituer « un aperçu complet de la production indigène24 ». Aux écoliers, il propose d’illustrer une histoire d’orage. L’un d’eux, de naissance hopi, dessine deux serpents tels deux éclairs bifides glissant sur le sol. L’immédiateté de cette représentation selon le mythe vérifie la proximité, affirmée par tant d’auteurs de Luquet à Hamy et à l’Almanach du Blaue Reiter, de l’enfant et du sauvage, l’un non encore dénaturé par l’école et l’éducation, l’autre préservé de leurs atteintes25. Un autre dessin, dont Warburg fait état, figure le serpent éclair porteur de pluie. Il a été tracé, là encore à la demande de Warburg, par un prêtre de la kiva de Cochiti, Cleo Jurino, et son fils Anacleto. Le père et le fils sont, l’un parce qu’il est un initié, l’autre parce qu’il est encore un enfant, garants de la vérité du dessin, « exactement le même » que sur des poteries26. Quant à la seconde modalité de l’enfance dans la conférence, elle est elliptique et allégorique. Warburg dit à son auditoire de Kreuzlingen :
Toute l’humanité se rencontre dans le culte du soleil. Et les sauvages aussi bien que les hommes cultivés ont le droit de le prendre pour le symbole qui nous fait quitter les régions inférieures de la nuit et nous élève. Les enfants sont debout devant une caverne27.
La phrase accompagne la photographie, prise par lui, de cinq enfants : quatre petites Indiennes, dont un nourrisson que porte l’une d’elles, et une enfant américaine, reconnaissable à son teint et à sa robe blanche. Elles sont debout à l’entrée d’une caverne, le soleil projetant leurs ombres devant elles. Indiennes ou occidentale, ces enfants devant la grotte témoigneraient de la puissance symbolique de la lumière, ressentie par toutes également, sans considération d’origine et de statut social. Cette interprétation ne serait pas compréhensible si Warburg ne l’énonçait et ainsi ne faisait passer l’image du statut de photo souvenir à celle de symbole d’une commune et enfantine aspiration à la clarté : enfance et vérité seraient, en déduit-on, des notions inséparables.
Quatrième thème : la mort du passé primitif assassiné par le présent moderne. Il est ici si flagrant qu’il suffit de citer Warburg, commentant une autre des photographies rapportées de son voyage :
Dans une rue de San Francisco, j’ai pu prendre un instantané de l’homme qui a triomphé du culte du serpent et de la peur de l’éclair, l’héritier des habitants primitifs et du chercheur d’or qui a éliminé l’Indien. C’est l’oncle Sam, coiffé d’un haut-de-forme, marchant fièrement dans la rue et passant devant un édifice néo-classique. Un câble électrique est tendu au-dessus de son chapeau. Dans ce serpent de cuivre d’Edison, il a dérobé l’éclair à la nature. […] Ainsi la civilisation de l’âge mécanique détruit-elle ce que la connaissance de la nature, née du mythe, avait péniblement construit, l’espace de contemplation qui est devenu espace de pensée. […] Le télégramme et le téléphone détruisent le cosmos. La pensée mythique et la pensée symbolique, en luttant pour donner une dimension spirituelle à la relation de l’homme à son environnement, ont fait de l’espace une zone de contemplation ou de pensée, espace que la communication électrique instantanée anéantit28.
Il est peu de condamnations plus explicites des ravages que le présent moderne inflige au passé mythique. Du serpent éclair au fil électrique : raccourci foudroyant. Ces dernières lignes de la conférence n’ont suscité que peu de commentaires29 alors qu’elles s’inscrivent à l’évidence dans le mouvement de critique radicale de la modernité qui est l’origine des primitivismes.
Cinquième observation enfin : le voyage de Warburg est un moment de l’orchestration du thème hopi dans les arts visuels et la littérature dans la première moitié du XXe siècle, développement auquel participent des auteurs et des artistes très divers. Si l’on s’en tient d’abord exclusivement à la danse du serpent, sa renommée est alimentée, après le livre de Bourke, par celui d’Henry R. Voth, The Oraibi Summer Snake Ceremony, publié aux Field Columbian Museum Publications de Chicago en 1903. Puis, si l’on cherche des indices de popularité ultérieurs de ce qui devient dans l’entre-deux-guerres de plus en plus une attraction touristique, il convient de se référer d’abord à D. H. Lawrence. Dans ses Matinées mexicaines, ouvrage paru en 1927 en Grande-Bretagne et aux États-Unis, est inclus le récit intitulé « La danse des serpents », d’après celle à laquelle Lawrence a assisté : « Le dimanche après-midi, le 17 août, les automobiles noires se suivaient en cahotant à travers ce désert gris où le gris des sauges en broussaille tournait au jaune pâle. Les capuchons noirs se suivaient péniblement comme pour un enterrement : autos remplies de touristes en route vers la troisième et dernière mesa30. » Il continue : « Trois mille personnes sont venues cette année à travers des kilomètres de désert et de rochers voir la petite danse des serpents. Trois mille personnes de toute espèce : gens cultivés de New York, Californiens, touristes de passage, cow-boys, Indiens navajos et jusqu’à des nègres. […] Les gens font des centaines de kilomètres avec entrain pour voir ce numéro de cirque : des hommes maniant de vrais serpents venimeux qui peuvent les mordre et les mordent parfois. Voilà qui en vaut la peine31 ! » Par la suite, Lawrence alterne les notations sarcastiques sur le comportement du public, les descriptions minutieuses des moments successifs du rituel et des incises entre anthropologie et philosophie des religions. De l’auteur du Serpent à plumes, ni l’attention aux détails cérémoniels ni le dédain à l’égard des curieux ne surprennent : le sacrilège n’est pas dans l’attitude de Lawrence, mais dans celle, impatiente et ignorante, de la foule. Ni ne surprennent des réflexions telles que : « Les serpents sont plus près de la puissance originelle, le sombre soleil intense et caché qui est au centre de la terre32. » Ou celle-ci, à la Warburg quoique Lawrence n’ait pas connaissance de sa conférence, inédite en 1926 : « Pour nous, la science est notre religion et par elle nous sommes les conquérants et les dieux de notre terre. Mais pour l’Indien, les procédés scientifiques n’existent pas. Tout vit. Et la conquête se fait par la volonté vivante. C’est là la religion de toute l’Amérique primitive : Péruviens, Aztèques, Athabascans – peut-être est-ce celle de tout le monde primitif33. » Lawrence est, dans l’histoire des primitivismes, un contributeur majeur, autant par ses romans que par ses récits autobiographiques. Dans Matinées mexicaines, deux autres essais, « Indiens et divertissement » et « Danse de la germination du grain », font écho à son récit de la danse des serpents. Mais sa réflexion est plus ancienne, ayant commencé avant la Première Guerre mondiale, comme on le verra.
Quatre ans après Lawrence, l’un de ses amis se saisit du sujet pour le hisser à la hauteur d’une fable :
Nus depuis la gorge jusqu’au nombril, le corps foncé badigeonné de raies blanches […] le visage rendu inhumain par des bariolages d’écarlate, de noir et d’ocre, deux Indiens arrivaient en courant le long du sentier. […] Ils s’approchaient sans mot dire, courant sans bruit dans leurs mocassins en peau de daim. L’un d’eux tenait un plumeau ; l’autre portait, dans chacune de ses mains, ce qui paraissait être de loin trois ou quatre bouts de corde épaisse. L’une des cordes se tordait de façon inquiétante, et Lenina vit soudain que c’étaient des serpents34.
La scène se passe dans la réserve hopi et introduit dans Le Meilleur des mondes le motif du sauvage, dont le roman conte les effets, à mesure qu’il jette le doute sur la perfection d’un monde scientifique réglé par des protocoles et des hiérarchies supposés rationnels. La description qu’Aldous Huxley donne de la danse est inexacte, pathétique et sanglante, outrances destinées à exagérer l’antagonisme entre les Indiens et leurs visiteurs venus du monde nouveau aseptisé. Ce qui est le propos de ce conte philosophique dont le héros est John. Son passage de la réserve indienne où il a grandi au « meilleur des mondes » finit en désastre. Ainsi la danse des serpents introduit-elle le motif critique dans ce livre devenu par son succès l’un des plus influents de l’entre-deux-guerres.
Si l’on glisse du rituel à l’ensemble des signes distinctifs des religions hopi et zuñi, l’inventaire des reprises et détournements pourrait être sans fin. Des poupées katchinas, sœurs de celles que Warburg a vues et photographiées chez Voth et Keam, figurent dans les collections ethnographiques des musées américains et européens dès la fin du XIXe siècle. Nolde en dessine un exemplaire vu au Museum für Völkerkunde de Berlin en 1911-1912 et en introduit dans ses natures mortes peu après, non sans en modifier librement les formes et les couleurs. En 1925, Sophie Taeuber-Arp s’en inspire pour des costumes dans le style hopi, conçus pour les danses qu’elle exécute avec sa sœur Erika Schlegel. Or celle-ci a vu ses premières poupées katchinas à Zurich, où elles ont été rapportées et exposées par Carl Gustav Jung, lequel a séjourné peu auparavant au Nouveau-Mexique et rencontré un chef hopi. Il a été reçu à Taos par la mécène et collectionneuse Mabel Dodge Luhan, qui accueille aussi Lawrence et se montre une lectrice sévère de sa description de la danse du serpent35. Autre habituée de Taos, où elle a rencontré Lawrence, Georgia O’Keeffe a plusieurs fois peint des katchinas dans les années 1930, quelques années avant que Max Ernst et André Breton n’en collectionnent lors de leurs séjours américains. Dès 1936, ils en ont montré dans l’Exposition surréaliste d’objets dans la galerie de Charles Ratton. Encore ne cite-t-on ici que quelques apparitions des katchinas dans les arts de l’entre-deux-guerres. Ce n’est qu’un exemple de l’extension des primitivismes dans cette période – un exemple de ces phénomènes culturels qui intéressent écrivains et peintres, psychanalystes et poètes sous le signe du primitif.
1
VOIR, NE PAS VOIR
Que peut-on voir des arts primitifs en Europe dans les dernières décennies du XIXe siècle ? Qu’en sait-on, qu’en lit-on, dans les revues illustrées et les travaux des ethnologues ? Selon quelles catégories anthropologiques, historiques et esthétiques sont-ils considérés ? Leur degré de visibilité et leur degré de compréhension sont les sujets de ce chapitre.
Voyageurs et explorateurs
Que les objets fabriqués par les peuples d’Afrique, d’Océanie et des Amériques diffèrent de ce que l’Europe a produit depuis l’Antiquité, cette constatation relève de l’évidence, largement connue. Elle l’est à proportion de la multiplication des voyages des explorateurs et autres marins navigateurs, marchands ou pêcheurs à la poursuite des cétacés, tel le narrateur de Moby Dick.
Herman Melville décrit ainsi une taverne de marins :
À l’opposé le mur du fond de ce hall était tout recouvert d’une panoplie barbare de massues et de lances, les unes entièrement incrustées de dents luisantes, semblables à des scies d’ivoire, les autres ornées de touffes de cheveux humains ; une de ces lances en particulier, en forme de faucille, avait un long manche courbe comme la morsure d’une grande faux dans l’herbe. Vous trembliez en la regardant ! Vous vous demandiez quel anthropophage atroce avait bien pu aller à la moisson de la mort avec un outil si horrible et si tranchant1.
Melville a navigué dans le Pacifique et séjourné aux Marquises, ayant déserté du baleinier Acushnet en juillet 1842, puis à Tahiti et Hawaï, épisode dont il tire la matière de son premier livre, Typee : A Peep at Polynesian Life, publié à Londres et New York en 1846. Il s’en souvient dans Moby Dick quand il invente un harponneur tatoué, Queequeg, et décrit le culte que celui-ci rend à son « idole » :
[Il] tenait tout contre son visage sa petite idole noire. Il la regardait attentivement et, à l’aide d’un couteau, lui tailladait doucement le nez tout en chantonnant à voix basse et pour lui-même, comme c’était la coutume païenne. […] Je le regardais faire avec beaucoup d’intérêt. Tout sauvage qu’il était, et avec cette figure hideusement abîmée – pour mon goût du moins – de lui se dégageait quelque chose de pas du tout déplaisant. On ne peut pas cacher son âme ! À travers tous ces affreux tatouages je crus sentir la présence d’un cœur simple et honnête et, dans ses grands yeux profonds, la promesse d’un esprit pouvant défier mille diables2.
Ce « cannibale » incarne dans Moby Dick courage, constance et amitié, de même que dans Typee Melville décrit des Marquisiens non en sauvages sanguinaires mais en hommes susceptibles de générosité et de confiance. Si la « petite idole noire » de Queequeg n’est assurément pas la mention la plus précoce des statuaires du Pacifique, du moins est-elle l’une des plus anciennes dans le genre romanesque.
En matière de littérature, la plus riche sur le sujet est néanmoins celle des explorateurs, qui se développe dans la seconde moitié du XIXe siècle. La moins pauvre du moins : la part ethnographique est réduite, l’essentiel étant géographique, géologique, climatologique, zoologique et botanique. Sur les populations humaines, les informations concernent essentiellement les types physiques – physionomies, proportions anatomiques –, les usages vestimentaires – et plus particulièrement la nudité, constamment rappelée et représentée –, les coiffures, les tatouages et scarifications. Des observations s’attachent à l’architecture et à la disposition des villages, à l’agriculture, la chasse ou la pêche. D’autres cultivent cette obsession de la littérature exotique de la période : le cannibalisme. On dirait parfois que ce sont ses preuves que les explorateurs cherchent d’abord, sûrs de captiver leur public avec des détails peu ragoûtants. Cultes, sorts et autres divinations sont aussi décrits, sommairement. Les statues et objets qui y participent sont donc occasionnellement évoqués.
Ainsi de l’Afrique, qui fait l’objet des explorations les plus retentissantes. En 1861 paraît l’édition anglaise des Explorations and Adventures in Equatorial Africa de Paul Du Chaillu, rapport ur ses pérégrinations au Gabon. L’écho est d’autant plus fort que l’ouvrage suscite controverses et polémiques internationales et la traduction française paraît dès 1863. Or, s’il consacre l’essentiel de son livre à ses chasses au gorille et au léopard, Du Chaillu mentionne ce qu’il nomme idoles. Sa curiosité est manifeste, aussi manifeste que sa répulsion face à des statues qu’il dit grossières et bariolées, termes péjoratifs. Les deux attitudes semblent indissociables : la volonté de voir qui va de pair avec le devoir de décrire et le dégoût devant ce qu’il ne saurait considérer comme relevant de ce que l’on nomme art. Ainsi, dès le début de ses Voyages et aventures dans l’Afrique équatoriale : « Toutes ces idoles sont très grandes, grossièrement taillées et sculptées. Le peuple paraît en faire beaucoup de cas. J’ai offert d’une seule cent francs, mais on m’a répondu que je ne l’aurais pas pour cent esclaves, ce qui est une manière de dire que ces idoles ne sont pas à vendre3. » Ou, chez les Fangs, cette description d’une « idole » propriété d’un chef : « C’est une figure de femme, en bois, presque de grandeur naturelle, dont les pieds sont fourchus comme ceux d’un cerf. Elle a des yeux de cuivre ; une de ses joues est peinte en rouge et l’autre en jaune. Elle porte un collier de dents de léopard. Elle a, dit-on, une très grande puissance, et dans de certaines circonstances elle fait des signes de tête4. » Plus remarquable encore, un autre épisode, qui se situe là aussi en pays fang : Du Chaillu est admis à voir l’« idole » d’un autre chef : « une figure de femme avec des yeux de cuivre et une langue fabriquée avec une lame de fer affilée comme une épée. […] J’essayai d’acheter cette déesse ; mais, toute laide qu’elle était, Damagondai ne voulut me la céder à aucun prix5 ». Du Chaillu obtient néanmoins d’emporter la déesse « des esclaves à un taux raisonnable » et il en publie la gravure en marge de son récit. Il fait de même d’une statue découverte chez les Ashiras, « ogana » qu’il définit comme une gardienne des maisons6. Mêmes notations dans son deuxième ouvrage, publié en 1868 après son second voyage. Chez les Aponos, il veut à nouveau acquérir une « idole », conservée dans une « cabane consacrée (Mbuiti) », mais, continue-t-il, « je la trouvai si massive, si lourde, et en même temps si grossièrement indécente que je fus obligé de la refuser. […] Comme toutes les idoles que j’ai déjà vues, celle-ci était du sexe féminin7 ». Chez les Ishogos, il aperçoit « une monstrueuse figure de bois8 » et, chez les Ashangos, il assiste au culte du « Mbuiti (en d’autres termes la sainte patronne du pays), […] une monstrueuse et indécente figure de bois, du sexe féminin. […] L’idole, dressée au fond d’une cabane étroite et basse de quarante à cinquante pieds de long sur dix de large, était bariolée de rouge, de blanc et de noir9 ». Une décennie plus tard, les récits du marquis de Compiègne présentent la même alliance d’intérêt et de dédain. Intérêt puisque l’illustration sur laquelle s’ouvre le deuxième volume de l’exploration du bassin de l’Ogooué figure, assez sommairement dessinées, « les idoles des Pahouins, des Gallois et de Ivéia rapportées par MM. Marche et de Compiègne ». Dédain quand, dans un village de ceux qu’il nomme Ivilis, Compiègne note : « Ces bonnes gens avaient là le sanctuaire d’un de leurs fétiches les plus vénérés, une statue de bois, de grandeur naturelle, dont la figure, peinte en blanc et en rouge, ressemblait à s’y méprendre à celle qu’affectait autrefois, au Cirque, le clown Boswell10. »
Les explorateurs britanniques avancent des comparaisons du même genre pour suggérer au lecteur ce qu’ils ont vu. Ainsi Henry Morton Stanley, chez les « indigènes du Roua, de l’Ougouba et de l’Ouboudjoué » :
L’amour de la sculpture est également l’un des traits distinctifs des Vouagouha et des Vouaboudjoué. Leurs villages sont ornés de statues de bois. Souvent les portes de leurs demeures ont un ornement sculpté, qui ressemble à une face humaine, et les arbres des forêts qui séparent les deux pays présentent fréquemment des spécimens de leur ingéniosité comme sculpteurs. Nous avons vu quelques indigènes porter des médailles en bois, où se trouvait reproduite la caricature des traits d’un homme11.
Ainsi, Verney Lovett Cameron :
En arrivant, le devin s’assit par terre, au milieu de ses sonneurs et commença un chant monotone. Il accompagna ce récitatif du craquètement d’un double grelot en vannerie, qui avait la forme d’un haltère. […] Un panier orné de petites peaux de bêtes, et dont une calebasse composait le fond, était le principal instrument du féticheur. Ce panier était rempli de coquilles, de petits bonshommes de bois, de corbeilles minuscules, de paquets d’amulettes, d’une masse de débris hétérogènes12.
Verney Lovett Cameron poursuit ironiquement : « La méthode divinatoire se rapprochait beaucoup de celle qu’ont adoptée de vieilles dames qui, dans un pays infiniment plus civilisé, se figurent qu’elles peuvent connaître l’avenir en regardant les parcelles de thé qui sont au fond de leur tasse. » Autrement dit, les vieilles dames anglaises.
Au même moment, un autre Britannique, Wilfred Powell, parcourt les îles de Mélanésie, matière de son récit Wanderings in a Wild Country, sous-titré Three Years Amongst the Cannibals of New Britain, qui paraît à Londres en 1883. On y trouve, en dépit de ce parti pris pathétique, quelques mentions d’objets observés et dessinés par ses soins. Le volume s’ouvre sur une gravure, « Toberran House, New Ireland » qui est vraisemblablement la première représentation de statues de ce genre diffusée en Europe. On y trouve aussi des dessins d’armes, de boucliers, d’instruments de musique et de masques confectionnés à partir de crânes humains.
Les collections : Londres, Berlin, Paris
La publication de ces récits de voyage est l’une des conséquences de la course vers les régions inconnues de l’Afrique, de l’Océanie et des Amériques qui s’engage entre les puissances européennes, à des fins scientifiques et, plus encore, à une fin politique et économique, la colonisation de ces territoires. Une autre conséquence est l’arrivée en quantités croissantes d’artefacts venus de ces régions, la constitution de collections et d’un marché rapidement international, en Europe et à destination de musées nord-américains. Contrairement à ce qu’a donné à croire le récit ordinaire du primitivisme, la présence d’objets en provenance du Pacifique ou du Congo dans les métropoles européennes à la fin du XIXe siècle n’a rien d’une rareté. Ce serait plutôt une évidence – une évidence vieille de plusieurs décennies. La question n’est pas celle de leur présence, mais celle de la capacité à les considérer, selon quelles notions et quelles habitudes de pensée. Si l’on étudie les situations allemande, britannique et française, il apparaît que, selon des chronologies différentes, des ensembles conséquents de ces pièces y sont aisément visibles au XIXe siècle – pour qui veut et sait les voir.
Le cas le plus précoce est celui des collections britanniques. Le British Museum, fondé sur les collections de Hans Sloane, ouvre dans la Montagu House, quartier de Bloomsbury, le 15 janvier 1759. Si ce dernier s’est principalement intéressé à la botanique et à la zoologie, il reçoit bientôt des objets rapportés des trois voyages de James Cook. Parmi eux, dans la « South Seas Room » aménagée en 1780, la fameuse tête de dieu hawaïen de plumes et de nacre rapportée du troisième et dernier voyage du navigateur, ainsi que de nombreuses autres pièces polynésiennes ou maories. Les travaux de Sydney Parkinson, William Hodges et des autres dessinateurs qui participent aux expéditions font connaître les armes, les instruments de pêche ou de culture, parmi lesquels des objets sculptés. Les éditions successives des récits des voyages, de 1771 pour le premier à 1784 pour le dernier, abondamment réimprimées jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, incluent un volume de planches. La première traduction allemande paraît en 1772, la première française en 1774, toutes deux illustrées des mêmes images. Nombre des pièces rapportées par les expéditions de Cook sont aussi visibles dans les cabinets de curiosités de John Hunter – dit Hunterian Museum –, de George Humphrey13 et d’Ashton Lever. Ce dernier fonde en 1770 son Leverian Museum dans son manoir, puis il le déplace à Londres en 1773. Renommé Holophusicon ou Museum Leverianum, il est racheté en 1784 par James Parkinson après la ruine de Lever, et demeure ouvert jusqu’à sa dispersion aux enchères en 1806. Il accumule des ensembles archéologiques, zoologiques, paléontologiques – et ethnographiques dans les vitrines de la salle Sandwich garnies d’objets du troisième voyage de Cook : Nouvelle-Zélande, Hawaï, Tonga, Tahiti. Une brochure catalogue paraît en 1790. En 1806, la vente aligne 7 800 lots. Une partie est rachetée par Isidore Leroy de Barde, émigré français, peintre et érudit14. D’autres circulent au Royaume-Uni, puis sur le continent, entre amateurs et marchands.
Autre conséquence, les voyages de Cook suscitent des vocations de missionnaires, afin d’évangéliser les « païens » du Pacifique. La fondation en 1795 de la Missionary Society, rebaptisée London Missionary Society (LMS) en 1818, s’inscrit dans cette logique. Pour s’en tenir à la question de la visibilité, la LMS, si elle détermine la destruction de très nombreuses « idoles » jetées à la mer ou brûlées, contribue néanmoins à la connaissance de celles que ses pasteurs ont emportées comme des trophées jusqu’en Grande-Bretagne. Elles y sont exposées à partir d’avril 1815, date de l’ouverture du Missionary Museum, dont le succès est rapide. Un guide de Londres publié en 1817 en vante les curiosités, « la plupart d’Afrique et des îles des mers du Sud15 ». Parmi celles-ci, les « family gods » de Pomaré, roi d’« Otaheité », ont tant de succès qu’elles illustrent la première page d’une livraison des Missionary Sketches parue en octobre 1818, à peine un mois après leur arrivée à Londres. À partir de 1820, le musée ouvre deux jours par semaine. Si les visiteurs y sont attirés par une peau de girafe ou une corne de rhinocéros, ils y découvrent aussi les « idoles » païennes rapportées comme autant de preuves de conversions. Le premier catalogue du musée, publié en 1826, affirme que « les objets les plus précieux et impressionnants de cette collection sont les nombreuses et (dans certains cas) horribles idoles qui ont été rapportées des îles des mers du Sud, d’Inde, de Chine et d’Afrique16 ». Outre celles de Tahiti, y sont exposées les pièces rapportées en 1825 des îles Sandwich par William Ellis. En 1835, une salle destinée aux collections est construite dans la nouvelle Mission House, Blomfield Street. Aucune des gravures qui la décrivent dans The Illustrated London News en 1843, The Lady’s Newspaper en 1853 et une seconde fois dans The Illustrated London News en 1859 ne néglige le monumental « staff god » rapporté de Rarotonga en 1834 par John Williams, qui succède aux dieux tahitiens au palmarès de l’étrangeté exotique17. Publiée autour de 1860 après un réaménagement de la présentation en 1859, une version mise à jour du catalogue distingue histoire et histoire naturelle et propose un classement géographique par vitrines, deux pour l’Océanie, trois pour l’Afrique et Madagascar. Jusqu’au dépôt de ses meilleures pièces au British Museum en 1910, le Missionary Museum demeure accessible aux visiteurs.
Parallèlement, le British Museum s’accroît régulièrement de nouvelles séries. Les plus connues relèvent de l’archéologie égyptienne et gréco-romaine, mais, à partir du fonds constitué par les apports de Cook, de ceux qui ont navigué avec lui et des capitaines qui ont poursuivi l’exploration du Pacifique, tels George Vancouver et Thomas Gilbert, les départements ethnographiques se développent tout au long du XIXe siècle18 – en relation avec le développement de l’empire colonial britannique en Afrique et en Océanie. Pour l’Afrique, par exemple, en 1818 le British Museum reçoit la collection rapportée d’Afrique de l’Ouest par Thomas Bowdich19 – de Gold Coast et du royaume ashanti où il accomplit une mission diplomatique en 1817. Il en publie le récit en 1819, Mission from Cape Coast Castel to Ashantee.
Pour prendre la mesure du fonds ethnographique du British Museum dans la période victorienne, il suffit de se reporter au Handbook to the Ethnographical Collections publié en 1910 pour y observer à la fois la continuité des collectes et l’effort de classification géographique des objets. « À aucun moment dans l’histoire du monde, une nation n’a exercé son autorité sur autant de races primitives que la nôtre à l’heure actuelle », affirme en préambule de ce guide son auteur, le conservateur Charles H. Read, observation qui a du moins le mérite de sa clarté20. Ce que confirme l’abondance des photographies et des gravures en couleurs et en noir et blanc – 273 illustrations et 15 planches d’une page – présentant selon la géographie sections australiennes, océaniennes et africaines. « Un choix restreint dans un matériel immense », ce dernier en « accroissement continu21 » : ainsi présente-t-il cependant son ouvrage et c’est en effet l’abondance et la variété des collections qui s’imposent à la vue. « Bien des spécimens les plus anciens de la galerie sont liés aux entreprises et explorations britanniques, ce qui ajoute à leur intérêt », continue-t-il, énumérant Cook, Vancouver et la LMS, façon de rappeler aussi l’ancienneté du British Museum, vieux d’un siècle et demi quand paraît ce guide, mis à jour plusieurs fois par la suite.
L’hypothèse d’une accessibilité précoce se vérifie dans les pays germaniques, bien que le processus y soit plus tardif qu’en Grande-Bretagne. L’exemple le plus flagrant est celui des collections rapportées de Nouvelle-Guinée et des archipels proches22. En 1860, à Hambourg, Johann Cesar VI Godeffroy (1813-1885), à la tête de l’entreprise de commerce maritime qui porte son nom, donne mission à ses navires de collecter des objets et de lui adresser des descriptions. Pour les conserver, il fonde en 1861 le musée Godeffroy et celui-ci s’accroît des découvertes de capitaines tels que Georg Levison et Alfred Tetens23. En 1872, le musée publie un journal, où sont présentées les acquisitions à mesure qu’elles sont cataloguées. Un catalogue est publié en 1881, sous la direction de Johann Schmeltz et Rudolf Krause, illustré de plusieurs planches. Quand il paraît, la faillite de la société Godeffroy a été prononcée, mais les collections ne disparaissent pas : ses séries sont acquises par différentes institutions savantes à Hambourg, Leipzig et Berlin. Aux collectes de la firme Godeffroy s’ajoutent puis succèdent dans ces îles d’autres campagnes ethnographiques, qui s’accélèrent au rythme de la colonisation allemande et de l’implantation de comptoirs. De 1874 à 1876, le navire de guerre Gazelle parcourt ces mers du Sud, aménagé pour l’occasion afin de transporter plus aisément les œuvres. Les ensembles réunis par les savants embarqués sont donnés au musée de Berlin et exposés par lui en 1880. Mais, dès 1877, le musée édite un livret peu coûteux illustré de planches en couleurs figurant une partie de ces objets – statues, masques, frises, etc. Des colons installés sur place se livrent à la même collecte et expédient leurs prises en Europe. La compagnie maritime Hernsheim & Robertson, elle aussi hambourgeoise, suit l’exemple de Godeffroy, mais sans s’y ruiner.
L’énumération de tous ceux qui se livrent dans cette période à des formes plus ou moins commerciales d’ethnographie inclut Otto Finsch, conservateur au musée de Brême à partir de 1864, qui opère en Micronésie entre 1879 et 1882, puis 1884 et 1885, des missions financées par un consortium berlinois. Du premier voyage il rapporte environ 4 000 objets, et du second environ 3 000. Une partie est acquise par le Naturhistoriches Museum de Vienne. Le Völkerkundemuseum de Berlin en reçoit plus de 2 000. Celui de Munich se fournit auprès d’un autre explorateur, le docteur Christian Schneider, embarqué sur l’Albatros en 1882-1883. Les collectes sont si nombreuses qu’en 1905 le gouverneur colonial Albert Hahl répond à Felix von Luschan, directeur du Völkerkundemuseum qui désire augmenter ses séries de ce qui se nomme alors Nouvelle-Poméranie : « Les objets ethnographiques se font rares et chers. Envoyez-nous quelqu’un de compétent […] qui aura pour tâche de sauver ce qu’il reste d’une époque et d’une culture révolues24. » La concurrence entre les musées des principales villes allemandes a pour conséquence l’appauvrissement des ressources et son corollaire, production d’objets destinés à la vente par des sculpteurs autochtones qui travaillent désormais pour satisfaire la demande occidentale. Ils approvisionnent Berlin, Brême ou Hambourg, mais aussi Chicago, dont les collecteurs du Field Museum sont très actifs.
La crainte d’un épuisement des objets suscite un surcroît d’expéditions, afin de se saisir de ce qui ne l’a pas encore été. Au cours de celle de Karl Sapper et Georg Friederici en 1908, ce dernier constate que « les prix demandés par les indigènes de la basse vallée du Sepik ont été dévoyés et cela à cause d’un prospecteur nord-américain, George Dorsey25 ». Ce qui n’empêche pas Friederici d’envoyer 898 objets au Völkerkundemuseum et de recevoir les remerciements de von Luschan : « Cette collection comprend un nombre inhabituel d’objets hors du commun et des pièces d’une beauté exceptionnelle d’une valeur inestimable […]26. » Le même Friederici repart en 1909 pour l’expédition Hanseatische Südsee, financée par une société établie à Brême, et encore l’année suivante, à ses propres frais. Au même moment, le musée de Hambourg monte la Hamburger Südsee Expedition : 9 400 objets collectés en Mélanésie, 8 366 en Micronésie, publiés en 29 volumes et exposés pour les plus remarquables en juin 1912 à Hambourg27. Richard Parkinson opère dans l’archipel Bismarck, explore des îles encore mal connues et amasse des séries considérables. « Dans l’exposition montée à Dresde en 1884-1885 sur les objets de Nouvelle-Guinée, note ainsi Klaus-Jochen Krüger, la plupart furent catalogués comme ayant été collectés par Richard Parkinson28. » À Halle, ce sont les découvertes de Franz Hellwig entre 1895 et 1898 qui sont acquises pour le Kunstmuseum Moritzburg : 1700 pièces de Nouvelle-Guinée. À Brême, outre les missions citées plus haut, l’Übersee-Museum se fournit à partir de 1906 auprès de Karl Nauer, qui parcourt les mers du Sud pour la Norddeutscher Lloyd. À Hambourg, l’entreprise commerciale fondée par Johann Friedrich Gustav Umlauff (1833-1889) et continuée par ses héritiers approvisionne aussi bien collections ethnographiques que parcs zoologiques, en Allemagne et ailleurs : les colonies de Nouvelle-Guinée sont l’un de ses territoires de collecte principaux. Ces opérations donnent lieu à des publications illustrées en noir et blanc et en couleurs : par exemple, à Leipzig en 1887 le premier livre de Richard Parkinson, Im Bismarck-Archipel, avec ses planches. C’est dire, sans tendre à l’exhaustivité, combien il est aisé d’accéder à une perception directe de la sculpture de l’aire culturelle papoue dans les principales villes allemandes dès les deux dernières décennies du XIXe siècle ; et combien le voyage d’Emil Nolde, qu’abrège la Première Guerre mondiale, n’a rien d’une aventure.
Il en est de même de l’Afrique, à laquelle les musées allemands s’intéressent avec autant d’efficacité, Cameroun et Togo étant alors colonies de l’empire. Là aussi, les noms des collecteurs sont bien connus : Gustav Nachtigal, Wilhelm Joest, Gustav Conrau, Hans von Ramsay, Hans Meyer, Robert Visser, Werner von Grawert, Georg Zenker, entre autres. Ils sont officiers, voyageurs ou marchands. Leurs dons au Völkerkundemuseum de Berlin29 en font au tournant du XXe siècle l’un des musées les plus riches en artefacts africains. Parmi eux, un nom plus connu, Leo Frobenius, dont le musée acquiert en 1909 un couple dogon. Or Frobenius, avant même de se rendre en Afrique en 1904, publie en 1898 son ouvrage Die Masken und Geheimbünde Afrikas – masques et sociétés secrètes – accompagné de dizaines d’illustrations d’après les collections allemandes : ce qui suffit à suggérer leur variété et leur abondance.
Reste la France, qui ne se signale ni par sa précocité ni par l’excellence de son organisation muséale. Quand, en 1890, Ernest Théodore Hamy publie Les Origines du musée d’ethnographie, il insiste dès l’avant-propos sur la lenteur de sa création : proposée par la Convention en l’an III – 1795 –, celle-ci n’est effective que près d’un siècle plus tard, après une tentative en 1831. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans le détail des querelles entre administrations et rivalités personnelles qui ont retardé la création d’un musée ethnographique, déplaçant les objets du Louvre au Musée naval ou à la Bibliothèque royale puis nationale. Ce n’est pas que les objets manquent :
La Recherche (1837), La Bonite (1838), L’Astrolabe et La Zélée (1843) ont rapporté de leurs voyages d’importantes collections exotiques, que le ministre de la Marine dépose au Musée naval. Le ministre du Commerce y envoie les collections recueillies en Chine par M. de Lagrenée (1843), l’administration des Musées royaux y place, en attendant la formation d’une petite galerie spéciale, les Collections d’archéologie américaine provenant de Latour-Allard, de Séguin et de Franck. Le roi Louis-Philippe fait remettre diverses pièces remarquables qu’il a reçues du négus d’Abyssinie (1842) et plus tard les curieux objets d’Océanie que lui ont présentés les missionnaires apostoliques Pompallier et Douare, et parmi lesquels on remarque le casse-tête de Tupaea, le grand chef de Touaranga30.
À en croire un inventaire du Musée naval dressé en 1856, il y aurait alors, dans ce seul musée, 536 objets d’Afrique et 819 du Pacifique31.
C’est plus qu’il ne peut en exposer, d’autant que la plupart de ses salles, dans le Louvre, sont consacrées à l’histoire de la marine française : maquettes de navires, trophées, portraits d’amiraux. Les pièces ethnographiques, à en juger d’après les gravures parues dans le Paris illustré d’Adolphe Joanne ou dans Le Magasin pittoresque, sont arrangées en panoplies – lances et sagaies – et le classement – si l’on peut employer ce mot – juxtapose bouddhas du Laos ou du Cambodge et massues du Pacifique. La description qu’en donne Joanne est explicite sur ce point : « Il forme une curieuse collection d’armures indiennes, de pagodes, de parures sauvages, trophées des excursions scientifiques de notre marine. Un grand nombre d’autres objets, provenant de l’Afrique centrale, ont été donnés par Mr Delaporte, consul au Caire32. » Entre le Musée chinois et le Musée américain, il « renferme une foule d’objets de toute sorte, produits de l’art ou de l’industrie des peuples de l’Asie, de l’Afrique de l’Amérique et de l’Océanie33 » : la description date de 1876. On en tire deux déductions : que cette « foule d’objets » est visible au Louvre et qu’elle l’est dans le plus grand désordre.
Il est clair qu’elle n’intéresse pas l’administration des beaux-arts qui les disperse et les oublie. Selon Hamy :
Les collections spéciales offertes à l’État à la suite de l’Exposition universelle de 1867 furent mises dans des magasins, notamment à Saint-Germain et au Muséum d’histoire naturelle, où je les ai retrouvées depuis, et le ministère de l’Instruction publique abandonna si complètement tout nouveau projet de musée spécial, qu’à diverses reprises, et notamment en 1874, des collections offertes par des correspondants étrangers ont été versées dans des cabinets de province34.
Pour l’Exposition universelle de 1878, il organise un Musée des missions ethnographiques temporaire où il juxtapose l’Amérique du Sud – Pérou, Équateur, Colombie –, l’Amérique du Nord – la collection Pinart, Colombie-Britannique, Alaska –, des séries d’Asie centrale installées « tant bien que mal, en quelques jours, sur le grand vestibule », des estampages de relief cambodgiens et « deux panneaux d’objets très curieux recueillis chez diverses tribus sauvages du Laos », des produits des fouilles syriennes « dans un petit coin demeuré libre ». Hamy poursuit l’inventaire :
L’Afrique fut représentée sur un des paliers de l’escalier par les antiquités des Canaries de la collection Verneau, que j’avais fait réparer de mon mieux, et par deux panoplies du Gabon et de l’Ogooué […]. Sur l’autre palier, l’Océanie était rappelée par les objets populaires envoyés de Célèbes par le docteur de La Savinière et quelques pièces anciennes et modernes adressées des îles Hawaï par M. Ballieu, consul à Honolulu35.
Promiscuité des œuvres, exiguïté des espaces, incohérence historique et géographique n’empêchèrent pas le succès : « Pendant six semaines le public se pressa dans les trois salles qui lui étaient ouvertes, heureux de pouvoir étudier tant de richesses nouvelles et d’entendre les conférences des missionnaires expliquant eux-mêmes leurs travaux et leurs découvertes36. »
L’Exposition universelle au Champ-de-Mars du 1er mai au 31 octobre de la même année 1878 est l’occasion d’un deuxième pêle-mêle :
Une restitution partielle par M. Soldi, à l’échelle du dixième, d’une des portes de la citadelle d’Angkôr-Tôm, […], deux énormes pyramides de vases péruviens, […], la fontaine de Concacha moulée cette fois en ciment. […] Les autres murs étaient couverts de panoplies et de cartes itinéraires, ou garnis d’armoires, renfermant des choix d’objets provenant des missions André de Cessac, Crevaux, Harmant, Marche, Pinart, Ruffray, Rivière, de Sainte Marie, de Ujfalvy, Wiener, etc.37
Et deuxième réussite, selon Hamy : « Ainsi disposée, la salle des Missions fut extrêmement appréciée des visiteurs, et une fois encore le grand public montra l’intérêt qu’il prenait à ces choses lointaines, qui lui étaient si longtemps demeurées tout à fait étrangères et vers lesquelles le portent de plus en plus les nécessités du moment. » En 1880 enfin, en raison du succès de curiosité obtenu par le musée temporaire, l’arrêté décidant la création du musée au Trocadéro est signé par Jules Ferry, quoique le choix du palais, lui-même un héritage de 1878, ne soit pas le plus judicieux : il n’a alors ni système de chauffage ni système d’éclairage38. « Dernier venu de tous les musées de même ordre que possèdent la plupart des grandes villes de l’Europe, le Musée d’ethnographie du Trocadéro avait fort à faire pour conquérir, au milieu de ses émules, une place en rapport avec l’importance de la capitale où il se trouvait institué. Il a fallu dix ans d’efforts continus pour arriver à ce résultat », conclut Hamy en 1890, autocongratulation hâtive si l’on juge de l’état des salles d’après les photographies qui en subsistent39.
À cette date, et pour certains depuis plusieurs décennies, les « cabinets de province » qu’Hamy mentionne avec quelque dédain possèdent et présentent des collections remarquables. Ainsi de celui de Toulouse qui reçoit dès 1841 les collections océaniennes données par Gaston de Roquemaurel, second de Dumont d’Urville à bord de L’Astrolabe. Ainsi de celui de Boulogne-sur-Mer, qui reçoit en 1875 la collecte réalisée par Alphonse Pinart en Alaska auprès des Yupiit de masques polychromes jusqu’alors inconnus. Souvent accrochés dans les musées d’histoire naturelle, des objets rapportés par des navigateurs sont conservés à Marseille, Nantes ou La Rochelle – villes portuaires. Autre source d’informations et d’images : les récits des missions, en particulier ceux de Dumont d’Urville – dont cependant la publication en 23 volumes, dont 4 de cartes et planches, s’étire de 1841 à 1855, pour une édition à faible tirage et très coûteuse, ce qui en restreint la diffusion. À cette date encore, Rome dispose depuis 1876 du Museo preistorico etnografico dont l’archéologue Luigi Pigorini a obtenu la création et qui conserve des pièces venues des collections vaticanes, traces de l’activité des ordres missionnaires. Deux décennies plus tard, Bruxelles a le sien, à Tervuren, d’abord Palais des colonies puis Musée du Congo belge, ouvert en 1910 mais décidé dès 1897 après le succès obtenu lors de l’Exposition universelle de Bruxelles de 1897 par sa section coloniale – et le « zoo humain » hébergeant deux cents Congolais dans de pseudo-villages africains.
Des savants
Au flux d’objets rapportés à partir de la fin du XVIIIe siècle répond celui des traités et essais qui se fondent sur les observations des voyageurs dans un premier temps et, dans un second, des missionnaires, naturalistes et ethnologues. Dans leurs ouvrages, des savants qui pour la plupart ne voyagent pas trouvent les éléments à partir desquels ils cherchent à comprendre ces nouveaux venus des sciences : les primitifs, aussi nommés « sauvages ». Dans la deuxième moitié du XIXe se développe en effet en Europe la passion du primitif. Cette passion se nourrit des documents qui s’accumulent dans les livres et les revues et de ceux qu’apportent l’archéologie et l’histoire des civilisations antiques. Histoire des religions, analyse des mythologies et anthropologie suscitent des vocations en nombre croissant, ce qu’encourage la création de chaires dédiées à ces disciplines au Collège de France, à Oxford ou à Berlin. L’histoire détaillée de ce phénomène intellectuel n’est pas notre propos et s’y engager écarterait de plus en plus de l’analyse des primitivismes artistiques40. Mais on doit du moins signaler quelques éléments de bibliographie afin de suggérer l’ampleur du processus et combien il est international. Au rang des ouvrages de référence se trouvent : en Grande-Bretagne, The Origin of Civilisation de John Lubbock en 1870, la première édition de Primitive Culture d’Edward Burnett Tylor en 1871, Custom and Myth d’Andrew Lang en 1884, Myth, Ritual and Religion du même en 1887, The Golden Bough de James George Frazer en 1890 ; en Allemagne, Anthropologie der Naturvölker de Theodor Waitz dont le premier volume paraît dès 1859, Der Fetischismus. Ein Beitrag zur Anthropologie und Religionsgeschichte en 1871 de Fritz Schultze, également auteur en 1900 de Psychologie der Naturvölker, Völkerkunde d’Oscar Peschel en 1874, puis les travaux de Leo Frobenius dont Die Geheimbünde Afrikas en 1894 ; en France, les volumes d’Alphonse Bertillon, dont Les Races sauvages est publié en 1882, d’Albert Réville dont Les Religions des peuples non-civilisés paraît à partir de 1883, ceux d’Armand de Quatrefages, dont ses Hommes fossiles et hommes sauvages en 1884, Les Primitifs. Études d’ethnologie comparée d’Élie Reclus en 1885. Le début du XXe siècle voit les premiers textes de Marcel Mauss qui multiplie notes de lecture et essais de synthèse dans L’Année sociologique. Un inventaire plus complet devrait ajouter des ouvrages américains, autrichiens ou italiens et marquerait l’importance peut-être plus forte encore de revues savantes internationales, dont L’Anthropologie en France, avec ses comptes rendus d’articles et livres parus dans d’autres pays.
Que ces auteurs soient loin d’être d’accord entre eux est un euphémisme, d’autant que l’un des enjeux de l’histoire des religions est la place qu’elle accorde au christianisme sous ses diverses interprétations. Dans une Europe encore très majoritairement chrétienne et alors que les missionnaires des églises catholique et protestante sont parmi les principaux acteurs du processus colonial, mais aussi des collectes d’objets, il y a là matière à affrontements virulents : entre Salomon Reinach et Alexandre Le Roy ou autour d’affirmations péremptoires de John Lubbock sur l’existence de peuples sans religion. Ces désaccords importent cependant moins à notre propos que quelques constats, qui sont de dénominateurs communs à la plupart de ces auteurs : leur curiosité pour les peuples primitifs et donc la part qu’ils prennent à travers leurs cours et leurs livres à la diffusion de ce savoir ; la généralisation de la méthode comparative qui se délivre des limites de la géographie et de l’histoire ; et, troisième donnée, l’incapacité de ces mêmes savants à se dégager d’un jugement qui tient les objets produits par ces peuples pour indignes de considération artistique. Autrement dit : la passion pour les primitifs et l’indifférence pour leurs arts.
L’abondance et la diversité des informations compilées et reprises sont comparables à celles des collections : mêmes causes et même contexte. Il serait donc superflu d’accumuler des exemples répétitifs. Il semble suffisant de renvoyer à la table des matières, aux notes et aux bibliographies des traités de Frazer, de Peschel ou de leurs homologues français. Deux exemples suffiront. Albert Réville, du Collège de France, traite dans le premier volume de ses Religions des peuples non-civilisés de l’Afrique – Cafres, Hottentots et « Boschmans » particulièrement car l’Afrique centrale est en 1883 encore mal connue –, des « indigènes des deux Amériques » – Esquimaux, Peaux-Rouges, peuples des Caraïbes, « tribus brésiliennes » et du sud du continent jusqu’aux Fuégiens ; et dans le second tome des « Polynésiens et leurs mythologies » – dont la notion de tabou –, des Maoris, des Papous, des Aborigènes d’Australie, des Dayaks de Bornéo et enfin des « religions finno-tartares » – dont le « shamanisme ». Deux ans plus tard, Les Primitifs de Reclus confronte les « Hyperboréens » – « Inoïts » [sic] –, les Apaches, les « Nilgherris » de l’Inde et les « Kolariens du Bengale ». Le degré de justesse des données dont ils font état ne peut que paraître limité, vu d’aujourd’hui, et ils sont tributaires de ceux dont ils citent les études, n’ayant aucun autre moyen de vérification que la confrontation des témoignages. Mais, cette réserve formulée, ils contribuent à la diffusion d’un savoir aussi étendu que possible et, parfois, d’une précision estimable. Gauguin aurait ainsi trouvé dans Réville une description des « marés » : une place « pavée de pierres polies », un « monticule carré soutenu de deux côtés par un grand mur de pierre ». « Tout autour s’alignaient des autels, des idoles de tikis, les demeures des prêtres, etc. Le maré était naturellement tout ce que l’on peut concevoir de plus tabou41. » Il y aurait trouvé aussi les dieux et les Aeroi, que Réville dépeint comme des confréries comparables aux ordres monastiques.
Le comparatisme est en effet systématique. Qu’il soit employé avec peu de rigueur est patent. Comme l’a observé E. E. Evans-Pritchard, « cette méthode […] est nommée à tort “méthode comparative” et elle comportait bien peu de comparaison analytique. Elle se bornait à rassembler des éléments qui semblaient avoir quelques caractères communs42 ». Légèreté qu’Evans-Pritchard attribue à l’inexactitude des sources et à la prédilection pour le pittoresque, pour ce qui est « bizarrerie, étrangeté, superstition et mystère » pour obtenir une « mosaïque abracadabrante ». Pour notre analyse, la question de l’exactitude des informations et de la justesse des hypothèses importe moins dans un premier temps que celle du nombre des travaux ayant le primitif pour sujet.
Le mode opératoire de ces comparaisons est restreint ou étendu. Restreint quand il confronte des attitudes, des mythes ou des rites qui ont tous été observés dans des populations primitives, où qu’elles vivent ou aient vécu. Les auteurs les plus opposés dans leurs conclusions procèdent tous ainsi. Le fait est si aisément vérifiable qu’il suffit de peu d’exemples à nouveau. Quand Marcel Mauss publie en 1903 avec Émile Durkheim leur étude « De quelques formes primitives de classification », ils introduisent indifférenciation entre animalité et humanité en ces termes :
Ici, l’individu lui-même perd sa personnalité. Entre lui et son âme extérieure, entre lui et son totem, l’indistinction est complète. Sa personnalité et celle de son fellow-animal ne font qu’un. L’identification est telle que l’homme prend les caractères de la chose ou de l’animal dont il est ainsi rapproché. Par exemple, à Mabuiag, les gens du clan du crocodile passent pour avoir le tempérament du crocodile : ils sont fiers, cruels, toujours prêts à la bataille. Chez certains Sioux il y a une section de la tribu qui est dite rouge et qui comprend les clans du lion des montagnes, du buffle, de l’élan, tous animaux qui se caractérisent par leurs instincts violents ; les membres de ces clans sont, de naissance, des gens de guerre tandis que les agriculteurs, gens naturellement paisibles, appartiennent à des clans dont les totems sont des animaux essentiellement pacifiques43.
Mabuiag est une île du détroit de Torres, entre Queensland et Nouvelle-Guinée, et les Sioux un peuple indien. À propos de la notion de « mana », ce même Mauss avance :
En Afrique, les Bantus, c’est-à-dire la plus grande et la plus dense des familles africaines, possèdent la notion tout à fait identique de nkissi, de moquissie, comme disaient les vieux auteurs. Les Ewhé, c’est-à-dire une bonne partie des Nigritiens, ont la notion de dzo. De ce fait, nous concluons déjà qu’il est nécessaire de remplacer pour toute l’Afrique, la notion de fétiche par celle de mana. En Amérique, nous avions déjà signalé l’orenda iroquois, le manitou algonquin, le wakan sioux, le xube pueblo, le naual du Mexique central. Il faut y joindre le nauala des Kwakiutl44.
Soit, ensemble, l’Afrique équatoriale, le Mexique et la Colombie-Britannique.
Le mode étendu s’applique par amplification historique et géographique du précédent : le champ s’ouvre à des cultures occidentales anciennes. Mauss est coutumier de tels rapprochements à très large spectre. L’introduction à son « Esquisse d’une théorie générale de la magie » énumère ses sources :
Ce sont les magies de quelques tribus australiennes ; celles d’un certain nombre de sociétés mélanésiennes ; celles de deux des nations de souche iroquoise, Cherokees et Hurons, et, parmi les magies algonquines, celle des Ojibways. Nous avons également pris en considération la magie de l’ancien Mexique. Nous avons encore fait entrer en ligne de compte la magie moderne des Malais des détroits, et deux des formes qu’a revêtues la magie dans l’Inde : forme populaire contemporaine étudiée dans les provinces du Nord-Ouest ; forme quasi savante, que lui avaient donnée certains brahmanes de l’époque littéraire, dite védique. Nous nous sommes assez peu servis des documents de langue sémitique, sans cependant les négliger. L’étude des magies grecques et latines nous a été particulièrement utile pour l’étude des représentations magiques, et du fonctionnement réel d’une magie bien différenciée. Nous nous sommes enfin servis des faits bien attestés que nous fournissaient l’histoire de la magie au Moyen Âge et le folklore français, germanique, celtique et finnois45.
Dès que des analogies se repèrent entre des situations si éloignées entre elles, l’analyse les réunit pour avancer les hypothèses que ces analogies sont censées faire apparaître : parce qu’il y a ressemblance, il peut y avoir continuité – une continuité que ne limitent ni le temps ni l’espace qui séparent les manifestations du même, ou du moins du comparable. Entre Hurons, Malais, Grecs, Celtes et Finnois, l’anthropologie reconnaît des comportements, des croyances ou des obsessions apparentés ou identiques. L’analyse parcourt les siècles et les lieux en tous sens. Il est alors possible de demander à une culture d’en éclairer une autre, qui n’a en apparence rien de commun. Ainsi Salomon Reinach peut-il user d’une métaphore géologique :
Le sauvage d’aujourd’hui ressemble à un banc de calcaire qui affleurerait dans un pays d’alluvions ; en creusant à une profondeur suffisante sous les sables, vous retrouverez ce même calcaire ; de même, en fouillant dans les profondeurs de l’histoire des peuples civilisés, vous retrouverez, trois, quatre, cinq mille ans avant Jésus Christ, la manière de penser de notre sauvage. Ainsi un sauvage, de nos jours, sert à nous faire entrevoir, je dirai même à nous faire connaître les opinions de nos ancêtres les plus lointains, appartenant à des nations qui ont mûri et qui se sont civilisées plus vite, mais qui ont passé par la phase où le sauvage que nous étudions se trouve encore46.
Adversaire de Reinach, dont l’athéisme lui est insupportable, Alexandre Le Roy, supérieur général des pères du Saint-Esprit, est néanmoins d’accord avec lui sur ce sujet : « Ces retardataires que nous appelons “Primitifs” […] ne nous représentent sans doute pas exactement l’humanité telle qu’elle fut à son origine ; mais de tous les peuples qui la composent, ce sont eux néanmoins qui paraissent en donner la plus fidèle image47. »
De cette méthode, qui postule l’unité et la continuité de la notion de primitif, le plus précoce théoricien, que citent Mauss, Reinach, Le Roy et tant d’autres, est Tylor. En 1871 paraissent les deux tomes de son ouvrage Primitive Culture : Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, suivis d’une seconde édition en 1873. Dès l’introduction, l’anthropologue dont les premiers travaux ont porté sur le Mexique ancien et qui a été introduit à la préhistoire par Henry Christy affirme qu’« il n’est pas nécessaire de s’attacher dans cette comparaison aux dates, aux positions géographiques ; par exemple les humains des anciennes habitations lacustres de la Suisse peuvent être rapprochés des Aztèques du Moyen Âge, et les Ojibwas de l’Amérique du Nord des Zulus de l’Afrique australe48 ». Il en voit les preuves dans la similitude des outils :
Couteau, doloire, ciseau, scie, racloir, poinçon, aiguille, lance, pointe de flèche, etc., ces divers objets, qui offrent quelques différences de détail, appartiennent aux races les plus variées. Mêmes observations à faire pour les occupations des sauvages. La coupe du bois, la pêche au filet et à la ligne, la chasse du gibier à la flèche et à la lance, la manière de faire du feu, la cuisine, le lissage des cordes et le tressage des paniers reparaissent avec une étonnante uniformité sur les tablettes des musées où se déroule la vie ethnologique des races inférieures, du Kamtchatka à la Terre de Feu, du Dahomey à Hawaï49.
Inférieures : si l’état primitif s’observe partout, il n’en reste pas moins pris dans une hiérarchie des stades de développement des sociétés, de l’archaïque au moderne. Non seulement les sociétés les plus modernes ont connu dans leur passé le stade archaïque, mais encore elles en conservent des survivances. Il demeure du primitif dans le contemporain, en Europe. Tylor poursuit par ces phrases qui, à leur date, ont pu déconcerter :
Quand nous comparons les hordes barbares aux nations civilisées, nous sommes frappés de voir combien les détails de la basse civilisation se retrouvent dans la haute civilisation sous des formes si peu différentes qu’on peut les reconnaître, et quelquefois même sous des formes tout à fait semblables. Voyez le paysan européen moderne employer la hache et la houe ; voyez-le faire bouillir ses aliments ou les rôtir sur des tisons ; remarquez la place que tiennent la bière et le vin dans ses calculs de bonheur ; écoutez ses contes sur les esprits qui hantent la maison voisine, et la nièce du fermier ensorcelée par des noueurs d’aiguillette, puis atteinte d’accès dont elle est morte. Prenez en un mot de ces choses qu’une longue suite de siècles n’a pas altérées, et vous aurez un tableau où vous verrez ne pas différer d’un cheveu le laboureur anglais et un nègre d’Afrique centrale.
Ce qui le conduit à cet autre postulat :
Ces pages seront si remplies de faits démontrant l’évidence des rapports correspondants de l’espèce humaine, qu’il est inutile d’en prolonger ici le détail. Mais je devais les mentionner pour écarter un problème qui eût pu compliquer la question, à savoir celui des races. Pour le but que nous nous proposons, il semble à la fois possible et désirable d’éliminer toute considération de variétés héréditaires ou de races humaines, et de considérer les hommes comme ayant une nature homogène, quoique placés à différents étages de la civilisation. Les détails de l’enquête prouveront, je pense, que les différents degrés de culture peuvent être rapprochés sans qu’on ait à s’occuper jusqu’à quel point diffère la couleur de la peau et des cheveux des tribus qui se servent des mêmes outils, suivent les mêmes coutumes, ou croient aux mêmes mythes50.
Tylor professe donc simultanément qu’il existe une hiérarchie dans le développement des civilisations et que celle-ci est indépendante de toute idée de « races humaines ». Seule l’histoire détermine les différences. Formulant le concept de survivance bien avant que ce dernier ne devienne courant, Tylor en conclut :
Le fait de survivance dans le développement social fournit des points de repère le long de la route qu’a parcourue dans son progrès la civilisation et qui sont pleins d’enseignement pour qui peut en déchiffrer la signification. Ils dressent au milieu de notre société actuelle comme des monuments primordiaux de la pensée et de la vie barbares. La constatation de ce phénomène plaide puissamment en faveur de l’opinion que les Groënlandais et les Maoris peuvent fournir à l’Européen plus d’un des traits du portrait de ses propres et plus lointains ancêtres51.
Ainsi le primitif est-il intégré dans l’histoire de l’humanité, stade de développement qui s’observe selon les époques en des lieux différents, mais universellement. C’est dire l’importance que gagne la notion dans les dernières décennies du XIXe siècle52.
Journaux et revues
Récits d’explorateurs et traités d’anthropologie ne sont cependant pas accessibles à tous. Ouvrages souvent coûteux, d’une lecture complexe pour les seconds, leurs connaissances sont diffusées plus largement par la presse, à des degrés divers de vulgarisation. Autant il paraîtrait peu vraisemblable qu’un jeune artiste consulte les planches d’ouvrages conservés dans des bibliothèques, autant il paraît acceptable de supposer que tel numéro d’un périodique largement diffusé fasse partie de la culture visuelle collective. Aussi a-t-on privilégié des publications destinées à un lectorat nombreux – Le Tour du Monde, La Nature ou Le Monde illustré – dans lesquelles ce matériau abonde. De même que des objets sont de plus en plus visibles à Londres, Berlin ou Paris, les récits et images des voyages et conquêtes se multiplient en effet dans la presse à partir des années 1860. Les images, ce sont des gravures exécutées d’après dessins ou photographies, puis, plus tard, des photographies imprimées. On y voit les paysages, la faune, la flore, les peuples visités et leurs objets, dont ceux qui servent aux cérémonies politiques et religieuses. Ces dernières qui intéressent particulièrement : elles se révèlent nombreuses et souvent précoces dans leur parution – plus nombreuses et précoces qu’on ne l’a dit souvent. Quant aux auteurs, ils sont de toutes les nationalités impliquées dans la conquête coloniale, avec une majorité de Britanniques et de Français.
Le Monde illustré est fondé en 1857, Le Tour du Monde en 1860, La Nature en 1873, le Journal des Voyages en 1877, L’Anthropologie en 1890. Dans leurs premières années, Le Monde illustré et le Journal des Voyages n’hésitent ni devant le romanesque ni devant les erreurs les plus grossières : aussi y a-t-il peu à en attendre, hors des images de sacrifices humains et de pyramides de crânes. Le Tour du Monde et La Nature, sans être exempts de ces travers, y tombent plus rarement et s’efforcent d’apporter des éléments plus exacts, en dépit des jugements que les auteurs sont incapables de retenir. Si l’on se fonde sur leurs plus anciennes livraisons, il apparaît que des mentions d’artefacts non occidentaux s’y trouvent dès le second Empire. En 1865, dans le récit de voyage en Nouvelle-Zélande de Ferdinand de Hochstetter paraît le relevé d’un portail maori orné. La même année la revue s’intéresse au Gabon, à travers le voyage du médecin Griffon du Bellay, qui l’a visité de 1861 à 1864. L’année suivante, c’est Livingstone ; puis, en 1868, le « Voyage dans le Soudan occidental » d’Eugène Mage qui sort en volume la même année chez Hachette. Dans la décennie suivante, Le Tour du Monde consacre de nombreux textes à l’Afrique : Stanley à la recherche de Livingstone en 1873, le botaniste et ethnologue allemand George Schweinfurth « au cœur de l’Afrique » en 1874 ou les « croisières à la côte d’Afrique » de Fleuriot de Langle en 1876. Dans le récit de Stanley sont insérés des dessins d’armes et d’une « idole » et dans celui de Schweinfurth des armes, des instruments de musique, ainsi qu’un portrait de « Mounza, roi des Mombouttous », assis sur un trône orné, parmi des éléments de mobilier sculptés. Plus surprenante, une image figure un tombeau fait d’un cortège de figures humaines taillées dans le bois. Et plus surprenant encore, le commentaire qu’en fait Schweinfurth :
J’avais d’abord pris ces figures pour autant d’idoles, mais c’était une erreur. L’objet de ces images est simplement de rappeler un être qui n’est plus […]. Dans tous les cas, les Bongos trouvent à ces effigies un mérite incomparable et se persuadent qu’elles reproduisent trait pour trait les gens qu’elles représentent. Pour compléter l’illusion, ils les parent souvent de colliers et d’anneaux et leur mettent de véritables cheveux. L’impression qu’elles causent est alors des plus vives53.
À ces nouvelles d’Afrique répondent, du côté du Pacifique et des Amériques, celles du voyage « à la Nouvelle-Calédonie » de Jules Garnier, publié en 1868, et les « Excursions parmi les tribus indiennes des bassins de la Columbia et du Haut Missouri » en 1869 d’après George Catlin ainsi que, la même année, « Voyages et aventures dans la Colombie anglaise, l’île Vancouver et l’Alaska » de Frederick Whymper, qui les a traversés entre 1864 et 1867. À cette occasion sont publiés – sans doute pour la première fois dans la presse française – les images d’un masque « des indigènes de l’île Vancouver » et de trois danseurs masqués et déguisés en oiseaux qui participeraient à une « danse de la médecine ». Le Tour du Monde fait découvrir ce qu’est un tiki des îles Marquises, soigneusement dessiné pour illustrer en pleine page les « Souvenirs du Pacifique » d’A. Pailhès, enseigne de vaisseau, qui y navigue entre 1872 et 1874 et présente le relevé d’« inscriptions inexpliquées de l’île de Pâques ». Quelques années plus tard, Pâques à nouveau, vue par Alphonse Pinart qui s’efforce de comprendre l’exécution des têtes de pierre monumentales : « Les sculpteurs choisissaient toujours pour tailler leurs statues une roche placée sur un plan assez incliné ; ils la façonnaient dans cette roche même sur place et ce n’est qu’après l’avoir terminée qu’ils s’occupaient de l’en détacher54. » Plusieurs gravures de ces têtes, debout ou renversées, appuient ses descriptions. Son intérêt s’étend aux « écritures » dont il publie à son tour un relevé, « remarquables hiéroglyphes ». « Ces bois parlants comme on les appelle dans l’île, sont indéchiffrables pour les habitants actuels. » Les statuettes ne lui échappent pas non plus. Il en dessine, l’une masculine, très reconnaissable au traitement de la cage thoracique et du visage profondément creusé, l’autre probablement féminine. Il note encore que les insulaires « y tiennent beaucoup ; ce qui prouve l’intérêt qu’ils leur attachent, c’est qu’on ne peut qu’avec peine les échanger, même contre du tabac55 ».
À partir de 1873, un autre gisement d’observations se trouve dans les livraisons hebdomadaires de La Nature. Elles y sont d’abord rares, la revue consacrant l’essentiel de ses pages aux développements de la physique, de la chimie, de la biologie ou de la géologie et à leurs applications techniques. Botanique et zoologie y sont aussi très présentes, alors que l’archéologie et l’ethnologie n’y trouvent leur place que lentement. Par le spectaculaire macabre d’abord : le 15 décembre 1873, une étude s’inspire des travaux d’Hamy, qui n’est pas encore le créateur du musée du Trocadéro, mais l’auteur d’études sur les Indiens d’Amérique latine, dont les Jivaros. Leur technique de réduction des têtes, et celles des Mundurucus et Cajas, est détaillée et illustrée d’une gravure « grandeur naturelle », en pleine page. Le rédacteur anonyme s’en tient à citer Hamy qui, lui-même, s’en tient à la neutralité du savant, à une unique notation près : « Une tête semblable à celles que nous allons décrire s’est vendue à Paris comme une curiosité au prix énorme de 1 500 francs, il y a une huitaine d’années56. » À partir de la décennie suivante, les publications sont plus nombreuses. Après Le Tour du Monde, La Nature s’intéresse en janvier 1881 à l’île de Pâques : texte de Charles Vélain, carte de l’île et deux gravures des têtes, celle qui se trouve alors au Musée d’histoire naturelle de Paris et un groupe in situ avec des autochtones pour indiquer l’échelle des sculptures. Quelques mois plus tard, il s’agit des Aborigènes d’Australie, « un peuple qui s’éteint ». La dénonciation est virulente : « brutalisés par les premiers Européens qui fréquentèrent leurs côtes, violemment dépossédés par les convicts », les Aborigènes subissent « les vices et les maladies importés par les blancs57 ». Leurs mœurs sont « celles de tous les peuples sauvages et barbares », mais « ce qui est bien plus curieux, c’est la disposition vraiment géniale de ces peuples pour le dessin58 ». À preuve la reproduction, d’après l’ouvrage de Brough Smyth, à l’origine de l’article, d’un dessin où sont figurés des chasseurs, des pêcheurs, des animaux et un couple de colons, la femme portant une robe à crinoline « qu’on pourrait presque prendre pour une caricature ». Un « peuple barbare » est ainsi susceptible de dessiner et de peindre, sur écorce et sur pierre. L’auteur n’en conclut rien, s’arrêtant à ce qui lui semble un paradoxe.
Autre continent, l’Amérique du Nord des Indiens. Les Delaware sont dépeints d’après les publications de Charles Abbott et de la Smithsonian Institution. Le titre est éloquent : « Le sens artistique chez les Indiens de l’Amérique du Nord ». Là encore, la présence européenne est décrite comme nocive : les plus beaux objets seraient antérieurs aux premiers colons européens, qui ne les mentionnent pas parce qu’ils « étaient tenus cachés comme de précieuses reliques59 ». Cet intérêt se vérifie en 1894, dans l’« Excursion dans la province de l’Alaska » d’Albert Tissandier, qui s’y est rendu l’année précédente. Il n’a pas fallu attendre l’entre-deux-guerres pour connaître totems et masques des Tlingits : une planche figure leurs « amulettes et charmes », une autre leurs « poteaux en bois sculpté (Totems) ». « Ces petits masques sont en bois sculpté et sont rehaussés de peintures rouges et noires60. » Ce ne sont pas même des raretés : ceux qui sont publiés ont été dessinés lors de l’Exposition universelle de Chicago en 1893. Un autre et une « amulette en os sculpté […] m’ont été vendus au glacier de Muir par les Indiens », précise l’auteur, indices de la commercialisation précoce de ces artefacts.
Il serait aisé de poursuivre l’inventaire des articles et images jusqu’à la Première Guerre mondiale, ce qui ne changerait rien à la déduction qui s’impose d’elle-même : descriptions et images des primitifs et des artefacts caractéristiques de leurs modes de vie sont aisément accessibles grâce à ces publications, qui ne sont pas savantes même si les auteurs qui y interviennent sont pour certains des savants et non des journalistes. D’autre part, ces textes et reproductions circulent entre les principaux pays européens, ce qui s’explique aisément puisque les revues publient souvent en traduction des extraits de livres parus dans d’autres pays, en France les voyages de Stanley, en Grande-Bretagne ceux de Savorgnan de Brazza par exemple. Ce que suggèrent l’histoire des collectes et des collections et celle de la formation des sciences ethnographiques et anthropologiques se trouve donc confirmé et renforcé par celle des journaux : les primitifs sont au premier plan de la curiosité en Europe à la fin du XIXe siècle.
Grossièreté, obscénité : l’art des primitifs
Les quelques appréciations favorables, « l’impression des plus vives » ressentie par l’un, la « disposition vraiment géniale pour le dessin » reconnue par un autre, ne doivent pas leurrer. Elles sont exception. Si statues et masques sont reproduits dans la presse, les commentaires qui les accompagnent sont presque uniformément péjoratifs. C’est ici une contradiction qui se retrouvera sans cesse : curiosité et condescendance sont inséparables. L’Europe prend connaissance des productions des primitifs. Mais c’est pour les juger déplorables ou scandaleuses. Ceci s’observe dans la presse et, ce qui est plus déconcertant, dans les écrits des anthropologues. Un adjectif revient de façon obsédante : grossier. Un autre le suit de près : indécent. Le mépris raciste, conforté par la situation coloniale et la supériorité militaire des puissances occidentales, est la norme du jugement. Là encore, devant la quantité des occurrences, il est nécessaire de s’en tenir à quelques-unes : dans la presse dans un premier temps, puis dans les livres.
Dans Le Tour du Monde, en 1879, Achille Raffray, qui a été missionné par le ministère de l’Instruction publique en Nouvelle-Guinée en 1876-1877 : « Quel abîme entre l’homme qui vit comme une bête dans cet état de barbarie et l’homme civilisé qui dans toutes les fonctions de la vie animale cherche les raffinements de l’esprit ! N’étaient la parole et une perfectibilité relative, l’homme sauvage se rapprocherait plus de la bête que de l’homme civilisé61. » Ainsi juge-t-il les populations papoues. En dépit de quoi il publie des croquis des maisons, des pirogues et de « divinités et figurines papoues », dont l’une est une figure d’ancêtre korwar et l’autre sans doute un deuxième korwar, mais trop mal dessiné pour que l’on en soit certain. Il décrit ce qu’il nomme « temple ».
Aux deux extrémités le toit, au lieu de s’affaisser, se relève et s’allonge pour se terminer par des ornements de bois […] et une plateforme où se trouvent deux statues d’homme et de femme de grandeur nature ; avec des membres articulés et des chevelures simulées. Les piliers simulent aussi une forme humaine de l’un et l’autre sexe ; quelques-uns représentent aussi des crocodiles. Une description de ces statues et de leurs abominables attitudes est chose impossible : elles ne pourraient inspirer que le dégoût62.
Obstinément raciste, Raffray est cependant moins sûr de ses opinions qu’il ne le semble d’abord : « Les Papous ont réellement un art, bien rudimentaire il est vrai, mais qui se manifeste sur tous les objets à leur usage. » Cet art cultive « un enchevêtrement d’arabesques où la spire semble être l’idée dominante. On retrouve surtout ce dernier genre d’ornementation dans les planches travaillées à jour qui ornent l’avant des pirogues et sur les bambous ciselés qui servent de boîtes à bétel63 ». Les contradictions sont flagrantes entre ses divers propos. Convaincu de l’infériorité, sinon de la bestialité des « sauvages », il n’en observe pas moins leur style d’arabesques et, s’il condamne leurs sculptures, c’est pour des motifs moraux, que ses convictions catholiques expliquent à défaut d’en excuser la pauvreté64. Il voit et décrit, mais est incapable de se défaire de ses préjugés moraux et artistiques : ce en quoi il se trouve représentatif.
Dans Le Tour du Monde encore, l’Afrique devient dans la dernière décennie du XIXe siècle la destination de prédilection. Les récits ont pour auteurs ceux qui s’emploient à l’extension des colonies françaises en Afrique occidentale : Gallieni, Savorgnan de Brazza, le capitaine Binger, le capitaine d’Ollone ou l’administrateur Alexandre d’Albéca. Leurs descriptions portent principalement sur des données géographiques, politiques et militaires, mais il leur arrive de mentionner des faits religieux et culturels, qui font l’objet d’illustrations. Leurs commentaires sont alors sommaires ou insultants. Dans « Comment j’ai traversé l’Afrique de l’océan Atlantique à l’océan Indien » du major portugais Serpa Pinto, en 1881, se trouvent des gravures d’armes et d’objets quotidiens – pipes, « tomahawks », boîtes gravées, tambours – et celle du « Sova Mavanda » des « Quinbamdés », dansant avec un masque : « une citrouille peinte en noir et blanc », « attirail grotesque » pour jouer « le rôle d’une bête féroce65 ». Chez les « Marutsés » d’Afrique australe, l’Autrichien Emil Holub assiste à la danse dite kichi et en décrit le costume, qui est aussi dessiné : « Le masque, modelé en argile et en bouse de vache, est enduit d’ocre rouge et de chaux […]. Il est beaucoup plus grand que la tête, qu’il recouvre entièrement, y compris le cou, et ressemble à un casque muni d’une visière rabattue ; de petits trous y sont percés pour les yeux, la bouche et parfois aussi le nez66. » Pour quel effet, selon l’explorateur autrichien ? « Sa forme tourmentée et grotesque rappelle la grimace d’une NOTES
PRÉFACE
1. Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves, in Voyages, t. I, Les Belles Lettres, 1948, p. 205-206.
2. Ce terme est employé ici parce qu’il est celui de l’époque considérée. L’essentiel de ce livre ayant pour objet de montrer son impropriété, les sous-entendus racistes et colonialistes qu’il renferme et de quels systèmes de références il est le nom, il est repris en raison même de son omniprésence dans les écrits et le vocabulaire du temps et parce que tout substitut du genre « premier » ou, pire encore, « tribal » serait d’une part un anachronisme de vocabulaire, d’autre part un subterfuge de langue tout à fait vain. Deux solutions typographiques se présentaient : soit l’usage systématique des guillemets, soit l’impression systématique en italique. C’est cette solution qui a été retenue. De même a-t-il été décidé, par conformité au vocabulaire du temps, de conserver les transcriptions des noms de peuples et de lieux telles qu’elles apparaissent dans livres et articles plutôt que de les unifier selon les usages actuels, unification qui aurait fait se perdre une part de la tonalité propre à ces ouvrages.
3. James Clifford, Malaise dans la culture. L’ethnographie, la littérature et l’art au XXe siècle, Paris, ENSBA, 1996, p. 197. Le texte original, « Histories of the Tribal and the Modern », parut dans Art in America en avril 1985, quelques mois après la fin de l’exposition conçue par William Rubin au MoMA et présentée avec grand retentissement l’année précédente.
4. Ibid., p. 195.
5. Parmi les exemples récents, on placera au premier rang l’exposition Imaginary Ancestors organisée en 2017 par l’africaniste et galeriste bruxellois Bernard de Grunne et l’anthropologue Carlo Severi pour le compte de la galerie Almine Rech et son catalogue, exemple accompli de la réunion d’autorités de plusieurs types sous le signe hautement revendiqué du primitivisme selon William Rubin.
6. Sans doute faudrait-il écrire plutôt « n’est plus » puisque tel était le propos d’un premier ouvrage sur ces questions, Le Peintre, le poète, le sauvage (Flammarion, 2010). « Loin de tenir [ce livre] pour la somme des analyses que j’ai voulu consacrer à ce sujet, j’y vois une étape dans un travail qui est loin d’être achevé », lisait-on dans l’« Avertissement au lecteur ». Le présent ouvrage s’inscrit dans cette continuité au long cours.
7. Il ne semble pas que James Clifford lui-même ait pris la mesure de cette ignorance, concentrant sa critique sur la part « ethnographique » du sujet comme les auteurs de Primitivism l’ont fait eux-mêmes et comme si c’était là l’unique définition du primitif.
8. Marcel Réja, L’Art chez les fous, Mercure de France, 1908, p. 63.
9. Afin d’éviter là encore toute confusion, on évitera le terme antimoderne, qui a beaucoup trop servi ces derniers temps.
10. « Mr Frank Hamilton Cushing (un peu lessivé, souffrant de l’estomac), conversation animée sur la signification et la finalité de l’ornementation », in Aby Warburg, Le Rituel du serpent. Art & anthropologie, introduction de Joseph L. Koerner, Macula, 2003, p. 136.
11. Ibid.
12. À New York chez C. Scribner’s Sons, 1884, et à Londres chez Sampson Low, Marston, Searle and Rivington. Une planche tirée de son volume est reproduite en couverture de l’édition française du Rituel du serpent sans que Bourke y soit cité.
13. Il y mentionne des déguisements et des gestuelles comiques, un danseur « affublé d’un long surtout imperméable de caoutchouc et d’une paire de bésicles, peintes en blanc sur les yeux » et un autre qui était « une très belle contrefaçon de jeune femme » (John Gregory Bourke, Les Rites scatologiques, trad. Dominique Laporte, PUF, 1981, p. 44) : soit exactement ce que Warburg nomme les « clowns déchaînés » dans sa conférence. Par ailleurs, il peut être intéressant de rappeler que le préfacier de la traduction allemande de l’ouvrage, en 1913, est Sigmund Freud.
14. Qu’il transcrit Oraybe.
15. Dès 1870, John Lubbock consacre aux cultes des serpents une longue énumération de cas (The origin of civilisation and the primitive condition of man, Londres, Longmans, Green and Co., 1870, p. 186-193). De son inventaire et en raison même de la longueur de celui-ci, il conclut que « le culte des serpents étant si largement répandu et présentant tant de traits similaires, il n’est pas surprenant qu’il ait été considéré comme exceptionnel et que des tentatives aient été faites d’en remonter à la source et de le tenir pour la religion primitive de l’homme » (p. 193).
16. Le premier, Georges Didi-Huberman a reconnu des affinités entre Warburg et Tylor. On ne peut qu’être en accord avec lui quand il note que le voyage de Warburg est « vers les survivances » et que « son repère théorique » est Tylor (Georges Didi-Huberman, L’Image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Éditions de Minuit, 2002, p. 52). Et de même quand il observe combien l’importance de Tylor a été méconnue dans la formation de Warburg.
17. « Je n’ai pas observé cette danse moi-même, mais quelques photographies donnent une idée de la cérémonie », écrit-il (Le Rituel du serpent, op. cit., p. 103).
18. Charles Marsillon, « Les Indiens moki et leur “danse du serpent” », La Nature, 21 novembre 1896, p. 390.
19. Ibid.
20. Ibid., p. 391.
21. Ibid., p. 387.
22. Warburg en est conscient. À propos des poteries qu’il acquiert, il note ainsi dans son journal : « Coll. magnifique de Cliffdwellings pottery (tout authentique ?) » (Le Rituel du serpent, op. cit., p. 140). La question est judicieuse car, autant que les fouilles illégales, la fabrication de faux est une activité rémunératrice, à destination des touristes. Il acquiert de nombreux objets auprès de Thomas V. Keam, établi à Walpi, qui vend une collection à destination du Peabody Museum en 1894. Il en achète aussi au révérend H. R. Voth, homme « compliqué et égoïste » (ibid., p. 148). Il signale par ailleurs la présence du clergé chrétien autant que celle de l’armée.
23. Ibid., p. 104. Autre occurrence du thème de l’unité : les cérémonies « prouvent à l’évidence que les serpents ainsi consacrés deviennent, en s’unissant aux Indiens, des faiseurs de pluie » (ibid., p. 105). Il y a même redoublement du thème : l’union de l’Indien et du serpent permet à l’Indien d’intervenir dans l’ordre naturel du monde parce qu’il en fait lui-même partie.
24. L’affirmation est de Benedetta Cestelli Guidi, « La collection pueblo d’Aby Warburg 1895-1896 », Le Rituel du serpent, op. cit., p. 173. Elle note que l’on y « trouve de précieuses poteries provenant soit de fouilles soit de la production contemporaine ».
25. « La cohérence de l’analyse de l’esprit “primitif” par Warburg est confirmée par son intérêt pour les dessins des enfants », note justement Benedetta Cestelli Guidi (ibid., p. 167), qui est l’une des rares à l’avoir étudié sous cet angle. « Warburg appliquait l’expérience à l’étude de la psychologie primitive, en employant les enfants comme s’ils étaient des “Urprimitifs” », poursuit-elle (ibid., p. 168). C’est moins « comme si » que « parce qu’il les regardait comme ».
26. Ibid., p. 171.
27. Ibid., p. 130.
28. Ibid., p. 131-133. Warburg pourrait s’être souvenu de Nietzsche : « Prémisses de l’âge des machines : La presse, la machine, le chemin de fer, le télégraphe sont des prémisses dont personne n’a encore osé tirer la conclusion qui viendra dans mille ans » (Humain, trop humain, livre II, Le Voyageur et son ombre, aphorisme no 278, 1880).
29. Si ce n’est ce contresens d’Ernst Gombrich : « Les danses du serpent de l’homme primitif sont l’équivalent des aboutissements de l’homme civilisé qui maîtrise l’énergie électrique et l’utilise pour ses propres fins » (Aby Warburg. Une biographie intellectuelle, trad. Lucien d’Azay, Klincksieck, 2015, p. 213). Équivalent est le plus inopportun des mots : il trahit une incompréhension totale de la pensée de Warburg. Dans les phrases suivantes, Gombrich, très éloigné de toute intelligence du primitivisme comme il l’a prouvé par ailleurs, attribue « ce diagnostic pessimiste » à « certaines des peurs obsessionnelles de Warburg » et poursuit, en homme « normal » : « Dans une certaine mesure, la conclusion de la conférence de Warburg révèle ainsi les progrès de sa maladie mentale » (ibid., p. 214). On s’interroge sur les raisons qui poussent Gombrich à chercher à disqualifier par l’argument de la folie cette partie de la conférence et à ridiculiser Warburg avec cette question : « Qu’aurait-il dit des transmissions télévisées depuis la Lune ? » (ibid., p. 213). Sans doute faut-il en conclure que Gombrich voit dans la conquête de la Lune l’apothéose de l’esprit humain.
30. D. H. Lawrence, « La danse des serpents », in Le Serpent à plumes et autres œuvres mexicaines, Robert Laffont, 2010, p. 583.
31. Ibid., p. 584-585. La première version du récit est plus violente encore : « Un spectacle rien de plus ! Le Sud-Ouest est le grand terrain de jeu de l’Américain blanc. Le désert n’a pas d’autre utilité. Mais il offre un beau terrain de jeu national. Et l’Indien ; avec ses longs cheveux, ses petites poteries, ses couvertures et ses bibelots grossiers de fabrication artisanale, n’est qu’un merveilleux jouet vivant. Plus rigolo qu’un lapin d’élevage, et tout aussi inoffensif. Merveilleux, non, de les voir sautiller avec un serpent dans la bouche. Très rigolo » (D. H. Lawrence, L’Odyssée d’un rebelle, textes choisis et traduits par Françoise Du Sorbier, La Quinzaine littéraire et Louis Vuitton, 2001, p. 163).
32. Op. cit., p. 589.
33. Ibid., p. 588. Lawrence retrouve ici l’hypothèse formulée par Lubbock en 1870, ce qui n’est pas un indice suffisant pour prétendre dépister une filiation.
34. Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes, trad. Jules Castier, Pocket, 2005, p. 129. Brave New World a paru en 1932.
35. Si sévère que, jugeant la première version trop désagréablement satirique, elle obtint que Lawrence la reprenne et l’édulcore pour en faire celle qui a paru dans Matinées mexicaines.
1. VOIR, NE PAS VOIR
1. Herman Melville, Moby Dick, Gallimard, 2016, p. 54. Le roman a paru en Grande-Bretagne et aux États-Unis en 1851.
2. Ibid., p. 98-99.
3. Paul Du Chaillu, Voyages et aventures dans l’Afrique équatoriale, Paris, Michel Lévy, 1863, p. 51. À son propos : Jean-Marie Hombert et Louis Perrois (dir.), Cœur d’Afrique. Gorilles, cannibales et Pygmées dans le Gabon de Paul Du Chaillu, CNRS Éditions, 2007.
4. Op. cit., p. 331-332.
5. Ibid., p. 267.
6. Ibid., p. 481.
7. Paul Du Chaillu, L’Afrique sauvage. Nouvelles excursions au pays des Ashangos, Paris, Michel Lévy, 1868, p. 200.
8. Ibid., p. 219.
9. Ibid., p. 258-259.
10. Marquis de Compiègne, L’Afrique équatoriale. Okanda, Bangouens, Osyéba, Plon, 1875, p. 8. Victor de Compiègne (1846-1877) parcourt le bassin de l’Ogooué entre 1872 et 1874 en compagnie du naturaliste Alfred Marche (1844-1898) et en tire la matière de deux volumes parus en 1874 et 1875, dans lesquels la vérification des descriptions de Du Chaillu et leur correction tiennent une place importante. Il met sa documentation au service de Savorgnan de Brazza quand celui-ci prépare son expédition. Quant au clown Boswell, il avait coutume de revêtir un costume bicolore, moitié bleu, moitié rouge : de là sans doute la comparaison.
11. Henry Morton Stanley, À travers le continent mystérieux, Librairie Hachette, 1879 ; repris in Alain Ricard, Voyages de découvertes en Afrique, Robert Laffont, 2000, p. 935.
12. Verney Lovett Cameron, À travers l’Afrique. Voyage de Zanzibar à Benguela, Libraire Hachette, 1878 ; in A. Ricard, Voyages de découvertes en Afrique, op. cit., p. 904.
13. Contraint par ses dettes, il vend aux enchères son « Museum Humfredianum » le 5 avril 1779. Celui-ci comptait principalement des objets du deuxième voyage. David Samwell, chirurgien à bord du Resolution lors du troisième périple, fait de même en 1781, et Lever est encore l’un des enchérisseurs de la vente. Sur l’histoire de ce musée : Adrienne L. Kaeppler, Holophusicon. The Leverian Museum. An Eighteenth-Century English Institution of Science, Curiosity, and Art, Altenstadt, ZKF Publishers-Museum für Völkerkunde Wien, 2011. Compte rendu critique par Gilles Bounoure, « Holophusicon. The Leverian Museum. An Eighteenth-Century English Institution of Science, Curiosity, and Art d’Adrienne L. Kaeppler », Journal de la Société des océanistes, 2012, p. 156-158.
14. Sur ce point : Roger Boulay, « Le chevalier Leroy de Barde et les cabinets de curiosités anglais », in Océanie, la découverte du paradis, Paris, Somogy, 1997, p. 33-35. Le fonds Leroy de Barde a plus tard rejoint le musée de Boulogne-sur-Mer alors que les peintures de ses collections sont au Louvre. Après son retour en France, Leroy de Barde a continué à augmenter sa collection, rachetant d’autres pièces Cook à des amateurs britanniques.
15. Cité par Chris Wingfield, « Scarcely more than a Christian trophy case ? The global collections of the London Missionary Society museum », Journal of the history of collections, vol. 29, no 1, 2017, p. 111. Le rôle de la LMS apparaît comme assez équivoque : la présence des « idoles » est supposée attirer vocations et soutiens à son action, mais suscite un engouement qui n’a rien quant à lui de particulièrement chrétien.
16. Ibid., p. 113. L’inventaire en première page du catalogue annonce : « Specimens in Natural History, Various Idols of Heathen Nations, Dresses, Manufactures, Domestic Utensils, Instruments of War &c. &c. &c. »
17. Ibid., p. 117.
18. Un autre enrichissement important s’accomplit avec l’entrée des collections préhistoriques et ethnographiques d’Henry Christy à sa mort en 1865.
19. Né en 1791, neveu du gouverneur britannique de la Gold Coast, il séjourne en France entre 1820 et 1822, où il se lie avec Cuvier, y publie en 1821 An Essay on the Superstitions, Customs, and Arts, Comment to the Ancient Egyptians, Abyssinians, and Ashantees, et meurt en 1824 en Gambie, alors qu’il entreprenait une exploration en direction de la Sierra Leone.
20. Charles H. Read, « Preface », British Museum Handbook to the Ethnographical Collections, 1910, Oxford University Press, p. VI. Charles Hercules Read est alors keeper of the department of british and medieval antiquities and ethnography, cette dernière section n’étant pas jugée digne d’un conservateur spécifique.
21. Ibid., p. V.
22. Sur ces faits la synthèse la plus récente se trouve dans le volume collectif Art de l’archipel Bismarck, sous la direction de Kevin Conru, Milan, 5 Continents Éditions, 2013.
23. Sur l’histoire de ce musée : Das Museum Godeffroy, 1861-1881, Naturkunde und Ethnographie der Südsee, sous la direction d’Helene Kranz, Altonaer Museum, Hambourg, 2005.
24. Cité par Klaus-Jochen Krüger, « Colons, administrateurs, chercheurs et explorateurs : les campagnes de collecte dans l’archipel Bismarck », in Art de l’archipel Bismarck, op. cit., p. 27. L’ethnologue Richard Thurnwald est choisi pour cette mission, qu’il accomplit entre 1906 et 1908 et qui aurait rapporté plus de 3 000 objets.
25. Ibid., p. 29. Dorsey est conservateur au Field Museum de Chicago.
26. Ibid., p. 30.
27. Ibid., p. 31. Une large partie de ces collections a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale.
28. Ibid., p. 34.
29. Sur ce point : Beyond Compare. Art from Africa in the Bode-Museum, Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, 2017.
30. Ernest Théodore Hamy, Les Origines du musée d’ethnographie, Paris, Ernest Leroux Éditeur, 1890, p. 48. L’Astrolabe et La Zélée sont les navires des voyages de Dumont d’Urville dans le Pacifique sud. La Bonite fait le tour du monde en 1836-1837.
31. Ibid., p. 49, n. 2. La section ethnographique, considérée dans sa totalité, compterait alors 2 760 pièces.
32. Adolphe Joanne, Paris illustré. Guide de l’étranger et du Parisien, Hachette, 1876, p. 655-656.
33. Ibid., p. 700.
34. Op. cit., p. 53. La seconde partie de l’ouvrage d’Hamy est une compilation accablante des mésaventures administratives de l’ethnographie en France. Sur l’histoire du musée : Nélia Dias, Le Musée d’ethnographie du Trocadéro (1878-1908). Anthropologie et muséologie en France, Paris, CNRS, 1991.
35. Op. cit., p. 59-61.
36. Ibid.
37. Ibid., p. 61.
38. Ce serait sortir de notre propos que s’interroger plus avant sur les raisons d’une aussi flagrante indifférence opposée à l’ethnographie par l’État français, impérial ou républicain, au XIXe siècle et bien au-delà.
39. Ibid., p. 67.
40. Marcel Detienne (L’Invention de la mythologie, Gallimard, 1981) en présente une analyse à laquelle on ne peut faire mieux que renvoyer.
41. Albert Réville, Les Religions des peuples non-civilisés, Paris, Fischbacher, 1883, t. II, p. 102-103. Le « maré », enclos sacré, est ce que Gauguin nomme « maraé ».
42. Edward Evan Evans-Pritchard, La Religion des primitifs à travers les théories des anthropologues, Payot, 1971, p. 15. On trouvera dans ce livre une bibliographie globale, particulièrement les auteurs allemands et britanniques qui se sont risqués à décrire ces religions avant la Première Guerre mondiale.
43. Émile Durkheim et Marcel Mauss, « De quelques formes primitives de classification. Contribution à l’étude des représentations collectives », L’Année sociologique, VI, 1901-1902, p. 5.
44. Henri Hubert et Marcel Mauss, « Introduction à l’analyse de quelques phénomènes religieux », Revue de l’histoire des religions, 1906 ; repris in Mélanges d’histoire des religions, Paris, Félix Alcan, 1909, p. 20.
45. Marcel Mauss, en collaboration avec H. Hubert, « Esquisse d’une théorie générale de la magie », L’Année sociologique, 1902-1903, p. 8-9.
46. Salomon Reinach, « La théorie du sacrifice », Cultes, mythes et religions, Paris, Ernest Leroux, 1908, t. I, p. 100-101.
47. Mgr Alexandre Le Roy, La Religion des primitifs, Paris, Gabriel Beauchesne et Cie, 1909, p. 42.
48. Edward Burnett Tylor, Primitive Culture : Researches into the development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, Londres, John Murray, 1873 ; trad. fr., La Civilisation primitive, Paris, Alfred Costes, 1920, p. 22. Tylor (1832-1917) fut le premier titulaire de la chaire d’anthropologie de l’université d’Oxford.
49. Ibid., p. 22-23.
50. Ibid., p. 23-24.
51. Ibid., p. 40. La survivance dans les mythes et religions est ce qu’Aby Warburg nomme Nachleben, trois décennies plus tard.
52. Ce que Detienne commente ainsi du point de vue grec : « En découvrant que l’esprit humain “mythologise” dans certaines conditions, qu’une certaine éducation conduit à un certain genre d’idées et que les hordes sauvages parlent encore la langue première du mythe, Tylor est sûr d’avoir trouvé le moyen d’expliquer les récits choquants et embarrassants de la Grèce. En effet, une fois confrontées avec la vraie mythologie des Sauvages, les données absurdes de la fable grecque dépouillent leur étrangeté » (L’Invention de la mythologie, op. cit., p. 35).
53. George Schweinfurth, « Au cœur de l’Afrique. Trois ans de voyages et d’aventures dans les régions inexplorées de l’Afrique centrale », Le Tour du Monde, 1874, 1er semestre, p. 335. Les « figures [sont] d’un travail soigné, quoique primitif ». À l’image de ces cortèges s’ajoutent celles d’un tabouret et de monnaies symboliques, d’une remarquable précision. Les gravures publiées par la revue sont reprises de l’édition britannique.
54. Alphonse Pinart, « Voyage à l’île de Pâques », Le Tour du Monde, 2e semestre, 1878, p. 228. Pinart, plus connu pour ses voyages en Alaska dont on reparlera plus tard, traverse le Pacifique en 1877.
55. Ibid., p. 239. « Ces statuettes sont mâles et femelles ; […] quelques-unes sont ornées de colliers ou d’une énorme chevelure tressée avec soin. » Non moins attentives sont ses observations sur les mœurs, le mode de vie, etc.
56. E. T. Hamy cité in « Les têtes humaines préparées par les Indiens Jivaros », La Nature, 15 décembre 1873, p. 24.
57. Gabriel Marcel, « Un peuple qui s’éteint, les Aborigènes d’Australie », La Nature, 7 mai 1881, p. 359.
58. Ibid., p. 362.
59. Daniel Bellet, « Le sens artistique chez les Indiens de l’Amérique du Nord », La Nature, 24 septembre 1892, p. 262.
60. Albert Tissandier, « Excursion dans la province de l’Alaska, États-Unis », La Nature, 22 décembre 1894, p. 56.
61. Achille Raffray, « Voyage en Nouvelle-Guinée », Le Tour du Monde, 1879, 1er semestre, p. 244. De son voyage en 1876-1877, il a rapporté de nombreuses collections. Achille Raffray (1844-1923) est principalement connu pour ses travaux d’entomologiste et sa carrière diplomatique ultérieure. Sa mission a fait l’objet d’une étude de Philippe Peltier (« Insectes, armes et parures. Les enjeux de la collection d’Achille Raffray, Nouvelle-Guinée, 1877 », Gradhiva, no 23, 2016) qui, si elle apporte des éléments factuels, fait preuve d’une discrétion excessive à propos du racisme de Raffray.
62. Ibid., p. 251. « Tout voyageur peut visiter ces maisons sacrées ; mais quant à savoir à quel culte elles sont destinées et quels en sont les cérémonies et les rites, c’est jusqu’ici une entreprise extrêmement difficile. »
63. Ibid., p. 252.
64. Les « abominables attitudes » qu’il ne saurait nommer sont celles de figures masculines en érection.
65. De Serpa Pinto, « Comment j’ai traversé l’Afrique de l’océan Atlantique à l’océan Indien », Le Tour du Monde, 1881, 1er semestre, p. 261-262.
66. Emil Holub, « Au pays des Marutsés, épisodes des voyages de M. le docteur E. Holub sur le Haut Zambèze », Le Tour du Monde, 1883, 2e semestre, p. 46.
67. Ibid., p. 44.
68. Joseph Gallieni, « Exploration du Haut Niger », Le Tour du Monde, 1883, 1er semestre, p. 181-182.
69. André Coffinières de Nordeck, « Voyage au pays des Bagas et du Rio-Nuñez », Le Tour du Monde, 1886, 1er semestre, p. 284.
70. Ibid., p. 282.
71. Alphonse Bertillon, Les Races sauvages, Paris, Masson, 1882, p. 67. Titre de la figure : « Fétiches nègres ».
72. Savorgnan de Brazza, « Voyages dans l’Ouest africain », Le Tour du Monde, 1887, 2e semestre, p. 331. La gravure a été depuis reproduite, in extenso cette fois, par Louis Perrois, qui ne la commente pas en tant que telle.
Lire la Suite=> Gallimard
