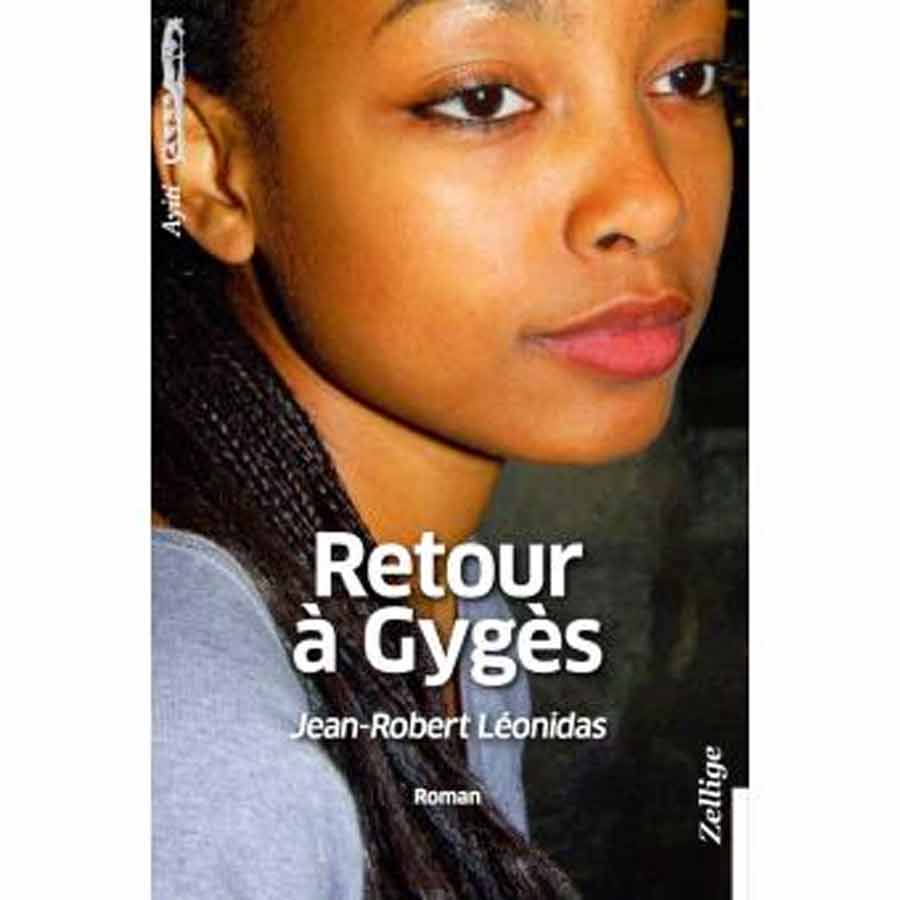— Note de lecture de Dan Burcea —
 Dans un entretien datant de 2013, l’écrivain haïtien Jean-Robert Léonidas nous révélait le fait que ses romans avaient «un double enracinement dans le silence et le chaos»[1]. Quatre années plus tard, il nous propose deux autres éléments tout aussi significatifs, extraits cette fois de la symbolique que porte son nouveau roman «Retour à Gygès», ceux de la mémoire et du déracinement. Rien d’étonnant, dirions-nous, pour un écrivain qui a fait lui-même cette expérience dans son aller-retour entre la beauté pure de Haïti, son île natale, et une autre île, Coney Island, au sud de Brooklyn, dans le quartier new-yorkais d’East Flatsbush où il fait d’ailleurs habiter Anita, son héroïne.
Dans un entretien datant de 2013, l’écrivain haïtien Jean-Robert Léonidas nous révélait le fait que ses romans avaient «un double enracinement dans le silence et le chaos»[1]. Quatre années plus tard, il nous propose deux autres éléments tout aussi significatifs, extraits cette fois de la symbolique que porte son nouveau roman «Retour à Gygès», ceux de la mémoire et du déracinement. Rien d’étonnant, dirions-nous, pour un écrivain qui a fait lui-même cette expérience dans son aller-retour entre la beauté pure de Haïti, son île natale, et une autre île, Coney Island, au sud de Brooklyn, dans le quartier new-yorkais d’East Flatsbush où il fait d’ailleurs habiter Anita, son héroïne.
Ce sont donc ces deux têtes de pont que l’auteur tente de garder reliés durant le temps de sa narration. Il prend d’abord ses aises dans les paysages enchanteurs de la Plaine des Gommiers où Anita grandit dans cette terre natale située «face à la mer […] ouverte à l’infini des rêves et des vagues». Le pittoresque de ce pays haut en couleurs et riche en saveurs ne tient pas seulement dans son unicité et son abondance naturelle, mais se construit aussi autour des habitants de ce «théâtre de la vie villageoise plein de secrets, de sous-entendus, de surprises, d’émotions» qui extraient «jusqu’à la dernière goutte tout le jus du mot». L’enjeu majeur semble une fois de plus être plutôt d’ordre symbolique, structuré autour de deux hommes qui sont les vrais piliers de cette société aux convictions et humeurs fluctuantes. Il y a d’abord, le Père Absalon, officiant à l’église de l’Immaculée Conception, breton d’origine, «un des derniers prêtres blancs du pays, une espèce en voie de disparition», un homme «casanier, philosophe sur les bords». Le deuxième est Tonton Gesner, «bel homme pareil à un superbe échantillon d’Afrique occidentale», trônant en gourou et maître guérisseur sur le Temple de Gygès. Magicien, «censé détenir un certain pouvoir», comme, par exemple, celui de l’anneau magique capable, soi-disant, de «rendre les gens invisibles», Gesner s’était rendu dans un voyage initiatique à Izmir, en Turquie, auprès d’une improbable Société de Gygès dont personne ne pouvait attester l’existence. Les habitants de ce village assis confortablement dans le creux de la Plaine des Gommiers et coupé par la Route Nationale n° 7 partagent avec passion les querelles de ces deux épiphanies, l’une chrétienne gardée précieusement par le père blanc et l’autre alimentée par la magie improbable aux sons de la musique haletante du temple de Gygès. Les dimanches sont des manèges de fêtes foraines peuplées d’enfants pour qui les balais se métamorphosent en chevaux bondissant en rond et qui emportent aux sons des onomatopées «tiguidip, tiguidip, tiguidip», le souvenir du «galop inoubliable des chevaux de l’enfance».
Cette enfance est justement aussi celle d’Anita, fille d’Estimé et d’Esther Balouine, couple qui fait partie à son tour des figures des notables du village. Estimé, l’instituteur du village, est un homme respectable et respecté par les deux clans qu’il fréquente en toute impunité, au gré des circonstances, qu’il s’agisse du père Absalon ou de Gesner, le magicien à la voix de stentor. Esther, en revanche, est une «femme peu instruite (qui) ressemblait à une source fraîche de dessous les rochers». Cette blanchisseuse qui exerce à sa façon le métier «d’agent d’hygiène et de lumière» a des «mains sombres paraissant délavées, décolorées à force de frottements, de torsion, de pression de va-et-vient continu au contact du linge». Son monde intérieur dévoile une personnalité encore plus complexe qui sait «rester dans la simplicité élémentaire des choses, (et qui) se limitait à la tradition catholique et ne visait pas en cachette le temple mystique».
C’est de ce monde qu’Anita va être coupée à l’âge de quatre ans par son départ précipité vers les États-Unis avec sa maman, après la mort de son père. Le narrateur fait un saut en avant sur une longue période de sa vie new-yorkaise et nous présente l’infirmière qu’elle est devenue, à la fois belle et fragile, traversée par de nombreux doutes et d’incessants questionnements. Si elle doit affronter autant d’interrogations sans réponses, c’est qu’une rupture semble faire son chemin inéluctable dans son esprit partagé entre son présent et un passé dont elle cherche à scruter sans grand succès les recoins les plus obscurs, malgré les conseil du psychologue Ellen Vanvallen. Plusieurs choses semblent plaider pour dire que ce regard hésitant qu’Anita pose sur sa vie fait d’elle un être perdu dans le territoire miné d’une existence suspendue à un mi-chemin fatal qui a façonné sa vie. N’ayant pas réussi les examens de médecine, elle a dû se contenter avec un poste d’infirmière. Ne voulant pas s’attacher à un homme, elle cherche toujours l’homme de sa vie. Se sentant déraciné dans un monde de béton et perdue dans les couloirs de l’hôpital où elle travaille, elle rêve toujours du pays où les arbres parlent et où les fraises promettent de «dévoiler des secrets mais de façon confuse, inintelligible». Même son nom, devenu maintenant Baldwin, garde sa mémoire première et son orthographe haïtien de Balouine. Inévitablement, son regard se fige vers un retour hypothétique, et pourtant maintes fois promis, dans le pays de sa première enfance, vers la plaine enchanteresse de son île natale. Réussira-t-elle à entreprendre ce voyage capable de donner sens à un retour dans ce qui est pour elle une terre promise ? Elle n’est pas la seule à le vouloir, à le rêver même, le docteur Jefferson, son ami, lui aussi originaire de Haïti, est prêt à tenter l’aventure.
Accrochés à cet improbable mais prometteur futur, les personnages de Jean-Robert Léonidas entretiennent un rapport très secret avec la mémoire qu’ils souhaitent ancrer dans une permanence salvatrice, celle de la possibilité de ce territoire salutaire devant l’errance et le déracinement qui s’impose à eux. Le défi, il faut le dire, est de taille. L’aventure que tentent Anita et Jeff n’est autre chose qu’un retour à une vérité qui risque de bruler leurs ailes par la force d’un autre questionnement qui resurgit soudainement, celui de l’impossibilité de bâtir leurs histoires personnelles en les privant de la place fondatrice qu’occupent les secrets de famille bien gardés dont regorge leur enfance et la réalité dont elle se construit. Le chemin héroïque parcouru par leurs parents qui ont même laissé leur vie réclame cette fois un retour clarificateur sur tant d’énigmes qui réclament à être élucidées.
Le suspense reste entier, tout aussi comme la beauté et la poésie de ce récit que Jean-Robert Léonidas a choisi une fois de plus afin de nous faire connaître un monde qui lui est si familier où l’insularité, le soleil et la splendeur des tropiques se conjuguent avec une fidélité sans faille qui installe les êtres dans une part familière où l’éternité devient leur matrice naturelle. C’est ici que la vie se déleste de la dualité assassine de l’exil et retrouve son sens et sa saveur. Y prendre racine est sans doute le sens ultime de ce retour à Gygès, dans la fabuleuse Plaine des Gommiers où les souvenirs et les êtres chers du passé continuent à parler et dévoiler leurs multiples secrets à l’oreille attentive de cet écrivain amoureux de la lumière de son pays qui s’insinue à travers ses écrits et arrivent jusqu’à nous pour nous enchanter, cette fois en compagnie de la belle Anita, notre guide.
Le voyage prend ici des allures d’aventure, de périple initiatique, de vrai odyssée moderne qui met l’homme contemporain devant la réalité tragique et implacable du déracinement. «Que signifie cette vie qu’elle mène?», se demande sans cesse Anita. La réponse est à portée de main dans les pages de ce livre passionnant et solaire.
Dan Burcea
Jean-Robert Léonidas, Retour à Gygès, Éditions Zellige, 2017, 240 p., 21 euros.
[1]http://lettrescapitales.com/interview-jean-robert-leonidas-bonne-litterature-ne-nait-generalement-beau-milieu-de-perfection-plutot-consubstantielle-traumatisme-a-douleur/