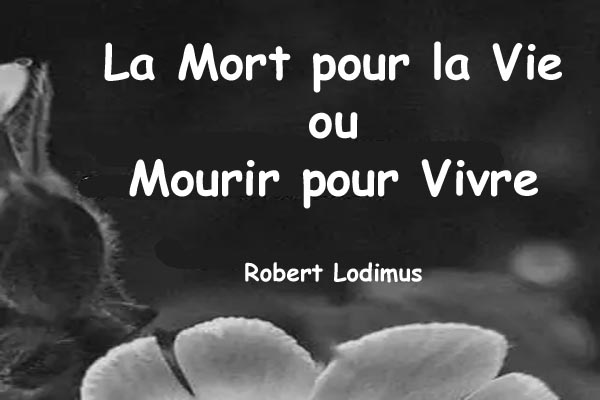 Chapitre quatorze, deuxième partie
Chapitre quatorze, deuxième partie
Chapitre XIV
Le houngan Oracius, d’une certaine façon, faisait partie des victimes de la violente « campagne antisuperstitieuse » de 1939 à 1942 que le clergé catholique, appuyé par le gouvernement d’Élie Lescot, déclencha contre la pratique du vaudou. Des péristyles furent pillés, saccagés et incendiés. Déjà, en 1896 et en 1913, des Lettres pastorales dénonçaient le culte des dieux africains comme une courroie de propagation, d’uniformisation, d’universalisation de la superstition et de la magie noire. D’éminents intellectuels, parmi lesquels Jacques Roumain, s’insurgèrent contre ces mesures scandaleuses qu’ils avaient qualifiées d’entrave à l’émancipation de la culture nationale. Le père Raphaël Moreau, aux côtés de Monseigneur Robert, était à la tête de ce mouvement de destruction des temples vaudou des paysans et parlait de la nécessité « d’évangéliser la culture ». Cependant à la grande surprise des prêtres colonialistes, ces persécutions brutales ne firent que raviver, fortifier les croyances des masses populaires dans le vaudouisme. Les serviteurs des « lwa », dispersés dans les mornes, les plaines et les vallées, n’abdiquèrent point leurs droits légitimes et inaliénables devant les exigences dictatoriales imposées par la Cité du Vatican. Ils avaient regimbé de façon péremptoire.
Le houngan Oracius fit sa lippe, comme s’il allait, à la manière d’un chevalier défié, agressé, déshonoré, mettre flamberge au vent. Sa langue cascadait des propos tranchants qui sabraient l’air effaré, épouvanté…
– Commandant, après avoir écouté notre Révérend, je me suis dit qu’il a bien parlé, tellement bien parlé que je devrais me taire, me taire et ne rien y ajouter, car la sagesse qui est en lui a fait entendre la voix de la raison. Puis, j’ai réfléchi, et j’ai décidé de me vider le cœur, pour une fois que j’ai l’occasion de le faire. Messieurs, il n’y a pas encore de mots pour exprimer les mauvais moments que nous avons traversés avant et après la disparition de notre village sous les eaux du déluge. Pourquoi toutes ces tribulations? Nous étions un peuple de pêcheurs, et c’est la mer qui nous nourrissait. Nous fabriquions des pirogues et des voiliers, et nous allions sur l’océan pour ranger nos nasses et déployer nos filets. Des produits de la pêche, nous en mangions une partie et vendions la portion restante pour acheter de l’huile, du sel, du savon, du riz, du maïs, du petit mil, du hareng saur, des haricots… Bref, l’argent tiré de la transaction, aussi peu qu’il fut, servait à nous procurer ce dont nous avions eu besoin pour cuisiner nos repas et lessiver nos hardes. Et puis, de manière subite, il n’y avait pas de poissons en quantité suffisante. Notre survie était sérieusement menacée. Toutes ces difficultés sont survenues avant même l’arrivée du cyclone. Là encore, il faut se demander pourquoi ? Et ce n’est pas difficile à comprendre. Nous avions finalement remarqué la présence de ces gros bateaux de pêche avec des étrangers à leur bord, peut-être des Américains, des Canadiens, des Japonais, nous ne savions pas au juste, qui ratissaient le fond de l’océan, raflaient tout ce qu’ils y trouvaient : poissons, crabes, anguilles, homards, crevettes… pour remplir les cales de leurs bâtiments. Nous, les petits pêcheurs, nous étions nettement désavantagés par rapport à ces escrocs qui disposaient de tous les moyens pour pêcher en eaux profondes. Après leurs passages, il nous était impossible d’attraper même un têtard. Aujourd’hui, nous ne vivons presque plus de la mer. Nos embarcations de pêche ont été endommagées ou détruites par les mauvais temps. Ceux qui le font encore doivent marcher longtemps pour atteindre la côte. Les habitants de La Roche ont essayé de se reconvertir dans d’autres activités de production pour ne pas disparaître sur la terre. Personne ne pense à nous aider. Nous n’avons plus d’école dans le village depuis que notre frère Silas (Richard) est retourné vivre chez les siens. Le pasteur ne peut plus apprendre à lire et à écrire aux marmots à cause de sa mauvaise santé. Notre camarade Espérandieu qui assurait la relève est plongé dans l’obscurité. D’autres sont rappelés par le Bon Dieu… Malgré tous les problèmes qui nous persécutent, toutes les tracasseries que nous supportons, vous êtes venus nous chasser d’ici, détruire nos cases pour installer des étrangers à La Roche. Aucun de nous qui sommes debout en face de vous n’acceptera de plein gré de partir, de subir cette honte. Aucun de nous qui vous regardons en face ne consentira à s’en aller pour laisser la place aux « fils des anciens colons » que nos pères ont combattus pour se libérer de l’esclavage, je parle de ces braves gens qui nous ont légué cette patrie libre, souveraine et indépendante. Je rejoins notre bon pasteur, lorsqu’il vous a dit que nous sommes disposés à devenir des martyrs pour éviter que notre village ne tombe entre les mains de nos anciens « maîtres ».
Le groupe de paysans frustrés, devenus enragés, incontrôlables, avaient commencé à hurler des obscénités aux visages des gendarmes et des « Blancs manants ». Les flammes de la sédition montaient de tous les côtés. Les Rochois, vraisemblablement, n’étaient pas des animaux qui se laissaient conduire à l’abattoir sans se braquer, sans se cabrer. Les jappements furibonds des chiens venaient se mêler au tintamarre de l’animadversion. Les gosses déchiraient leur gorge, tellement les affres de frissons débordaient dans les nuages du firmament chargés de malheurs. L’atmosphère était comparable à la fournaise ardente dans laquelle le roi Nebucadnetsar fit jeter les trois Hébreux, Shadrac, Méshac et Abed-Nego, parce qu’ils refusèrent de se prosterner devant la divinité de Babylone. L’existence, à La Roche, était pareille à la rivière détournée qui cherchait patiemment son lit. Et dans bien des cas, n’avait-elle pas réussi à trouver son chemin ? Gandhi comprenait lui-même que « la vie était un mystère qu’il fallait vivre, et non un problème à résoudre. » Alors, les Rochois avançaient preusement dans le désert des calamités que la Providence avait délinéé pour eux, et qu’il leur fallait affronter à chaque instant de leur bref séjour sur la terre. « À cœur vaillant rien d’impossible », arborait Jacques Cœur, armateur et riche marchand du Moyen Âge, décédé mystérieusement en 1456 à Chio, en Grèce.
Le chef militaire intima l’ordre à l’officier subalterne, Stephen Maître, de faire reconduire les six Américains et les trois curés de l’autre côté du ravin. Il voulait visiblement les protéger, les mettre à l’abri avant de déchaîner les orages. Les deux adjoints d’Orilas Fortilus, Louidor Désir et Josaphat Valméus, furent désignés pour accompagner les « Yankees » et les religieux catholiques à l’endroit indiqué. Sitôt que les concernés avaient tourné le dos pour disparaître au tournant où les deux petites collines se tenaient par la main, le commandant Nestor Gracia asséna au prédicateur un violent coup de pied au bas du ventre. Soulevé dans les airs pendant quelques secondes, le corps du nonagénaire avait parcouru une bonne petite distance avant d’aller se fracasser contre le sol rigide. Le houngan Oracius, sans se soucier de l’adynamie liée à son âge, bondit sur Nestor. L’époque de sa juvénilité était marquée par des exploits de turbulences héroïques. De l’adolescence à l’âge adulte, il fut le moutard intrépide, le coq de gaguère, le pitchounet hardi qui ne se laissait jamais faire, qui se portait à la défense des fluets, qui se battait même contre des forcenés qui faisaient deux fois son âge. Oracius n’avait pas mis longtemps à réaliser qu’il n’était plus le lièvre, le champion de la vélocité, mais plutôt la tortue écrasée sous la lourde carapace du temps. Dans cette version de la fable, le vilain guépard avait remplacé le lièvre et la pauvre tortue s’était métamorphosée en moustique des marais. Le chef de section Orilas Fortilus lança violemment son bâton de gaïac. Le sang gicla… Le houngan s’écroula sur le sol ferme comme un vieil âne crevé. Marie Siliane surgit dans la foule, se précipita, d’abord, en direction du Révérend, puis courut vers Oracius, mais, dans les deux cas, il n’y avait plus rien à faire. Les deux vieillards ne bougeaient plus. Elle retroussa sa robe, marcha d’un pas décidé en direction de Nestor et d’Orilas. Cependant, avant même qu’elle les eût atteints, le sable étincelant de Nestor lui trancha la carotide. La foule hurla de révolte. Les militaires ouvrirent le feu. La panique se généralisa. Les fils de « Satan » ricanèrent, festoyèrent au milieu des pétarades assourdissantes. Le sang vif forma des affluents et glissa comme des « couleuvres madeleine » sur la terre dure et sèche. Des corps d’êtres humains de tous les âges, d’animaux domestiques et de ferme gisaient sans vie. Les militaires sadiques achevèrent les victimes qui respiraient encore. La voix du commandant Nestor Gracia résonna comme celle d’Astaroth enchaîné dans les cavernes de l’enfer. La Roche entra dans la légende.
– Sergent, ordonnez aux soldats d’enlever les cadavres et de les disposer de sorte qu’il y en ait une quantité dans chaque case… Ensuite, mettez-y le feu…! Le ciel nous récompensera d’avoir débarrassé la nature d’un lot de parasites. Exécutez…!
– À vos ordres mon commandant!
Puis se tournant vers les sacripants en uniforme ostensiblement nerveux :
– Messieurs, faites ce que le commandant Nestor vous ordonne…!
La Roche brûlait, crachait des flammes comme le Vésuve. Elle était entrée dans l’histoire comme Herculanum, Stabies, Taurania… Les cahutes en bâches, en paille, en panneaux de terre turf se consumaient comme du bois sec dans le foyer d’une cheminée géante. Le chef des pyromanes assassins en kaki vert olive, suivi de la horde des malfrats, quitta tranquillement le théâtre des scènes d’horreur, en pensant, peut-être, à son prochain carnage. Derrière les seize salopards, le village de La Roche avait rendu son dernier soupir dans les braises incandescentes d’où s’exhalait une odeur suffocante de chair humaine boucanée et de sang brulé… Le chef de section et ses deux adjoints, qui avaient eu le temps de revenir sur les lieux pour participer à ce massacre au même titre que les autres, marchaient au devant du cortège criminogène. Le groupe avançait à pas de précipitation pour atteindre la place où il fallait franchir le ravin sec et graveleux. Ils avaient hâte de rejoindre le curé, les vicaires et les « enfants de l’Oncle Sam » qui s’étaient déjà installés à bord de l’un des cinq véhicules tout terrain en attente. Les Jeeps Willys étaient toutes garées de l’autre côté, au tout début du tronçon qui conduisait à l’entrée de la métropole. Au moment de traverser, le commandant Nestor Gracia glissa quelques mots à l’oreille de son adjoint, Stephen Maître, qui en fit autant avec le sergent Timothée. Le sous-officier prit six hommes avec lui et, arborant un sourire narquois, demanda au chef de section et à ses deux adjoints de les suivre dans la forêt, sous prétexte que le commandant lui avait chargé de leur confier une tâche importante, vraiment décisive. Orilas Fortilus obéit sans chercher à en savoir davantage. Une fois arrivés dans la petite clairière, les militaires servirent aux trois paltoquets une décharge de fusils dans le ventre et dans la poitrine. Le peloton d’exécution se retira rapidement du site de l’arquebusade. Les bouchers ne prirent pas le temps d’inhumer les butors. Ils abandonnèrent les cadavres des malotrus troués, « passoirisés » et ensanglantés à la voracité des chiens et des cochons sauvages, pour rejoindre avec empressement le ramassis des brigands. L’officier Stephen Maître les congratula.
– Bon boulot Messieurs…!
Puis il s’en alla se rapporter lui-même à son supérieur hiérarchique. Le major Nestor sourit et lui adressa des propos élogieux à son tour.
– Vous avez tous fait du bon travail aujourd’hui. Votre pays va largement en bénéficier. Le colonel avait dit : « Pas de témoin…! » Il y a des événements qu’il faut occulter de l’histoire, qui doivent échapper aux stylos et aux micros des journalistes fanatiques, aux racontars des historiens illuminés. Et l’événement qui s’est déroulé aujourd’hui en est un. Selon ce que j’ai entendu dire, ce misérable village était construit sur un périmètre qui recèle un précieux gisement d’or, peut-être l’un des plus importants qui soient découverts jusqu’à présent en Amérique. Le gouvernement a le projet de transplanter les habitants de toute cette section communale sur des territoires arides, localisées dans le nord-ouest. C’est toute la région qui va être déclarée d’utilité publique.
– Ce qui veut dire que l’on reviendra l’un de ces jours pour forcer les autres à s’en aller. Le traitement que nous avons privilégié à La Roche risque bien de se répéter dans ces villages. Les populations ne désarmeront pas. Tout semble indiquer qu’ils vont tenter de résister comme leurs compatriotes l’ont fait. Ils ne voudront pas partir comme ça. D’ailleurs, ils peuvent même bénéficier de la solidarité et de l’appui de tous les campagnards et montagnards du pays. Cette situation ne risque-t-elle pas d’embarrasser le gouvernement et de le plonger dans une crise politique? Je le dis comme cela, parce que moi, je suis un soldat; et en tant que soldat, je n’ai pas à discuter les ordres de mes supérieurs.
– Lieutenant Stephen, l’armée n’a pas d’état d’âme. Nous représentons la force au service du pouvoir. Le pouvoir n’a pas de visage. Il change trop souvent de visage pour en garder un en particulier. Les soldats obéissent et ne discutent pas. Les civils ont toujours tort. Je parle des misérables, de ces vauriens, de ces mendigots totalement démunis, qui ne possèdent absolument rien, qui enlaidissent le paysage de la société par leur présence indésirable. Les Forces armées ont été crées contre les miséreux, pas pour eux… Notre rôle est de garantir l’ordre, la sécurité des biens, la paix sociale. En un mot, c’est d’empêcher les parias, les trimardeurs de venir troubler le sommeil des gens de bien, ceux-là qui investissent leur fortune pour faire fonctionner le pays.
Les deux officiers les plus hauts gradés continuèrent de marcher côte à côte, en tête du peloton des salopards. Le lieutenant Stephen poussa sa curiosité encore loin. Il était anxieux de savoir davantage sur cette affaire qui semblait cacher son visage derrière un « masque de fer », comme celui que portait Philippe, le frère jumeau de Louis XIV, dans l’ouvrage mémorable d’Alexandre Dumas, le célèbre écrivain haïtiano-français à la renommée mondiale.
– Major Nestor, pour que le « Pentagone » envoie des hauts gradés de l’armée des États-Unis dans ce trou maudit, il faut vraiment que ce soit dans le cadre d’une mission de grande importance. Je ne connaissais pas l’existence de cet endroit auparavant.
– Mon cher Stephen, la communauté internationale connaît ce pays mieux que nous. Ils détiennent des cartes de trésors considérables qui sont enfouis dans le sol. Ils savent exactement quoi chercher et où le chercher. Il paraît que ces idiots montagnards, ces ânes bâtés, dorment sur des mines de richesses évaluées à des milliards et à des milliards de dollars américains, sans qu’ils le sachent. Le colonel Tézan a même parlé de la présence de quelque chose comme l’uranium, le plutonium… Je ne sais pas au juste ce que cela signifie, mais il paraît que ce sont des affaires sensibles pour les États-Unis, la France, le Canada, la Russie, l’Angleterre… On s’en est déjà servi pour la fabrication de la bombe atomique… Les puissances étrangères sont très friandes de ces grandes découvertes. En tout cas, c’est ce qu’il a déclaré, le colonel, lorsqu’il m’a parlé dans son bureau de la caserne.
Le groupe se trouvait maintenant presque à la portée du cortège de véhicules où se tenaient quelques soldats chargés de monter la garde… Le commandant Nestor s’empressa d’ajouter :
– Pour Orilas, il ne faut pas vraiment avoir des regrets…! Il était un paysan comme les autres. On ne voulait pas prendre le risque de le laisser en vie. Ces individus-là, quand ils boivent du clairin ou du rhum, ils ont la langue déliée…
– Chef, refroidis comme ils sont, en comptant les deux imbéciles qui l’accompagnaient, on est tout à fait sûrs qu’ils ne parleront pas…
– Bon, Il faut à présent annoncer la bonne nouvelle aux Américains. Le champ commence à être libre. D’ici deux à trois semaines, plus personne ne s’opposera à leur projet d’exploitation… Nous avons accompli une mission embarrassante qui vaudra peut-être au colonel une décoration du président de la République. Cependant, major, je vous avoue que je ne suis pas tellement fier de moi.
Le capitaine arrêta sa marche accélérée à la hauteur des passagers occidentaux. Au poste de conduite du véhicule stationnaire se trouvait le caporal Hérisson qui n’avait pas pris part aux opérations de tuerie avec les pilotes des autres engins. Ils avaient demeuré eux-mêmes sur place pour monter la garde. Les « visages pâles » maintenaient leur position assise dans la Jeep Willis, sans faire un mouvement. L’officier supérieur fit la courbette, puis chuchota quelques mots dans un anglais prononcé de manière baroque, avec un accent vernaculaire, à l’oreille de celui qui semblait diriger le groupe des missionnaires.
– Chief, mission accomplished. The region is entirely up to you. Now, no one can stand in your path … (Chef, mission accomplie. La région est entièrement à vous. Personne ne pourra vous barrer la route…)
– Good job…! Your country you will be very grateful! (Bon travail! Votre pays vous en sera très reconnaissant !)
Les militaires du Nord sourirent d’un air moqueur et malicieux. Avec le temps, les grandes puissances avaient fini peut-être par comprendre la leçon qu’il leur eût fallu tirer des sentiments de remords exprimés par Napoléon Bonaparte, après avoir perdu le grenier le plus florissant de la France dans les Antilles : « J’aurais dû me contenter de gouverner Saint-Domingue par Toussaint Louverture. » Elles eurent donc la malignité de se servir du préfixe grec « néo » raccordé au substantif « libéralisme » emprunté à la philosophie thomiste … pour inventer un concept encore plus terrible que les trois autres qui le précédèrent : féodalisme, capitalisme, impérialisme. La dernière invention machiavélienne donne lieu à un mélange explosif de cruauté, un cocktail de malveillance, un banquet de scélératesse préparé astucieusement par les « néocolons » et distribué par des mains autochtones « compatrioticides ».
Le capitaine prit place à bord de la deuxième automobile. Le sous-officier s’installa à côté de lui sur la banquette arrière et le cortège s’ébranla en direction de la ville. Dans son imagination, il voyait déjà la flotte des navires de prospection minière qui allait envahir dans quelques semaines les baies avoisinantes comme des sarcophiles affamés de cadavres, le débarquement de toute une meute de détraqués, communément appelés « experts scientifiques», qui eussent été choisis pour conduire les travaux de creusage, d’installation des matériels logistiques, et en dernier lieu la horde des travailleurs indigènes et allogènes hébétés, aliénés, comme des hourets galeux, trop contents même de vendre leur force de travail pour une maigre becquetance. En peu de temps, ils auraient bouleversé, désacralisé le paysage. Pollué l’environnement. Contaminé le sol. Souillé les rivières et les nappes phréatiques. Corrompu la jeunesse. Défloré et engrossé les écolières. Fait proliférer la prostitution. Pillé les profondeurs des terres cendreuses de La Roche, de Savane Chaude, de Rivière Moustique…, pour permettre aux descendants de « madame Lalaurie [29] » de continuer à déployer les gonfalons de l’hégémonie sur le sol de l’Amérique Latine, de l’Asie, de l’Afrique…
Les Rochois, à l’instar des peuples courageux, avaient refusé de tendre les bras et la tête aux Lépide, aux Marc Antoine et aux Octave de la contemporanéité – comme le fit Cicéron le 7 décembre 43 avant J.-C, à Formia – sans protester et sans se battre avec les moyens dont ils disposaient ; ils ne s’étaient pas jetés face contre terre devant Apophis, le dieu du chaos dans le monde, et ses alliés. La Roche n’avait point capitulé ; elle n’avait pas abdiqué sa fierté et son honneur… Au contraire, elle était restée stoïque devant les forces excessives de la tyrannie, de la férocité, de la monstruosité et du sadisme. Ils avaient appris, comme Roger Garaudy, à mourir. Ce matin-là, « la mort était au rendez-vous », mais le « dessalinisme » aussi. Car La Roche violée, écartelée, crucifiée, atomisée, anéantie, en dépit de tout, avait su apporter avec elle, au séjour des mânes, l’espérance d’un temps meilleur, où les voiles de la tristesse, de la faim et du froid ne viendront plus hanter la quotidienneté des « traine-misère » du Nord et du Sud. Sinon, n’eussent-ils pas été vains les sacrifices de toutes ces vies fauchées sur les champs de bataille pour que, enfin, le soleil des grands « bouleversements libérateurs », l’astre métaphorique de Diogène de Sinope, déployât les faisceaux de ses rayons radieux sur les cloaques d’où essaimèrent des milliards de bourgades dépérissantes, semblables à Makoko, le bidonville flottant de Lagos au Nigeria.
Robert Lodimus
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre, roman
(Quinzième extrait : chapitre XV, Le choc)
