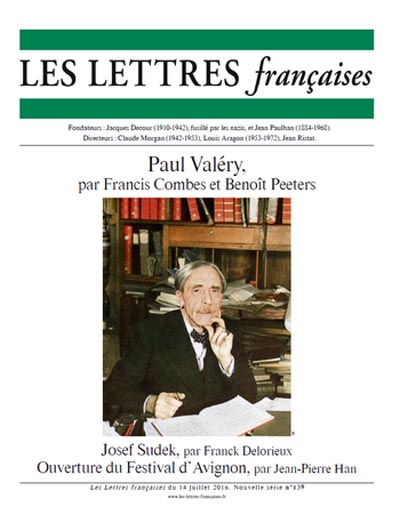— Par Jean-Pierre Han —
 Le spectacle d’ouverture du 70e Festival d’Avignon, tant attendu, laisse un goût amer, pour ne pas dire plus. Les Damnés, d’après le scénario de Luchino Visconti.
Le spectacle d’ouverture du 70e Festival d’Avignon, tant attendu, laisse un goût amer, pour ne pas dire plus. Les Damnés, d’après le scénario de Luchino Visconti.
Mise en scène d’Ivo Van Hove. Cour d’Honneur du palais des Papes. Jusqu’au 16 juillet à 22 heures.
Je ne sais si, pour reprendre le titre du livre de Marie-José Mondzain, grande spécialiste de la question, l’image peut tuer ou non (L’image peut-elle tuer ?), ce qui est sûr c’est que dans le spectacle que vient de donner Ivo Van Hove dans la cour d’Honneur du palais des Papes, à partir du film de Visconti, les Damnés, elle mériterait d’être longuement analysée et réfléchie.
Ce qui n’est malheureusement pas le cas ; elle anéantit du coup tout plaisir – toute intelligence, a-t-on envie d’ajouter – théâtral, ou en tout cas elle le déplace de très étrange manière. Car enfin la saga imaginée et filmée de manière somptueuse et impitoyable par Luchino Visconti naguère (en 1969) qui narre la descente aux enfers d’une grande famille d’industriels allemande qui gère ses aciéries avec succès et suscite la convoitise des nazis, à partir de 1933, année de l’incendie du reichstag et de l’annonce par Himmler de la création du camp de Dachau tout juste après, cette saga nous est restituée par Ivo Van Hove dans un déploiement d’images qui ne nous autorise aucune respiration ni aucune réflexion. Ne parlons même pas des images filmées par deux cadreurs qui accompagnent pas à pas les comédiens, tournent de temps à autre leurs caméras vers le public, histoire de bien lui faire comprendre qu’il est le complice silencieux de ce qui se trame, ne parlons pas de ces images projetées sur l’écran placé en plein milieu du fond de scène, ne parlons pas non plus du travail vidéo signé tal Yarden, un des quatre maîtres d’oeuvre du spectacle avec Jan Versweyveld (à la scénographie et à la lumière), Éric sleichim (à la musique et au concept (!) sonore), et bien sûr Ivo Van Hove (à la mise en scène). Mais parlons de celles fabriquées sur le plateau : c’est peut-être d’ailleurs elles qui posent le plus problème. elles sont léchées dans la violence qu’elles tentent de déployer dans une scénographie pas franchement originale, mais qui en jette comme on dit, avec des éléments très mode et que l’on a déjà vus mille et une fois ici ou là : rampe de tables de maquillage où les comédiens se préparent et attendent leur tour de venir au centre de l’action, chaises où ils vont s’asseoir lorsqu’ils deviennent spectateurs et attendent toujours avant d’entrer en scène, costumes sur cintre car on s’habille et se déshabille à vue, etc., rien de bien original si ce n’est l’alignement de cercueils dans lesquels viendront s’allonger les personnages éliminés du jeu, car on aura compris que l’histoire racontée est celle d’une série de petites et de grandes manoeuvres, de complots et d’assassinats perpétrés en bonne et due forme au
sein de la famille essenbeck saisie dans les rets du nazisme, mais ce dernier dispositif scénographique ressortit plus d’une simple idée de mise en scène répétée à satiété comme quelques autres mouvements de scène. Une scène vidée de toute émotion : comment d’ailleurs pourrait-il être question d’émotion (et de réflexion, j’insiste) dès lors qu’un accompagnement sonore tonitruant par moments (est-ce le grondement de la monstruosité politique qui s’annonce ?), qui parodie la musique de films à d’autres, nous cloue sur nos sièges ? On est bien loin des pensées concernant les relations entre les images et le son émises par Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville dans leur film Ici et Ailleurs… surgit alors ce paradoxe terrifiant : cette histoire qui se veut exemplaire dans son accomplissement de l’époque et aussi dans sa relation avec ce qui est en train de se passer aujourd’hui dans notre monde ne nous intéresse pas… reste, puisque c’était le grand retour de la Comédie-Française au Festival d’Avignon après vingt-trois ans d’absence, le travail accompli par la troupe. De Didier sandre, le patriarche de la maison essenbeck, au tout jeune Martin von essenbeck, Christophe Montenez, en passant par Éric Génovèse, Denis Podalydès, Guillaume Gallienne, elsa Lepoivre, Edeline d’Hermy et leurs camarades, ils sont tous parfaits. On aurait simplement aimé les voir dans d’autres dispositions dramaturgiques.
Jean-Pierre Han dans les Lettres Françaises
Télécharger les Lettres Française de juillet 2016