— par Janine Bailly —
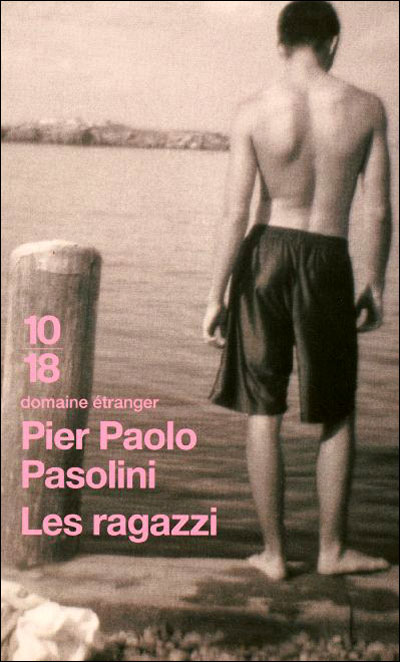 Écrit et publié en 1955, le roman, taxé d’obscénité et de pornographie pour avoir évoqué l’homosexualité et la prostitution masculines, rencontrera un vrai succès public. Le procès dressé à Milan se conclura d’ailleurs par un acquittement, en dépit de la férocité des critiques exercées contre le livre. Un livre qui fut adapté pour le cinéma, en 1959, sous le titre de La Notte Brava (Les Garçons), et réalisé par Mauro Bolognini. Un livre qui, s’il a plus de soixante-ans d’âge, conserve quelque part une brûlante contemporanéité.
Écrit et publié en 1955, le roman, taxé d’obscénité et de pornographie pour avoir évoqué l’homosexualité et la prostitution masculines, rencontrera un vrai succès public. Le procès dressé à Milan se conclura d’ailleurs par un acquittement, en dépit de la férocité des critiques exercées contre le livre. Un livre qui fut adapté pour le cinéma, en 1959, sous le titre de La Notte Brava (Les Garçons), et réalisé par Mauro Bolognini. Un livre qui, s’il a plus de soixante-ans d’âge, conserve quelque part une brûlante contemporanéité.
Avec Pasolini, nous entrons dans la Rome de l’après-guerre. Rome, son grouillement fébrile, ses quartiers déshérités où survit un sous-prolétariat urbain, où les Ragazzi, groupes d’adolescents et d’enfants dépenaillés, se débrouillent et vivent à la va-comme-je-te-pousse. La Rome des faubourgs, ses enfilades d’immeubles délabrés, son fleuve aux eaux grasses et lourdes de déchets, dans lesquelles vaille que vaille on se rafraîchit, joue, se défie et se baigne. Rome, ses bordels et ses prostituées sans grâce, aux chairs flasques qui attisent pourtant les fantasmes jamais assouvis de garçons à peine pubères ; ses pères sans emploi, imbibés de mauvais vins et qui cognent ; ses mères tôt flétries peinant à élever et nourrir une progéniture galopante, et qui vite leur échappera. Rome où l’on vit d’expédients, qui ont nom vol et prostitution de rue, jeune et masculine. Où l’on assassine, pour quelques milliers de lires, un chauffeur de taxi qui n’en peut mais ! Et dans la cité, soudain un immeuble qui s’effondre, la mort, sous les décombres, au creux des chemins, aux carrefours embouteillés, au sein de cette eau qui, d’accueillante, un jour s’est faite assassine…
Et puis la vie quand même, dans le regard d’un enfant si pur encore, et qui trouve refuge dans la fourrure d’un chiot. La vie, qui s’obstine, hors ou dans la geôle, geôle-prison des hommes qui enferment, autant que geôle-maison vétuste, juste bonne à mettre un toit sur la tête, et que l’on s’empressera de fuir. L’autre Rome aussi, un instant entrevue , fenêtre ouverte sur la longue voiture de luxe qui passe comme en un rêve, emportant au loin ces filles, inaccessibles d’être trop lisses, trop blondes, métaphore d’une autre société à jamais étrangère.
Mais dans les faubourgs, la vie c’est la quête, sans cesse renouvelée, pour un morceau de pain, une goutte d’eau, un mégot de cigarette à tromper la faim, pour un peu de cette fraternité qui ne se verrait pas trahie. C’est l’amitié d’un chien fidèle, si doux à caresser, que peut-être un jour d’autres obligeront à un duel fatal contre de plus hargneux molosses. Dans les faubourgs, c’est encore le mendiant sous le pont, l’hirondelle que l’on sauve de la noyade sur la rivière, l’obole qui vous est faite, la main tendue et la cigarette partagée ; l’ennui aussi à tromper au long des jours, quand d’école il n’y a plus même l’ombre, et que défier le sort est votre seule tâche quotidienne. Les rires encore, les aventures partagées, les songes ou mensonges, un voile de solidarité parfois, jeté sur la misère, pour tromper la cruauté du monde !
Tels sont les Ragazzi, en italien Ragazzi di vita, « Garçons de vie », bandes de gamins scélérats qui hantent des lieux oubliés, délaissés, à l’écart de la marche ordinaire du monde, honte de ce pays malade et dégradé au sortir des années de guerre et de fascisme. Pasolini a produit là un texte lucide, cruel et bouleversant, mêlant la langue parlée dans des dialogues adolescents pleins de rage, de fureur, de jurons et de tendresse inemployée, mêlant dis-je cette langue verte à la sienne propre, langue du narrateur, épurée en contraste. Langue si belle à décrire, au-dessus de la laideur et de la crasse, les métamorphoses des saisons et du ciel, de la lumière et des soleils. Langue si juste à peindre le labyrinthe horizontal et vertical des barres d’immeubles, qui alignent inexorablement leurs fenêtres closes, comme des yeux morts trouant la décrépitude des façades.
Déjà, dans ce premier roman, Pasolini affirmait, par le regard porté sur les plus démunis, son engagement à gauche, sa volonté de contester une société prompte à « s’embourgeoiser » tout en laissant sur le bord de la route les petits, les humbles, ceux qui n’ont plus rien quand les autres ont tout. Engagement déclaré et assumé, Pasolini ayant dit vouloir, dans son œuvre, « suivre la structure d’un arc narratif qui épouse le contenu moral du roman » : Riccetto, celui-là même qui, au début de l’histoire, s’était jeté à l’eau pour sauver l’hirondelle, des années plus tard, sortant de prison et rentré dans le rang « selon les canons bourgeois », laissera se noyer dans le courant de l’Aniene le jeune Genosio, avant de prendre furtivement la fuite, prouvant ainsi que « devenu “responsable”, il a perdu les élans de pure humanité qui le rendaient vivant » sous sa carapace de petit voyou.
En ces temps troublés, où d’aucuns lancent et multiplient, vers les banlieues de France, de mirobolantes promesses d’avenir, il me fut bon de relire ce récit, davantage témoignage que roman, espérant que belles paroles ne seront pas demain que mots envolés au vent capricieux des urnes !
Janine Bailly, Fort-de-France, le 11 avril 2017
