—Par Robert Berrouët-Oriol(*) —
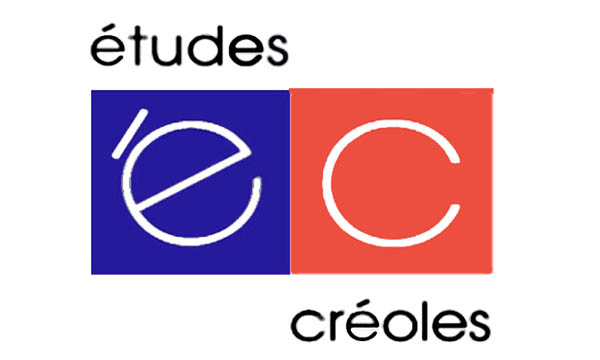 Le linguiste américain John McWhorter a publié, dans The New York Times du 13 novembre 2025, un article qui a eu un écho considérable dans les milieux académiques haïtiens, « One Horror of Slavery That Until Recently Could Not Be Told » [Une horreur de l’esclavage qui, jusqu’à récemment, ne pouvait être racontée]. Nous reproduisons ci-après la version française de cet article établie par Sandra Cadet, traductrice professionnelle.
Le linguiste américain John McWhorter a publié, dans The New York Times du 13 novembre 2025, un article qui a eu un écho considérable dans les milieux académiques haïtiens, « One Horror of Slavery That Until Recently Could Not Be Told » [Une horreur de l’esclavage qui, jusqu’à récemment, ne pouvait être racontée]. Nous reproduisons ci-après la version française de cet article établie par Sandra Cadet, traductrice professionnelle.
Auteur de plus d’une vingtaine d’ouvrages spécialisés, John McWhorter est professeur agrégé de linguistique à l’Université Columbia. Sa thèse de doctorat portait sur le saramaccan, le créole parlé au Suriname par environ 58 000 personnes d’origine ouest-africaine. Il est l’auteur, entre autres, de « Towards a New Model of Creole Genesis » (1997), « The Missing Spanish Creoles : Recovering the Birth of Plantation Contact Languages » (2000), « Defining Creole » (2005), « A Grammar of Saramaccan Creole » (2012, co-écrit avec Jeff Good), « The Creole Debate » (2018).
Depuis nombre d’années, l’origine des créoles est sujet à des controverses, à des débats nourris de théories différentes et de prises de position parfois virulentes. Ainsi, certains auteurs défendent la théorie monogénétique, qui soutient que les créoles ont une origine commune. D’autres défendent la théorie polygénétique, qui suggère que les créoles se sont développés de manière indépendante dans divers contextes sociohistoriques. L’approche substratique met en avant l’influence des langues africaines sur la grammaire et le vocabulaire des créoles, tandis que l’approche superstratique insiste sur le rôle dominant des langues européennes, notamment le français, dans la formation des créoles.
Plusieurs linguistes de premier plan, connus et reconnus pour la haute rigueur de leurs travaux scientifiques, ont abordé la complexe question de l’origine des créoles.
PREMIER EXEMPLE — Albert Valdman (Creole Institute, Indiana University). Auteur d’articles de référence sur le créole haïtien parus dans des revues spécialisées et de plusieurs rigoureux dictionnaires anglais-créole, ce linguiste-lexicographe a publié entre autres « Haitian Creole – Structure, Variation, Status, Origin » (Equinox Publishing Ltd, 2015). Le chapitre 13 de cet ouvrage s’intitule « The Genesis and Development of Haitian Creole » et il comprend les sous-chapitres suivants : « Theories about Creole Genesis », « The Genesis of French-Based Creoles », « The Role of Substrate Transfers in the Genesis and Development of Haitian Creole ».
DEUXIÈME EXEMPLE — Georges Daniel Véronique (Université d’Aix-Marseille) a consacré plusieurs articles au créole et il a notamment publié « Créole, créoles français et théories de la créolisation » (revue L’information grammaticale numéro 85, 2000). Dans cet article l’auteur étudie « Les conditions sociales d’émergence des langues créoles : l’exemple des « créoles français », « Les procès linguistiques de la pidginisation et de la créolisation : grammaticalisation, réanalyse et évolution », « Qu’est-ce qu’un créole ? », Quelques théories de la créolisation ». Auteur de nombreux articles scientifiques sur le créole, le linguiste Georges Daniel Véronique est également co-rédacteur du livre collectif de référence « La didactisation du créole au cœur de l’aménagement linguistique en Haïti » (par Robert Berrouët-Oriol et alii, Éditions Zémès et Éditions du Cidihca, 2021). Dans cet ouvrage il présente une étude au long cours –« Créolisation et créoles »–, qui fournit un ample et systématique éclairage analytique sur l’origine des créoles et les créoles à base lexicale française dans leur inscription socio-historique, les conditions de leur apparition dans le système colonial, leur mode de développement, etc.
Au creux de cette étude, Georges Daniel Véronique nous enseigne –à la section « Le développement des langues créoles–, que « La formation des langues créoles est déterminée par la création des colonies, des forts et des comptoirs et par les navigations inter-îles dans le Pacifique, et par les contacts sociaux qui s’y nouent. Ce sont les seules langues dont on connaisse le point de départ, le terminus a quo. Différents auteurs ont identifié les situations sociales prototypiques de leur naissance. Chaudenson (1992) évoque des créoles exogènes, qui se développent dans des territoires vierges de tout parler (les îles du Cap-Vert, Maurice et la Réunion, etc.), et des créoles endogènes apparus dans un environnement dominé par d’autres langues (le kriyol de Guinée Bissau par exemple). L’on doit donc postuler plusieurs matrices sociales d’émergence des langues créoles. J’examinerai ici celles qui ont donné naissance aux créoles de plantation, aux créoles des comptoirs fortifiés (l’exemple guinéen) et des missions (le cas du Tayo). » [Le souligné en italiques et gras est de RBO]
À la section « La matrice des créoles exogènes » l’auteur précise que « Chaudenson (1979) et Kihm (2005) se sont penchés sur cette matrice sociale, souvent insulaire, actualisée dans la Caraïbe et dans l’Océan Indien, qui donne naissance aux créoles de plantation. »
Georges-Daniel Véronique est l’auteur de l’article « Créolisation et créoles . Sociolinguistique du contact » édité par Jacky Simonin et Sylvie Wharton (ENS Éditions, 2013). Il nous enseigne que « Ce chapitre est consacré aux processus de développement des langues créoles et à quelques-unes de leurs particularités. Les langues dont il sera question ici sont apparentées, au moins sur le plan lexical, à l’anglais, au portugais, à l’espagnol, au néerlandais ou au français, qui sont souvent désignés comme leurs langues lexificatrices (lexifier language), formule contestée par certains auteurs (Mufwene, 2005, par exemple). Ces langues sont également nommées créoles anglais (le créole de la Jamaïque ou de Saint-Vincent, par exemple), créoles espagnols (le papiamento / papiamentu d’Aruba, Bonnaire et Curaçao et le chabacano des Philippines, par exemple), créoles portugais (le kriyol de Guinée-Bissau, le créole du Cap-Vert, les créoles du golfe de Guinée par exemple), créoles hollandais (le berbice dutch et le skepi dutch de Guyana) ou créoles français, suivant l’origine dominante de leur lexique. L’ensemble « créoles français » comprend des créoles atlantiques et india-océaniques et un créole pacifique, tandis que les créoles anglais se retrouvent dans la Caraïbe, en Afrique et dans le Pacifique. On évoque aussi l’existence de créoles à base lexicale arabe (par exemple, le juba arabic ou le kinubi du Soudan) ou de langues africaines (le fanakalo d’Afrique du Sud, le kituba du Congo etc.). Dans le cadre de ce texte, je restreindrai la désignation « créole » aux seules langues apparues lors de l’expansion coloniale européenne des siècles passés, celles à qui le terme fut initialement appliqué. Ces langues partagent d’éventuelles affinités linguistiques qu’il conviendra d’évoquer. Les circonstances de leur émergence sont sans doute proches, à certains égards, de celles observées dans d’autres situations de contacts de langues, d’où certaines similitudes structurelles avec les langues qui en sont issues (kinubi, kituba, sango, etc. ; voir Kihm, 2011).
Les langues créoles sont donc apparues, essentiellement à partir du XVIIe siècle, dans le sillage de l’expansion européenne. Cependant, il convient de relever l’existence d’un texte en lingua de Preto (langue des noirs), aussi appelé falar Guiné (parler Guinée), publié en 1516 au Portugal, soixante ans après la découverte des îles du Cap-Vert en 1456. D’autres textes ultérieurs attestent également l’existence d’un créole portugais (proto-kriolu) à cette période. On a postulé que ce premier créole (lui-même peut-être dérivé de la lingua franca méditerranéenne) était à l’origine des langues créoles qui se sont développées par la suite dans les comptoirs européens en Afrique. C’est la théorie de la monogenèse des créoles : ils seraient tous nés d’une source portugaise par un processus de modification lexicale, de relexification et de dissémination. Cette hypothèse est aujourd’hui abandonnée (Migge, 2003). » [Le souligné en italiques et gras est de RBO]
TROISIÈME EXEMPLE — La linguiste Marie-Christine Hazaël-Massieux (Université de Provence) est responsable du Groupe européen de recherches en langues créoles. L’essentiel de ses publications (nombreux articles et ouvrages) portent sur les créoles français. Elle a publié, entre autres, l’étude intitulée « Théories de la genèse ou histoire des créoles : l’exemple du développement des créoles de la Caraïbe » (revue Éla. Études de linguistique appliquée, 2006/3 no 143). L’« Avant-propos – Au sujet de la définition des langues créoles », est suivi de l’article « Et si l’on parlait des créoles dans les territoires créolophones ? ». L’auteure nous enseigne qu’« Il existe diverses théories concernant la genèse des créoles. Un numéro récent de la revue Études créoles proposait un bilan de ces hypothèses concernant la créolisation et mettait à jour des tendances différentes : certaines qu’on qualifie de » sociohistoriques « , d’autres qui sont axées davantage sur la » typologie « … Ces théories sont toutes des hypothèses, fondées sur des scénarios plus ou moins vraisemblables : ainsi certains linguistes qui les défendent se fondent sur l’étude des populations de bateaux négriers, d’autres insistent sur l’importance de la colonisation portugaise, certains soulignent que le temps passé dans les ports avant l’embarquement permettait aux esclaves de commencer à forger un medium commun, certains encore sont sensibles au fait que l’Afrique, qui a laissé des traces si importantes dans le » type » physique des populations, a bien dû aussi modeler la langue résultant des contacts, etc. Les théories varient, certes, mais si les faits historiques sont sûrs, le passage de données statistiques, historiques, géographiques, politiques ou économiques aux faits linguistiques se révèle très souvent délicat (et donc aventuré). Effectivement, la présence de nombreux esclaves originaires d’un pays à un moment donné de la colonisation n’implique pas :
— qu’ils parlaient tous la même langue ;
— que la parlant, ils l’utilisaient pour leurs échanges ;
— que l’utilisation de cette langue par une population d’esclaves ait eu des conséquences directes sur le créole : celui-ci pouvait être déjà en partie constitué quand ils sont arrivés aux îles ; les relations de travail pouvaient impliquer le recours préférentiel à une autre langue, etc.
Conclure que des données historiques ont des conséquences automatiques sur la langue de communication et qu’elles expliquent les structures linguistiques est audacieux, et c’est pour cela que nous parlons d’hypothèses : les situations de multilinguismes n’ont pas fini de révéler leurs mystères, et la question de la domination d’une langue sur une autre ou plusieurs autres implique de nombreux facteurs, et il faut bien se garder de suggérer des solutions simples.
C’est pourquoi, il nous semble indispensable de proposer aussi des analyses linguistiques fondées sur les textes rédigés en créole au cours de la courte histoire des mondes créoles. Cela ne signifie pas que l’on méprise les hypothèses élaborées par certains avec beaucoup de talent, mais correspond au désir de pousser le plus loin possible l’étude des évolutions linguistiques qui peuvent, à terme, permettre de vérifier ou falsifier telle ou telle hypothèse. »
QUATRIÈME EXEMPLE — Docteur en linguistique, Renauld Govain a présenté le 1er juin 2022 –à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis / UFR Sciences du langage / UMR 7023, SFL/CNRS–, son remarquable « Mémoire de synthèse » en vue de l’obtention de « L’habilitation à diriger des recherches ». Ce mémoire post-doctoral a pour titre « La question linguistique haïtienne : histoire, usages et description ».
Le chapitre 3 de cet exceptionnel « Mémoire de synthèse » s’intitule « Le créole haïtien entre le temps et l’espace ». L’auteur nous enseigne ceci :
« La formation des créoles à base lexicale française remonte aux XVIIe -XVIIIe siècles, au contact du FR [français] et de langues des esclaves provenant d’Afrique de l’Ouest dans le cadre de la colonisation française. Les premiers balbutiements du CH [créole haïtien] remontent à la fin du XVIIIe siècle, à la suite de la signature du traité de Ryswick le 25 septembre 1697 cédant à la France la partie occidentale de l’île d’Haïti baptisée Saint-Domingue par les colons, qui va devenir la République d’Haïti où va se développer le CH [créole haïtien]. Et l’Espagne a gardé la partie orientale occupant les deux tiers de l’île, aujourd’hui la RD [République dominicaine]. Ce traité de Ryswick est signé 12 ans après l’adoption du Code noir connu sous le nom de l’Ordonnance ou Édit de mars 1685 sur les esclaves des îles de l’Amérique signée par le roi Louis XIV en 1685 en vue de réglementer la condition des esclaves noirs de Saint-Domingue. L’importation d’esclaves d’Afrique à Saint-Domingue débute à peu près à cette même période. La colonie française de Saint-Domingue officialise son entrée dans la Traite négrière avec l’ordonnance de 1685, bien que la naissance de la Traite remonte à la fin de la première moitié du XVe siècle, en 1441 avec les Portugais (Botte, 1991) ».
« Le CH [créole haïtien] s’est ainsi développé dans un contexte transactionnel entre le FR [français] et des langues africaines des esclaves arrachés d’Afrique et transportés à Saint-Domingue. C’est dans cette logique que se situe la théorie africaniste de l’émergence du CH [créole haïtien] à savoir qu’il est une langue africaine à vocabulaire français (Sylvain, 1936). Les traces des langues indigènes d’avant les colonisations (espagnole puis française) ne sont guère aussi visibles que celles du FR [français] et des langues africaines en ce que les autochtones ont été assez rapidement décimés pour avoir été contraints de travailler très durement à l’extraction de métaux précieux, expériences dont ils n’avaient pas l’habitude, un acte génocidaire dont l’histoire occidentale classique a très peu parlé. Les langues indigènes avaient été digérées parce que la colonisation française était glottophage (dans le sens de Calvet, 1974), linguicide, voire glottophobe (dans le sens de Blanchet, 2016), d’autant que les colons ne toléraient que le FR [français] comme langue de communication dans la colonie. » [Le souligné en italiques et gras est de RBO]
« Cette hégémonie du FR [français] a traversé le temps et l’espace et perdure. Cette pratique glottophobe est encore actuelle : en France même, seule est valorisée la langue normée (Blanchet, 2016) ; en Haïti, elle a pour conséquence une minoration du CH [créole haïtien] et une majoration du FR [français] et, dans le contexte d’enseignement / apprentissage, une infériorisation d’apprenants ne connaissant pas le FR [français]. Avant l’importation massive d’esclaves, les Français étaient majoritaires. Ces langues indigènes auront laissé peu de traces sur le CH [créole haïtien]. Le FR [français] avait certes seul droit de cité dans la colonie mais, ce n’était pas encore une langue unifiée. Il s’est notamment agi de la variété d’oïl pratiquée dans le nord-ouest de la France du XVIIe siècle et qui comportait des variantes telles que l’intercompréhension n’était guère garantie. Ces variantes vont se trouver au contact de diverses langues africaines à Saint-Domingue, même si on ne peut pas préciser ces langues. Mais les langues du groupe kwa (dont principalement les langues gbés) étaient à un certain moment majoritaires considérant l’origine géographique de la majorité des esclaves au moment de l’émergence de la langue. »
« Les peuples de la Côte d’Or et de la Côte des Esclaves (Ghana, Haute-Volta, Togo, Dahomey, Nigeria occidental) fournissaient, après ceux des côtes du Congo et de l’Angola, le plus grand nombre de captifs aux plantations de Saint-Domingue Les Aradas, dénomination commune des captifs de nations diverses traités sur la Côte d’Or et de la Côte des Esclaves, avaient des croyances religieuses apparentées et une compréhension commune de l’e e, langue de liaison de la région. (Midy, 2006 : 182). Lefebvre (1998), dans sa théorie de la relexification en référence à la genèse du CH [créole haïtien] soutient que celui-ci proviendrait de deux langues sources : le FR [français] et le fongbé pratiqué sur la Côte d’Or, en particulier sur les côtes du Bénin. À partir de 1750, les négriers français s’approvisionnaient à grande échelle au sud du Bénin (Midy, 2006). »
« On peut placer la naissance du CH [créole haïtien] dans le cadre d’une certaine mondialisation où s’étaient rencontrés sur un même espace géographique des locuteurs de langues, origines, cultures, nationalités, pays différents. Cette mondialisation forcée caractérisée par un violent déracinement suivi de la déportation massive d’Afrique dans la Caraïbe de locuteurs d’origines linguistiques diverses a créé une situation de contact de langues qui va redessiner l’identité linguistique de la région. Cette mondialisation est différente de celle d’aujourd’hui qui est une panacée socioéconomique, culturelle et politique traversant les États, les communautés, les cultures, voire les langues et qui est davantage profitable à l’anglais qu’elle promeut à travers les systèmes sociopolitiques, les organisations internationales, la technique ou la recherche. Le globalais (l’anglais-langue-du-monde) est une conséquence de cette mondialisation qui se présente comme un passage obligé en ce qu’elle développe des liens d’interdépendance entre les êtres humains, les activités humaines et les systèmes politiques à l’échelle de la planète » (Godinot, 2008 : 337). » [Le souligné en italiques et gras est de RBO]
Article du linguiste John McWhorter
« One Horror of Slavery That Until Recently Could Not Be Told »
The New York Times, 13 novembre 2025
Traduction française : Sandra Cadet
« Une horreur de l’esclavage qui, jusqu’à récemment, ne pouvait être racontée »
Lorsque le navire négrier connu sous le nom de Zorg quitta ce qui est aujourd’hui la côte ghanéenne en 1781, il se dirigea vers la Jamaïque, avec 442 Africains impitoyablement entassés dans l’espace destiné à environ 250 personnes. En chemin, il dévia de sa trajectoire, et la déshydratation ainsi que le scorbut eurent raison de l’équipage et de la cargaison. Le capitaine, gravement malade, nomma comme remplaçant un vaurien égoïste, un gouverneur colonial récemment congédié. Navigateur incompétent, il navigua au-delà de la Jamaïque.
Après trois mois en mer, lui et les deux autres hommes blancs aux commandes jetèrent environ 125 Africains réduits en esclavage par-dessus bord pour les noyer ou les faire dévorer par des requins.
De retour en Angleterre, le propriétaire du Zorg demanda une indemnisation d’assurance pour la perte. Lors du procès, il affirma que les réserves d’eau étaient si basses que l’envoi des Africains à la mort était la seule façon de garder les autres esclaves et eux-mêmes en vie. Lors d’un second procès, cependant — convoqué en réponse à un éditorial enflammé d’un abolitionniste outré — il s’avéra que le Zorg avait en fait beaucoup d’eau. Pourquoi, alors, les esclaves furent-ils jetés par-dessus bord? Parce que le capitaine avait déterminé que, dans leur état affaibli, ils auraient plus de valeur en tant que réclamation d’assurance que comme marchandise de vente aux enchères. Personne ne fut accusé de ce crime.
Siddharth Kara donne vie à ces événements répugnants, ainsi qu’à leurs répercussions conséquentes, dans le nouveau livre saisissant « The Zorg : A Tale of Greed and Murder That Inspired the Abolition of Slavery ». Parmi ses nombreuses révélations — y compris une description du Passage du Milieu aussi viscérale que le récit de la vie dans les plantations dans « James » de Percival Everett — figure la dure réalité du fait que d’autres Africains aient été vendus comme esclaves par d’autres Africains. Pas seulement quelques-uns d’entre eux. Selon les historiens John Thornton et Linda Heywood, dans leur étude sur la traite des esclaves au début des années 1600, environ 90% des Africains noirs vendus comme esclaves en Amérique du Nord anglaise et néerlandaise durant cette période avaient d’abord été capturés lors de guerres par d’autres Africains noirs. Les captifs étaient vendus à des commerçants blancs contre de l’or et des armes, puis nourris dans la gueule affamée de l’économie des plantations de l’autre côté de l’océan.
« The Zorg », fascinant en soi, arrive à un moment intéressant. L’histoire de l’implication des Noirs dans la traite des esclaves a souvent été considérée comme interdite — au mieux gênante et carrément calomnieuse, au pire. Mais elle a gagné en popularité ces dernières années. J’ai été heureux d’en voir la mention au Musée national d’histoire et de culture afro-américaines (bien que j’aurais souhaité un traitement plus approfondi) et fasciné de voir qu’il s’agit d’un thème important de l‘exposition actuelle des peintures de Kerry James Marshall à la Royal Academy of Art.
Kara décrit comment les esclaves étaient souvent capturés à des centaines de kilomètres à l’intérieur des terres et forcés de marcher jusqu’à la côte, enchaînés, cheville contre cheville, dans un « cercle » pouvant contenir plus de 100 âmes malheureuses. Le voyage pouvait durer six mois ou plus, et jusqu’à un tiers d’entre eux mouraient en chemin, laissés à pourrir sur le bord de la route. Les captifs furent vendus par des marchands haoussa à des commerçants ashantis, qui les revendaient ensuite à des membres de la tribu Fante, qui à leur tour les revendaient aux fonctionnaires blancs qui géraient les châteaux de traite d’esclaves sur la côte. Là, ils furent emprisonnés pendant des mois supplémentaires dans le donjon sombre et fétide du château, attendant d’être achetés par les capitaines de navires négriers. De là, ils passèrent par la « porte du non-retour » et entrèrent dans les cales de navires comme le Zorg.
Certains de ces châteaux de traite d’esclaves existent encore. Ma famille et moi en avons visité un en 1987, sur l’île de Gorée au Sénégal. Nous avons tenu dans nos mains les chaînes qui immobilisaient d’innombrables milliers de personnes innocentes. En regardant l’océan, j’ai essayé d’imaginer ce que ça faisait d’être entassé dans le plus grand navire qu’on ait probablement jamais vu et d’être emmené vers un destin dont on ne savait rien, parce que personne n’était jamais revenu pour raconter l’histoire.
Depuis, j’ai lu tout ce que j’ai pu sur ce que ces châteaux étaient. Le récit de Kara est le plus accessible que j’ai rencontré. Il explique l’anatomie du château de Cape Coast, un écosystème complexe comprenant des administrateurs blancs, des soldats, des artisans, des ouvriers, des comptables et un aumônier, ainsi qu’un grand nombre d’« esclaves du château » qui vivaient dans un village séparé. Ils travaillaient par équipes et par degrés de bondage : certains étaient des habitants qui recevaient un salaire; d’autres étaient des esclaves prêtés par les rois locaux. Quelques-uns parmi eux se sont retrouvés plus tard dans les colonies.
Depuis les châteaux, les captifs furent transportés en canot jusqu’au navire négrier sur des vagues terrifiantes, une autre torture, puis livrés dans la cale négrière. Même les diagrammes que vous avez peut-être vus montrant la coupe transversale d’un navire négrier, avec des corps humains empilés comme du bois de chauffage, ne rendent pas pleinement compte de l’horreur du Passage du Milieu. Les esclaves étaient coincés dans ce qui était essentiellement des étagères, d’un peu plus de deux pieds de hauteur. Quand le navire tanguait, les planches de bois contre lesquelles ils étaient coincés pouvaient arracher de larges morceaux de chair. L’odeur des personnes mourantes ou déjà mortes était presque insupportable. Sur le Zorg, une femme a accouché — et a été jetée par-dessus bord avec son bébé.
Comme l’a écrit le professeur d’études afro-américaines Henry Louis Gates Jr ., et comme je l’ai vécu, les gens sont souvent mal à l’aise d’apprendre que les Africains se sont vendus les uns les autres dans cet enfer vivant. Une objection fréquente est que les Africains n’avaient aucun moyen de savoir dans quelles conditions leurs captifs se retrouveraient. Mais ils ont vu ces captifs être conduits presque à mort, vendus comme des animaux et enfermés dans un château d’esclaves. Les trafiquants d’esclaves africains noirs disposaient de suffisamment d’informations pour comprendre l’immoralité fondamentale de cette entreprise. Si les Blancs avaient vu seulement ce que les Africains ont vu, nous n’hésiterions pas à les juger comme des impardonnables complices du péché. [Le souligné en italiques et gras est de RBO]
Une leçon de « The Zorg » est que l’histoire et les gens sont complexes. La vision, récemment à la mode, de l’histoire américaine (ou occidentale) comme un long règlement de comptes, où le Blanc est toujours l’oppresseur et les personnes de couleur toujours les subalternes, est au fond une tentation enfantine qui nous dispense de nous engager dans les détails et la nuance. Les humains de toutes les couleurs de peau ont souvent été horribles les uns envers les autres. Notre travail est de lutter contre cette tendance, pas de faire semblant qu’elle n’existe pas. Et de célébrer ceux qui le surmontent, quelle que soit leur race. L’abolitionnisme — une réussite occidentale anglophone dont Kara parle dans un dernier chapitre — était un exemple clé de cet effort, et « The Zorg » est un enseignement précieux sur ce qui l’a rendu si important.
D’ailleurs, une des raisons pour lesquelles ces châteaux me fascinent autant, c’est à cause de mon travail de linguiste. Ces sites de tant de cruauté et de mort étaient, selon mes recherches, aussi le berceau de nombreuses langues créoles du Nouveau Monde. Le patois jamaïcain, le gullah de la Caroline du Sud, le « créole » de la Guyane et bien d’autres ont commencé là. Les esclaves qui travaillaient dans le château trouvaient des moyens de communiquer avec les Blancs qui les avaient achetés. Si les esclaves du château ont ensuite été envoyés de l’autre côté de l’Atlantique, la lingua franca est partie avec eux et est devenue la langue commune des personnes réduites en esclavage qui travaillaient dans les plantations. [Le souligné en italiques et gras est de RBO]
Les esclaves ont disparu depuis longtemps, mais les langues qu’ils ont créées sont toujours bien vivantes et indiquent une naissance spécifique sur la côte ghanéenne, dans des châteaux de traite d’esclaves. L’histoire est là dans pratiquement chaque phrase. Les esclaves étaient capturés sur une vaste étendue de la côte nord-ouest de l’Afrique, du Sénégal au Ghana jusqu’à l’Angola, des régions où les langues diffèrent autant que le français, le japonais et l’arabe. Pourtant, toutes les variétés de « patois » des Caraïbes ont des structures grammaticales basées sur les langues parlées dans un seul endroit : les régions du Ghana actuel où se trouvaient les châteaux d’esclaves. Il y a autre chose qui les lie : tous utilisent des variantes de « unu », un pronom à la deuxième personne du pluriel que l’on retrouve uniquement dans la langue igbo du Nigeria, parlée sur cette même côte. (Ici en Amérique, les locuteurs du Gullah disent « hunnuh ».) [Le souligné en italiques et gras est de RBO]
Il n’est pas logique que le même pronom soit cohérent dans une trentaine de patois caribéens différents, créés par des locuteurs d’une bonne douzaine de langues — à moins que « unu » ne soit entré dans leur ADN par l’intermédiaire de l’unique créole ancestral en Afrique et ait ensuite été diffusé dans toute la région.
Un membre de l’équipage du Zorg a écrit dans son journal qu’un esclave a déclaré que lui et les autres préféraient mourir de faim plutôt que d’être jetés par-dessus bord. Il a fait sa demande en anglais, ce que Kara suggère qu’il a habilement appris de ce qu’il pouvait entendre alors qu’il était enchaîné dans la soute. C’est une histoire vivante, mais ce n’est pas ainsi que les humains acquièrent une langue. Selon moi, il semble plus probable que l’homme ait appris un peu d’anglais pendant qu’il était enfermé comme esclave dans un château.
(*)Robert Berrouët-Oriol ,Linguiste-terminologue, Conseiller spécial au Conseil national d’administration, du Regroupement des professeurs d’universités d’Haïti (REPUH), Konseye pèmanan, Asosyasyon pwofesè kreyòl Ayiti (APKA), Membre du Comité international de mise à jour du Dictionnaire des francophones
Montréal, le 6 décembre 2025.
