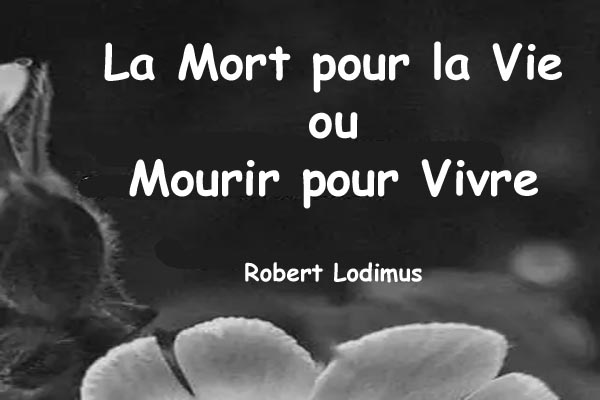 Chapitre XV Le Choc
Chapitre XV Le Choc
« La beauté de la mort, c’est la présence. Présence inexprimable des âmes aimées, souriant à nos yeux en larmes. L’être pleuré est disparu, non parti. Nous n’apercevons plus son doux visage; nous nous sentons sous ses ailes. Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. »
(Victor Hugo, Discours sur la tombe d’Émilie de Putron, 19 janvier 1865)
L’histoire de l’univers n’avait-elle pas toujours foisonné des tragédies phénoménales, des calamités irracontables, des drames indescriptibles, des cataclysmes inimaginables…? Dans l’antiquité, les peuples germaniques, asiatiques et slaves, communément appelés les guerriers barbares ou les barbares sanguinaires qui envahirent au IIIe siècle l’empire Romain, brûlaient des villages, éventraient des populations parfois paisibles et inoffensives. Il ne faudrait pas oublier non plus les Vikings qui – durant trois centenaires environ – tuaient, pillaient, incendiaient et détruisaient tout sur leur passage. Mais la plus terrible catastrophe, de laquelle la mémorabilité humaine avait atteint sa lettre de noblesse, demeurait sans conteste l’effroyable incendie de Rome par l’empereur Caius, plus connu sous le nom de Néron le tyran, dont la cruauté pouvait se mesurer à l’étendue de l’océan. Naturellement – il fallait le préciser – ce fut avant l’embrasement d’Hiroshima – provoqué par la première bombe nucléaire des États-Unis d’Amérique – qui fit instantanément entre 80 000 et 140 000 morts. Environ 250 000 Japonais succombèrent par la suite sous les effets de la chaleur et des radiations causés par la déflagration spectaculaire de l’engin mortifère. Un jour peut-être, comme Shohei Imamura le fit avec son film « Pluie noire » sur Hiroshima et Nagasaki, quelqu’un de ce milieu, nous l’espérons bien, aura fini par immortaliser sur pellicule le drame oublié des Rochois. Car La Roche ne se comptait-elle pas aussi parmi les civilisations – à l’instar de celle des Incas détruite par Francisco Pizarro de l’Espagne – que la cupidité et la méchanceté des hommes avaient sacrifiées sur l’autel de l’absurdité contradictoire? L’odeur du crime odieux du capitaine Nestor et de ses assassins, des années plus tard, resta collée dans les narines de la nature ébranlée.
La boucherie s’était déroulée en l’absence de Francesca Lamisère. La veille, bizarrement, Tante Gisèle, décédée bien longtemps à Savane Chaude, lui était apparue dans un songe bouleversant, qui lui avait figé le sang dans les veines. Ses yeux fixaient le faîtage durant le restant de la nuit. D’ailleurs, le départ tragique de Lebon avait presque divorcé, démarié ses paupières. Un mardi, peu avant l’arrivée de l’aube, pendant que le paysage dormait encore à poings fermés, Francesca se redressa d’un bond sur la paillasse pour aller allumer la lampe à kérosène. Ensuite, elle enfila une jupe froissée de couleur blanche et un corsage mauve usé. Les apophtegmes de Tante Gisèle virevoltèrent encore dans son cerveau. La veuve éplorée de La Roche, tout en se brossant les dents avec de la poudre blanche du carbonate de sodium, n’arrêtait pas de ruminer les aphorismes porteurs de mauvais présage.
« Francesca, ma fille,
Tu m’as abandonnée à Savane Chaude.
Tu n’es jamais venue me visiter
Dans ma gîte sans lumière.
Les fleurs sont fanées,
Et la poussière transportée
Par le vent de la haine
Et de la terreur
S’empile dans mes narines.
Lève-toi et suis l’étoile polaire
Jusque sur les lieux
De mon sommeil éternel…
Presse-toi de partir,
Car la chaleur du soleil
Montera dans la vallée
Avec des cris de détresse,
Des pleurs et du sang!
Francesca, ma fille,
Tante Gisèle a parlé…! »
Lorsque Francesca pénétra dans le périmètre du petit cimetière, non loin de l’habitation où elle avait vu son père et sa mère pour la dernière fois, elle s’était mise tout de suite à rechercher la fosse où Tante Gisèle était plongée éternellement dans sa douce turbulence. L’accroissement des tombes en terre battue et maçonnées aurait fait penser que le village de Savane Chaude dans son entier avait trépassé ? Depuis les temps immémoriaux, ceux qui n’avaient pas échappé à la « naissance » n’avaient pas pu se dérober non plus à la « mort ». Cette dualité incontournable, Francesca l’avait comprise à sa manière. Car l’une marqua le début de l’aventure, et l’autre, inexorablement la fin… D’où le dilemme shakespearien, « être ou ne pas être », dans Hamlet.
Une bonne quantité d’eau avait coulé sous les ponts depuis que la dépouille de sa grand-tante avait décomposé dans le ventre de la terre, là où la pauvre Gisèle avait souffert de tous les maux échappés de la jarre de Pandore : la misère, la maladie, la souffrance, la vieillesse, la mort… Par miracle, Francesca repéra le morceau de tissu rouge, déchiqueté, que la brise légère balançait autour de la croix plantée sur la tomberelle. Ce quartier de toile sale, c’était le mouchoir avec laquelle sa tutrice se nouait les reins les jours des grands découragements. Elle disait que le rouge était la couleur emblématique de la victoire et du changement, la référence matérielle et spirituelle des grands guerriers qui n’avaient pas peur de marcher dans la vallée à la rencontre de leurs ennemis traditionnels. Alors que la couleur blanche, à ses yeux, symbolisait la lâcheté, la défaite, la capitulation et la fuite. Tante Gisèle, par la justesse de ses réflexions philosophiques, fut, à sa façon, une Épicure, une Épictète ou une Aristote de la paysannerie… Francesca enleva les feuilles mortes, balaya la saleté qui s’accumulait tout autour de la tombe, et déposa dessus un grand bouquet de fleurs de lauriers, de rosiers rouges et de jasmins. Elle alluma une chandelle brune qu’elle fixa dans une coquille de mer, la garda serrée dans sa main gauche, puis invoqua l’« esprit des loas » et l’âme de la disparue. Elle lui avait parlé comme s’il s’agissait d’une vraie conversation entre deux « êtres vivants ».
« Tante Gisèle,
Je sais que là-bas,
Dans la Guinée lointaine,
Tu vois les tribulations de ta nièce.
La vie est devenue une torture
Pour nous qui habitons dans le village.
Nous souffrons chaque jour.
Lebon est allé s’installer
Au même pays que toi.
J’espère que,
Les deux, ensemble,
Vous prendrez soin
De mon garçon Sauveur
Et des onze autres enfants
Qui nous ont quittés très tôt.
Il n’y a aucun avenir à La Roche.
C’est le même problème
Pour les habitants de Savane Chaude
Et des autres places de la région.
Nous sommes essoufflés
De courir après une vie
Qui se déplace devant nous
Par les battements de ses ailes,
Comme une colonie d’oiseaux
Qui fuient la saison de la glace.
Lorsque j’étais enfant,
Je courais pour dépasser la lune.
Je voulais être plus rapide qu’elle…
Étonnamment, elle se déplaçait
Toujours en même temps,
Et même plus vite que moi.
C’est exactement la même chose
Qui nous arrive à La Roche.
La vie nous glisse entre les mains
Comme une anguille.
Impossible de la saisir du bon côté.
Je suis moi-même devenue
Une vieille femme fatiguée.
Je n’attends plus rien de mon pays…
Le peuple est abandonné
À sa misère et à la mort.
On raconte aussi
Que beaucoup de compatriotes
Sont enfermés dans les prisons
Du gouvernement.
Le président les fait battre
Par les gendarmes
Et les chefs de section,
Lorsqu’ils parlent du chômage
De la faim, de la maladie,
Et de la malnutrition des gosses.
« Nous mourons tous », en silence…
Les temps sont durs Tante Gisèle,
Très durs pour les familles pauvres.
La terre devient chiche et avare.
Elle prend les semences
Et les retient dans son sein,
Sans vouloir nous les rendre.
Le ciel n’est plus généreux envers nous,
Il garde son eau là-haut
Et nous envoie le soleil
Pour consumer les arbres
Et nous brûler la peau.
La Providence semble nous oublier!
Notre terre est devenue
Le prélude de l’enfer.
Tante Gisèle,
Toi qui me regardes
De ta maison invisible,
Aménage une place pour moi
Dans le royaume qui t’a accueillie.
La colère gronde chez nous.
J’ai confiance que les yeux des Mystères,
Les regards des Esprits de Bénin,
De Guinée et de Souvenance
Se poseront un jour
Sur les tribulations
Des « chrétiens vivants ».
Et ce jour là,
Les compatriotes, où qu’ils soient,
S’éveilleront et leurs ennemis,
Qui qu’ils soient, trembleront…
Tante Gisèle, je ne sais pas
Si je pourrai revenir un jour
Te voir à Savane Chaude,
Cependant, je conserverai
Toujours dans mon cœur
Les bons souvenirs que je garde de toi.
Tu m’as appris beaucoup de choses :
Tu m’as transmis le sens du courage,
De la résistance, de la lutte,
De l’honneur, de la dignité,
De la reconnaissance,
Du partage, de la solidarité,
De la responsabilité, de la vengeance,
De la contrition et du pardon.
Merci pour tout Tante Gisèle!
Sois en paix dans ta seconde vie! »
Pour se rendre au cimetière, Francesca était passée devant l’habitation où elle avait vécu avec sa grand-tante, au départ de ses parents pour la République dominicaine. Elle n’avait jamais su ce qu’étaient devenus Selondieu et Acélia. À cette époque-là, 35 000 viejos, dont les membres du corps furent serpés comme des branches d’arbres par les bouchers de Trujillo, pavèrent les villes et les campagnes de l’Est de l’île. Les cadavres de Selondieu Lamisère et d’Acélia Lachance, comme ceux de plusieurs autres braceros qui avaient été surpris dans les plantations, ne furent jamais retrouvés. En revoyant l’endroit de sa grande douleur, Francesca ressentait des malaises subits, et un torrent de peine inondait son cœur. Sa tête avait commencé à tournoyer comme une toupie de Chine. Elle s’asseyait un moment au bord du chemin pour ne par perdre connaissance. La zone lui rappela de bien mauvais et tristes souvenirs : le viol brutal qu’elle avait subi après le décès de Tante Gisèle, les durs moments de chagrins, les longues journées de privations et les heures interminables de solitude qu’elle avait endurés dans le logis délabré qui n’arrivait pas à barrer la clarté de la lune qui venait elle-même s’étendre arrogamment à côté d’elle, sur le grabat où Tante Gisèle avait rendu son dernier souffle. Après la disparition du vieux Simon, qui l’avait considérée comme sa petite fille, elle avait passé une année et demie seule et désemparée, toute une période difficile à avaler le fiel de la misère, sans avoir eu à ses côtés une force humaine protectrice sur laquelle elle aurait pu compter, et qui lui aurait indiqué tant bien que mal la direction à suivre pour échapper aux bourrasques de la vie.
Francesca récita le « Je vous salue Marie pleine de grâce… » Baragouina le « Notre père qui êtes aux cieux… » Jargonna l’acte de contrition : « Mon Dieu, j’ai un très grand regret de Vous avoir offensé, parce-que Vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché Vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de Votre sainte grâce, de ne plus Vous offenser et de faire pénitence ». Puis, d’une voix bredouillante, elle acheva le rituel par l’adjuration traditionnelle des campagnards dans les veillées funèbres : « Adorez Sainte Madeleine… » Au même moment, un événement prodigieux, tout à fait incroyable se produisit : la croix funéraire implantée sur la fosse s’était mise à bouger, et pourtant la terre ne tremblait pas à Savane Chaude. Encore un fait phénoménal, absolument étonnant, de fines rigoles de larmes semblaient jaillir du bois verminé. Le mystère dura quelques bonnes secondes. Francesca n’en croyait pas ses yeux. Elle plaça sa main sous la croix latine manchote, qui avait perdu un bras au cours des années, et sa paume tremblante en avait effectivement recueilli quelques gouttes. La Rochoise paniqua. Elle offrit ses bras au ciel. Et quitta hâtivement les lieux. Francesca avait présagé un grand et terrible malheur. Elle décidait de retourner au village de toute urgence.
Bruissements des feuilles tressautantes
Dans les allées défleuries
Où rode la Camarde
Tornade d’anxiété et de transe
Tourbillon de prémonition
Rafale de confusion
Sans cesse tambourinant
Dans une mémoire déphasée
Houle d’appréhensions
Sursaut d’égarements
Errements des pieds nus
Foulant le terrassement empierré
De l’impuissance mortelle
Cruauté
Phobie
Hécatombes
Tout devient
Des mots incisifs
D’un cantique funeste
Qui marque le bout
Du voyage tempétueux
Des suppliciés du destin
Sur les ailes de l’orage
Cependant
Au prochain tournant
Fort heureusement
Attend l’Aurore
Tant recherché
De ce Jour désenchaîné
L’astre d’Amaterasu, la déesse nippone, baisait les lignes de l’horizon, lorsque les collines qui bordèrent le sud de La Roche commencèrent à se préciser. Les crampes d’inquiétude bloquèrent la poitrine de Francesca. Elle n’était plus capable de respirer normalement. Ses narines ronflaient comme le pot d’échappement d’un vieux tacot sur une route défoncée. Enfin, après peine, misère et péripétie, elle était parvenue à se hisser sur le versant de la montagne. Le spectacle désastreux qui s’offrait à sa vue était indescriptible, irracontable, intraduisible… Chaque logis, chaque case, chaque maisonnette, tout s’était transformé incroyablement en des amas de cendres qui libéraient de minces filets de fumée fuligineuse. Et au milieu de cette vaste plantation de ruine, de débâcle, de délabrement et de consternation, pas âme qui vive ! Aucun signe de présence humaine vivante ! Et comme le poète Pierre de Ronsard [31], Francesca se voyait déjà aux portes de l’éternité :
« Je n’ai plus que les os, un squelette je semble,
Décharné, dénervé, démusclé, dépulpé,
Que le trait de la mort sans pardon a frappé,
Je n’ose voir mes bras que de peur je ne tremble.
Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble,
Ne me sauraient guérir, leur métier m’a trompé ;
Adieu, plaisant Soleil, mon œil est étoupé,
Mon corps s’en va descendre où tout se désassemble… »
La « guignarde », extrêmement choquée, complètement pétrifiée, porta les deux mains à sa bouche, dans un geste de désespoir abyssal, pour contenir l’ébranlement de son être et pour étouffer les sanglots de ses épreuves. Elle n’avait pas mis trop de temps à comprendre ce qui était vraiment arrivé, lorsque le pauvre chien d’Espérandieu, trébuchant sur ses pattes, blessé grièvement à la tête, vint se réfugier dans ses jambes qui tremblaient de saisissement. Le liquide rougeâtre avait coloré les poils blancs de la malheureuse bête. Confiance gémissait de souffrances. L’animal expira quelques minutes plus tard dans les bras de Francesca.
Francesca Lamisère poussa des cris avec une voix râlante. Ces yeux voilés par l’endeuillement subit clignèrent de frayeur. Ses membres vidés, débilisés vibrèrent de terreur. Elle s’affaissa sur ses genoux et tendit ses deux bras dans les airs. La fumée épaisse qui montait dans le firmament irritait les nuages atterrés. Francesca baissa la tête, ferma les yeux et le village se mettait, petit à petit, à se reconstituer dans sa mémoire froissée, abasourdie. La pauvre dame était littéralement plongée dans un état de paracousie. Elle croyait entendre des voix humaines qui arrivaient de partout, des glapissements d’enfants qui batifolaient, des chansons d’inspiration champêtre que le vent rapportait des bugadières, des jappements de chiens qui se disputaient un os chez la vieille Erzulie, des grognements de porcs qui se lassaient de leurs enclos, des braiments d’ânes et de mulets chargés de victuailles qu’ils transportaient jusqu’au marché, des mugissements de vaches qui refusaient de donner leur lait, des caquètements de poules qui picoraient… Enfin, son moral en berne virevoltait dans un tourbillon d’hallucinations sonores. Francesca Lamisère, la dernière des Rochois, était tombée dans un état de pithiatisme qui la déconnectait complètement de la réalité brutale. Il ne restait plus que les vers de Paul Verlaine pour extérioriser son désarroi et son amertume:
« Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui s’écœure.
Quoi! nulle trahison?
Ce deuil est sans raison. »
Coriolan Ardouin, de l’École littéraire de 1836, sans le savoir, avait prophétisé à Francesca Lamisère – la Clotilde de Léon Bloy dans « La femme pauvre » – un destin d’orages, humecté de larmes et saccadé de sanglots :
« Hélas! en vain sa fille, ange du ciel venue,
Montrait à ses regards son enfance ingénue!
Comme un astre pâli se plonge à l’horizon,
Il abîma son cœur en des flots d’amertume,
Et lorsqu’après sa mort on écarta l’écume,
On vit le désespoir au fond. »
Francesca La Misère, « la femme de douleur », se releva lentement sur ses jambes affaissées. Le glas avait sonné une dernière fois pour les habitants de son patelin. La page fatidique du fascicule existentiel des Rochois, écrit sur le parchemin de l’exploitation, du mépris et de la souffrance, avec le sang des suppliciés, avait tourné sur la plus terrible des tragédies « que la terre eût portées jusque-là dans ses flancs », pour paraphraser Ésope ou Jean de La Fontaine. La veuve de Lebon tangua quelques instants, à la manière d’un youyou tiraillé par le ressac. Le long soupir qui se dégageait de ses poumons haletants préludait un épilogue à double tranchant : la redéfinition même des concepts de la « Vie » et de la « Mort », par rapport aux croyances traditionnelles et religieuses. Ce matin-là à La Roche, les paysans avaient accepté de « Mourir pour Vivre » : une défiance flagrante de l’une des Lois de la Nature, celle que le philosophe Héraclite révéla comme le « principe essentiel de l’unité des contraires ».
Le Révérend Joanel répétait : « Quand le soleil se couche, la journée se termine, c’est que la nuit arrive; tout cela se fait pour laisser de la place à un jour nouveau. Mes chers camarades, ce qui est encore important à retenir: « Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Un jour pour chasseur, un jour pour gibier»
Une nuée de « Wanga Nègès » envahit le firmament en transe. Les âmes profanées des Rochois assassinés avaient commencé à errer dans les voûtes néantisées, en attendant sûrement et patiemment « cette nuit de la Colère ».
Robert Lodimus
La Mort pour la Vie ou Mourir pour Vivre
(Prochain extrait : chapitre XVI, La Mission)
