— Par Laurent Luquet —
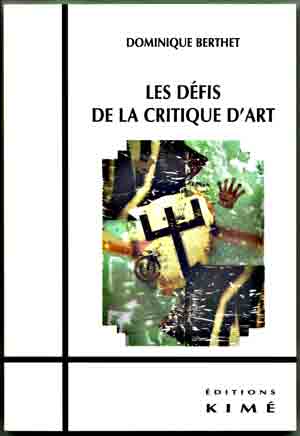 Comment s’y retrouver dans le foisonnement des discours de la critique autour de l’œuvre d’art ? Entre autres qualités, l’ouvrage de Dominique Berthet fournit à la fois les moyens d’une orientation et l’occasion d’un questionnement de la « relation particulière qu’entretient celui qui projette de parler d’une œuvre avec l’œuvre elle-même » (p. 7). N’hésitons pas à saluer d’emblée l’agencement du texte : l’auteur réussit le tour de force de présenter une progression à la fois historique et analytique. D’une part, trois grandes figures littéraires – Lessing, Diderot, Baudelaire – sont l’occasion d’une archéologie des enjeux de la critique d’art. Ensuite, dans un chapitre en épi, D. Berthet fait dialoguer les apports méthodologiques de Panofsky et Francastel. Enfin, après cette clé de voûte quasiment épistémologique, l’auteur termine l’autre partie de son cintre par trois chapitres résolument tournés vers la critique contemporaine. C’est dire que cet ouvrage présente une réelle architecture qui, dans sa composition même, jette un pont entre une tradition et notre contemporanéité.
Comment s’y retrouver dans le foisonnement des discours de la critique autour de l’œuvre d’art ? Entre autres qualités, l’ouvrage de Dominique Berthet fournit à la fois les moyens d’une orientation et l’occasion d’un questionnement de la « relation particulière qu’entretient celui qui projette de parler d’une œuvre avec l’œuvre elle-même » (p. 7). N’hésitons pas à saluer d’emblée l’agencement du texte : l’auteur réussit le tour de force de présenter une progression à la fois historique et analytique. D’une part, trois grandes figures littéraires – Lessing, Diderot, Baudelaire – sont l’occasion d’une archéologie des enjeux de la critique d’art. Ensuite, dans un chapitre en épi, D. Berthet fait dialoguer les apports méthodologiques de Panofsky et Francastel. Enfin, après cette clé de voûte quasiment épistémologique, l’auteur termine l’autre partie de son cintre par trois chapitres résolument tournés vers la critique contemporaine. C’est dire que cet ouvrage présente une réelle architecture qui, dans sa composition même, jette un pont entre une tradition et notre contemporanéité.
Questions de méthode :
D. Berthet établit donc d’abord les principaux apports de Lessing à la critique d’art. Contre la doctrine de l’Ut pictura poesis, le Laocoon ou Des frontières de la peinture et de la poésie opère une relecture critique de ses sources antiques pour mieux dégager la « différence de structure entre poésie et peinture » (p. 16). Il met du même coup un terme à la subordination de la peinture et de la sculpture à la poésie. En délimitant le domaine propre aux arts visuels, Lessing montre parallèlement la nécessité de renouveler les critères d’appréciation des œuvres : à domaines spécifiques, critères spécifiques. C’est pourquoi on peut tout aussi bien le considérer comme « un précurseur de la méthode formelle de l’étude des œuvres d’art » (p. 19). Autrement dit, l’autonomisation des arts visuels doit se prolonger en une autonomie de la méthode d’analyse.
Contrepoint résolument subjectiviste de cette approche de l’œuvre, les deux figures diderotienne et baudelairienne méritent d’être rapprochées pour deux raisons : d’une part, Baudelaire emboîte ouvertement le pas à son illustre prédécesseur ; d’autre part, dans les deux cas, le critique assume une posture judicative. Mais ce qui les sépare, c’est d’abord le contexte de leur écriture : Diderot n’écrit pas pour le public, mais pour quelques destinataires privilégiés de sa correspondance ; c’est ensuite le style de cette critique : avec Diderot triomphe une subjectivité qui affiche ses plaisirs mais sans le souci d’une esthétique systématique ; avec Baudelaire se fait jour une ambition plus philosophique.
On retrouve cette systématicité plurielle chez Panofsky et Francastel, les deux grands noms qui scandent l’approche sociologique (chapitre IV). On entre alors dans un autre champ de la critique d’art, qui requiert lui-même une autre posture, plus distanciée mais sans que pour autant la subjectivité soit complètement éliminée. D. Berthet suggère par là même qu’il faut trouver une voie entre le double écueil d’un éliminativisme objectiviste et d’un réductionnisme subjectiviste. C’est la difficulté de cette ligne de crête que développent les derniers chapitres de l’ouvrage.
Méthodes en question : postures et impostures.
Autant D. Berthet entrait dans le détail des postures de Lessing, Diderot et Baudelaire, autant il commence, dans le chapitre intitulé Considérations sur la critique d’art contemporaine, par donner une vision panoramique des discours actuels autour de l’œuvre. Tout d’abord, cette critique révise la posture judicative et se présente volontiers comme un complémentaire de l’œuvre sans prétention à la complétude. Mais surtout, D. Berthet relève son mouvement de réflexion sur elle-même – mouvement qui inquiète les fondements mêmes de ce type de discursivité. Rappelant de multiples témoignages, il insère par ailleurs un propos particulièrement ravageur contre une critique qui, par crainte de déplaire, s’abîme dans une complaisance lénifiante à l’égard de multiples institutions. L’auteur analyse alors, pour mieux les invalider, les multiples processus circulaires d’autojustification. C’est pourquoi, à juste titre, D. Berthet clôt son chapitre en saluant « la pensée d’auteurs comme McEvilley, Rochlitz ou Scarpetta qui invite au sursaut ».
Mais alors, en quoi pourrait consister ce sursaut ? La voie semble avoir été entrouverte par Walter Benjamin et sa distinction entre la « teneur chosale » et la « teneur de vérité » d’une œuvre. Mais cette critique interprétative est restée quasiment lettre morte « dans le contexte d’une critique promotionnelle et laudative liée à l’affairisme du milieu artistique et à l’institution » (p. 97). Autant dire que la critique semble avoir tout perdu de ce qui fut jadis sa force de subversion, suivant en cela un certain épuisement des avant-gardes. Opérera-t-on alors un retour à Kant – ou du moins à un Kant simplifié – en considérant que le plaisir est l’essentiel de l’expérience esthétique ? Mais c’est là encore, comme le souligne D. Berthet, une manière de réduire le rapport à l’œuvre à une expérience intime en complète contradiction avec le fait que le discours critique s’adresse nécessairement, pour être compris, à la subjectivité recréatrice du lecteur.
Devant l’éclatement, du discours critique contemporain, il est donc urgent de se poser la question de l’unité du concept. Unité trompeuse qui, en fait, dissimule la pluralité des postures critiques. Et d’abord comment distinguer de l’imposture une posture authentiquement critique ? Ecartons d’emblée toutes les niaiseries autorisées qui paraissent assumer leur supercherie en postulant que tout est imposture. D. Berthet ouvre, quant à lui, une voie en partant des attentes légitimes du lecteur de ce type de discours. Et c’est précisément ici que s’esquisse une solution : le discours critique, quels que soient ses présupposés méthodologiques, est un discours qui fait médiation entre l’œuvre et le public. Du coup, il est de facto soumis à des exigences de compréhension par un spectateur qui est aussi son lecteur. Mais alors, parce qu’il parle de l’œuvre à autrui, il ne saurait être un simple compte-rendu d’une expérience émotionnelle ou jubilatoire intime et doit faire de l’émotion un point de départ, certes, mais tout aussi bien un moment dont il faut se départir dès lors qu’on destine son discours à un autre sujet en exigence de compréhension.
07 Octobre 2006, Laurent Luquet
Dominique Berthet, Les défis de la critique d’art, Paris, Kimé, 2006.
