Retour sur un débat loin d’être clos
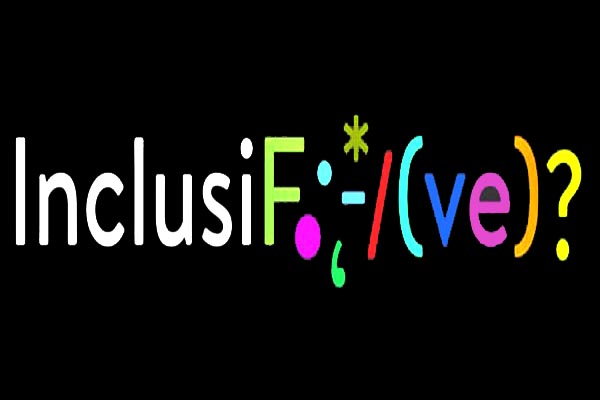 Rappel des faits L’écriture inclusive, ensemble de procédés visant à féminiser certains aspects de la langue française, fait débat dans la sphère publique.
Rappel des faits L’écriture inclusive, ensemble de procédés visant à féminiser certains aspects de la langue française, fait débat dans la sphère publique.
Un des derniers bastions de la domination masculine par Éliane Viennot, Professeure émérite de littérature française et Raphaël Haddad, Docteur en sciences de l’information et de la communication.
Polémiques autour de la publication d’un manuel scolaire par les éditions Hatier, fable de La Fontaine parodiée, prises de position sarcastiques : l’écriture inclusive a fait cette semaine irruption dans la controverse publique. Si le débat est évidemment souhaitable, les formes exaltées qu’il a prises dans certains médias (où les « contre » ont souvent abusé d’anathèmes et chargé des moulins à vent) ne l’ont guère éclairé.
Commençons donc par une définition : l’écriture inclusive désigne l’ensemble des attentions graphiques et syntaxiques permettant d’assurer une égale représentation des femmes et des hommes dans la langue écrite, attentions qu’on retrouve évidemment pour partie dans la langue orale. Le langage est en effet ce par quoi les mentalités se structurent et il est illusoire de penser qu’elles pourraient changer, faire advenir l’égalité des sexes en continuant d’être formatées par des usages linguistiques qui ne cessent de réaffirmer la primauté d’un genre sur l’autre. Ou plutôt, pour le dire dans les termes que tout le monde a appris à l’école : que le masculin l’emporte sur le féminin. On sait aujourd’hui que cette formule a été choisie par les mandataires de l’école de la République, pour remplacer (sans en changer l’esprit) celle qu’avaient mise au point au XVIIe siècle des grammairiens désireux d’asseoir dans la langue la domination du « genre le plus noble ». Des gens qui rétorquaient à leurs contestataires : « Le masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle » (Nicolas de Beauzée, 1767). Des gens qui n’ont pas hésité non plus à condamner des noms de métiers vieux de plusieurs siècles (autrice, écrivaine, médecine, peintresse…), puis à les exclure des dictionnaires qu’ils confectionnaient, afin que les emplois ainsi désignés paraissent propres aux seuls hommes.
Sachant cela, parler de l’écriture inclusive comme d’une terrible entrave à la liberté ou d’une destruction de la langue française pourrait sembler risible, si l’invisibilisation du féminin dans notre langue n’avait pas comme corolaire la relégation, voire le mépris, des femmes dans notre société. Faut-il rappeler que, en France, tous les jours, des milliers d’hommes battent leur compagne, et que, tous les deux jours, l’un d’entre eux en vient à la tuer ? Que l’écart des salaires piétine depuis quarante ans et qu’il demeure aujourd’hui de 23,5 % en moyenne à poste, ancienneté et niveau de diplôme égaux ? Que les hommes continuent de s’exempter massivement des tâches ménagères ? Que 100 % des femmes de ce pays ont subi du harcèlement de rue (sifflets, insultes, poursuites) ? Pourtant, notre Constitution affirme depuis soixante-dix ans l’égale valeur des deux sexes et les déclarations vertueuses sur ce chapitre sont légion ! Certes, notre pays n’est pas le seul à connaître ces maux. C’est pourquoi il n’est pas le seul à mener une réflexion sur le rôle du langage dans ce sur-place et à en promouvoir une modernisation.
Quoi de plus normal, en conséquence, que des femmes, des hommes, des entreprises, des institutions adoptent désormais les préconisations élaborées depuis plusieurs décennies, soit pour lutter contre les stéréotypes de sexe, soit pour accompagner au mieux les politiques visant à la progression de l’égalité ?
Poursuivons donc avec ces préconisations, qui se déclinent en trois grandes conventions. La première concerne le lexique : il s’agit d’utiliser les noms de fonctions, grades, métiers et titres à bon escient, c’est-à-dire au masculin quand on parle d’hommes et au féminin quand on parle de femmes, comme l’exige le système du français (et de toutes les langues romanes). Il faut en finir avec le jargon compassé qui voudrait qu’une femme soit un juge, ce qui conduit inévitablement à des fautes de grammaire (le juge est arrivée), voire à des rédactions absurdes (le juge est en congé maternité). Il faut finir par comprendre que les prétendues exceptions n’en sont pas : qu’un homme peut être une sentinelle (parce qu’il s’agit d’une vieille métaphore), comme il peut être une vraie gourde. Et qu’il peut aussi être sage-femme, parce que le premier terme désigne la personne compétente, et le second la parturiente.
La deuxième convention concerne le recul du prétendu « masculin générique », l’abandon de la règle qui voudrait qu’il « l’emporte », et l’adoption de quelques autres procédés faciles à utiliser. L’habitude de parler de groupes mixtes au masculin est porteuse de confusion et d’occultation. Dire que « les étudiants sont souvent obligés de travailler pour financer leurs études », c’est passer à la trappe le fait qu’il y a plus d’étudiantes que d’étudiants, et que les travaux en question ne sont pas forcément les mêmes. Il ne s’agit pas de répéter, dans chaque phrase, les deux substantifs ou les deux pronoms, mais d’utiliser suffisamment les termes qui renvoient aux unes et aux autres pour qu’il soit clair qu’on s’intéresse aux deux sexes. L’abandon de la primauté du masculin en matière d’accords est également souhaitable. S’adresser au féminin à une assemblée où les femmes sont très majoritaires ne fera pas plus mourir les quelques hommes qui en font partie que le contraire, qui s’expérimente tous les jours, ou alors les hommes sont vraiment très fragiles. Accorder l’adjectif ou le participe passé avec le terme le plus proche lorsqu’il y en a plusieurs s’est fait durant des siècles, vu que c’est un mécanisme beaucoup plus simple que de vérifier le genre des termes qui l’accompagnent. Montaigne le faisait, Racine aussi, M. Enthoven devrait pouvoir y arriver. Dans le même ordre d’idées, il est préconisé de choisir l’ordre alphabétique (tous et toutes), de favoriser l’emploi de termes épicènes (membres, personnes) et de fonctions (la présidence, la direction). Et de créer des termes génériques grâce au fameux point milieu (intellectuel•le). Cette dernière option n’est donc pas la seule manière de réinsérer du féminin dans notre langue.
Enfin, la troisième convention consiste à abandonner les expressions où trône « l’homme », dont on nous dit – depuis que les femmes ont le droit de vote – qu’elles englobent les deux sexes. En réalité, elles ne font que renforcer la prévalence masculine. En France, comme dans la plupart des autres pays, les « droits de l’homme » doivent devenir les « droits humains » ou les « droits de la personne (humaine) ». Non seulement il semblera plus légitime de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, mais ce sera l’occasion de mieux expliquer pourquoi il a fallu attendre cent cinquante-cinq ans, entre la fameuse Déclaration et l’ordonnance signée par le général de Gaulle, pour que les femmes accèdent à la citoyenneté. De même, oublier les « sciences de l’homme » au profit des « sciences humaines » facilitera la prise en compte des études sur les différences (ou les ressemblances) entre les sexes par la communauté scientifique, encore si rétive face à cette problématique. Cela nous aidera également à adopter des formulations plus inclusives dans notre langage.
Les masculinistes d’aujourd’hui s’en donnent à cœur joie en attaquant, en réduisant et en caricaturant l’écriture inclusive. Sans doute, parce qu’elle remet en cause l’un des derniers bastions de la domination masculine. Il faudra pourtant en passer par là, si l’on veut faire véritablement progresser l’égalité.
*****
***
*
Aperçu de l’opinion sur la question par Jean-Daniel Lévy, Directeur du département politique et opinion de Harris Interactive en France.
Le sujet s’est installé dans le débat public depuis quelques semaines. Mots Clefs, agence de communication en influence, a mobilisé Harris Interactive afin d’y voir plus clair dans le rapport des Français à l’écriture inclusive. Ainsi avons-nous réalisé une étude en ligne les 11 et 12 octobre 2017 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Les personnes interrogées avaient-elles une perception fine ou vague de ce sujet ? 41 % d’entre elles déclarent avoir déjà entendu parler de l’écriture inclusive et plus particulièrement les hommes (45 %) et les profils les plus diplômés (55 %). Cette notoriété apparente ne doit pas pour autant masquer un manque de connaissance approfondie : seules 12 % déclarent savoir précisément de quoi il s’agit.
Quelle définition retenir ? L’écriture inclusive, définie comme « la volonté d’utiliser le genre féminin autant que le genre masculin à l’écrit, via notamment la féminisation des noms de métiers et l’usage du féminin et du masculin plutôt que du masculin générique », séduit la majorité des personnes interrogées : 75 % s’y montrent favorables, dont 24 % très favorables. Les femmes et les personnes les moins diplômées se disent légèrement plus en sa faveur (respectivement 79 % et 83 %). Rappelons toutefois que l’échantillon a été sollicité sur des principes de l’écriture inclusive en général, et non sur l’usage du point milieu en particulier. Aucune catégorie de population ne se déclare majoritairement opposée à l’écriture inclusive. On remarque néanmoins une corrélation entre le degré de connaissance déclaré et l’opinion sur l’écriture inclusive : plus les personnes interrogées se disent renseignées sur le sujet et moins elles s’y montrent favorables. Les personnes affirmant savoir précisément ce qu’est l’écriture inclusive s’y montrent opposées à hauteur de 47 % (contre 25 % en moyenne dans la population).
Autre enseignement de cette enquête, les personnes interrogées établissent peu de distinction entre les différents aspects de l’écriture inclusive et se montrent aussi favorables à la féminisation des noms de métiers (84 %) qu’à l’utilisation du féminin et du masculin plutôt que du masculin générique (81 %), les mêmes catégories (femmes, personnes peu diplômées) se montrant davantage en leur faveur. Chez les personnes indiquant être opposées à cette écriture, 46 % se déclarent tout de même favorables à la féminisation des noms de métiers, et 42 % à l’utilisation du féminin et du masculin.
En menant l’expérience, on constate aussi que les formulations inclusives ou épicènes permettent de donner jusqu’à deux fois plus de place aux femmes dans les représentations spontanées. Avant d’être interrogées sur l’écriture inclusive, les personnes ayant répondu ont été invitées à citer des personnalités, de façon totalement ouverte. Chaque tiers de l’échantillon était exposé à une formulation différente : l’une genrée, le masculin l’emportant sur le féminin ; l’une inclusive, mentionnant à la fois le féminin et le masculin ; la dernière épicène, utilisant la périphrase (« des personnes qui… »). Dans chacun des cas, les personnes ayant été exposées aux énoncés genrés, tels que « citez deux présentateurs du journal télévisé » ou « citez deux champions olympiques » ont davantage cité uniquement des hommes, tandis que les personnes ayant vu les autres formulations ont systématiquement mentionné davantage de personnalités des deux sexes, voire uniquement des femmes.
On le voit les Français sont, pour une grande majorité d’entre eux, favorables au principe de l’écriture inclusive. Reste, maintenant, à identifier les modalités de pratique qu’ils sont prêts – ou non – à accepter, voire à pratiquer.
Source : L’Humanité.fr
