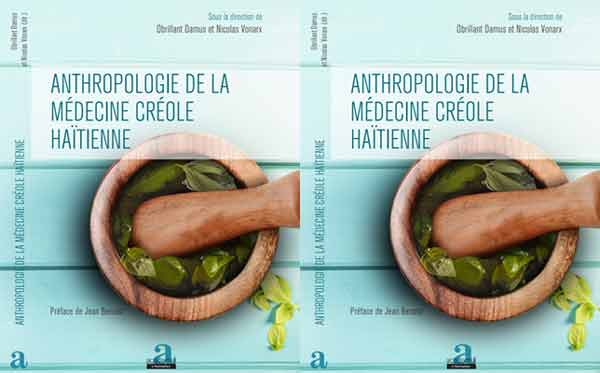 Sous la direction d’Obrillant DAMUS et Nicolas VONARX. 2019. Éditions Academia, Louvain-La-Neuve.
Sous la direction d’Obrillant DAMUS et Nicolas VONARX. 2019. Éditions Academia, Louvain-La-Neuve.
Préface de Jean Benoist
Médecin et anthropologue, professeur retraité de l’Université de Montréal et de l’Université Paul Cézanne, Aix-Marseille
Comment peut-on articuler les apports de la biomédecine et ceux d’une médecine traditionnelle ? La question est souvent posée, mais elle demeure ouverte malgré bien des travaux, car les situations sont multiples et surtout parce que les différences de points de vue entre les auteurs reflètent des conceptions variées de la maladie et du soin.
Ce livre contribue à l’avancement de ce questionnement, et cela d’autant mieux que, centré sur Haïti, il s’appuie sur un monde créole. Quel autre univers culturel articule aussi bien les courants thérapeutiques qui convergent dans une société, que ce monde créole, fait d’héritages divers et de synthèses souvent très réussies ? On doit saluer le travail des auteurs et des coordinateurs de ce livre qui, sans nul doute, marquera une étape sur le chemin d’une atténuation des ignorances réciproques et d’une résolution des antagonismes.
En effet, le terme « maladie » est un objet de pensée moins précis et plus difficile à cerner qu’on le pense communément. Quelle réalité désigne-t-il, à quelle pensée répond-il ? De quoi parle-t-on lorsqu’on emploie ce mot ? Les soignants ne l’emploient pas de façon prioritaire : les thérapeutes traditionnels, et tout autant les médecins, plutôt que de parler de « la maladie » en général utilisent plus souvent le nom de ce qu’ils diagnostiquent et qui ne correspond pas toujours, en tout cas pas uniquement, à ce qu’entendent ceux qui se réfèrent à « la maladie ».
Par contre les sociologues, les anthropologues, les historiens et en général ceux qui étudient la maladie dans le champ social et culturel en font un large usage. Parfois le terme devient très englobant et quelque peu flou. Or notre premier souci en la matière doit être la clarté afin d’éviter de raisonner sur des bases incertaines et multiples. En effet les maux du corps et de l’âme, tels que les ressentent ceux dont ils se sont emparés, tels qu’ils se présentent au quotidien, sont en fait au carrefour de plusieurs réalités, de plusieurs domaines de la vie humaine. Et c’est l’ensemble de ces perturbations en interaction, qui est vécu sous le nom de « maladie ».
***
La clarification d’un premier point est essentielle : les corps de tous les êtres humains sont semblables dans leur anatomie et dans leur fonctionnement. Ce que le médecin et le biologiste observent d’une infection, d’une tumeur, des conséquences d’un accident, du mauvais fonctionnement d’un organe vaut pour le monde entier. Quel que soit le lieu de l’observation, les résultats des découvertes médicales sont immédiatement utilisables pour toute l’humanité, toutes sociétés, toutes cultures. Le décryptage des causes du Sida et des mécanismes de lutte contre lui sont le résultat de travaux effectués dans le monde entier et dont chaque être humain peut tirer directement parti. L’unicité biologique du corps humain fait qu’une technique chirurgicale ou médicamenteuse mise au point quelque part est directement transférable ailleurs, si les conditions matérielles de son administration sont remplies.
Cependant, il en va différemment au quotidien, lorsque le soignant rencontre effectivement le malade. Car les conditions dans lesquelles cela se passe ne dépendent pas que de la dimension universelle de la maladie. La compétence du soignant, la disponibilité des soins et des médicaments, celle du matériel de diagnostic, la façon dont se noue la relation entre le soignant et celui qui le consulte ne sont pas des universaux. Ce sont des réalités sociales, culturelles, politiques, économiques locales, très différentes d’un lieu à un autre, d’une société à une autre. Par ailleurs les bases sur lesquelles on décide qu’un état physique ou un comportement nécessite des soins varient selon les sociétés. La tendance moderne est de médicaliser divers états physiologiques qui, sans être anormaux, comportent des risques, comme l’accouchement. Cela dans un souci de prévention. C’est aussi de qualifier de pathologiques des comportements que bien des sociétés acceptent ou auxquels elles donnent des significations normales. La maladie dans la société n’est pas celle vue de l’hôpital ou du laboratoire. Elle est un fait que son ancrage dans la réalité sociale rend avant tout local.
Mais c’est un troisième point qui fait la substance de cet ouvrage et qui suscite les interrogations les plus pertinentes. La maladie n’est pas seulement le trouble pris en charge dans une société donnée. Elle est vécue. Et à cause de cela, elle est interprétée, représentée par celui qui la subit. Il se pose des questions dont il trouve les réponses dans son entourage immédiat, dans ce que lui ont enseigné ses proches, dans ce que lui ont appris ceux qui dans son milieu pratiquent des soins : ces représentations sont directement ancrées dans la « culture », dans sa culture, en lien avec son environnement naturel et social, avec sa pensée religieuse, avec ce qui lui a été transmis par l’exemple et par le consensus de ses proches.
Et nous nous trouvons là à un autre niveau de la maladie, celui où opèrent les « médecines traditionnelles ».
Haïti offre donc à l’observateur, face à la façon dont se combinent ces trois niveaux, un champ particulièrement riche. En effet les médecins haïtiens sont nombreux et compétents, même si malheureusement on en rencontre beaucoup à l’étranger où ils sont très appréciés. Quant au domaine traditionnel, il y est très vivant, que ce soit dans le vodou, omniprésent dans les consciences, ou par le relais plus récent des médecines « douces » venues d’ailleurs.
Le champ de la pathologie mentale est à cet égard le plus fascinant, et ce n’est pas un hasard s’il est très représenté dans ce livre. Frantz Raphael expose à quel point il est plus présent qu’aucun autre dans la conjonction de systèmes de représentation divers, qui dans la réalité, loin de se combattre, se coordonnent dans une perception des étiologies et dans le choix des thérapeutiques. « Certains croient que le diable est en enfer, qu’il peut descendre du ciel et prendre possession des humains. D’autres savent qu’il est avec nous sur terre au jour le jour, et en dernier lieu, d’autres pensent que le diable n’existe pas, qu’il n’y a que des maladies. »
Ce propos porte au-delà d’Haïti ; tout en disant parfaitement ce qui s’y passe, il peut s’appliquer à bien des sociétés, y compris la société française, au moins telle qu’elle était lors de la période esclavagiste. En effet, ne surestimons pas la distance entre les « dominants » et les « dominés », car ils ont toujours partagé bien des croyances et participé à bien des pratiques communes : une grande part de toutes les médecines créoles réside, dès leur début, dans des croyances et pratiques médicales traditionnelles européennes des 17e et 18e siècles qui se sont littéralement métissées avec les apports africains et quelques usages amérindiens. La créolité de la médecine est en ce sens similaire à celle du langage. L’un et l’autre sont nés de la convergence d’apports qui datent des origines de la créolité. Le contraste affiché entre une médecine « moderne » et une médecine créole mérite une discussion prudente et son étude exige d’éviter les anachronismes.
Mais Haïti possède plus que bien d’autres un héritage africain, très structuré par le vodou et Nicolas Vonarx plaide de façon très convaincante pour une prise en considération, par-delà le fait religieux, de la dimension « recours thérapeutique », et j’ajouterai « diagnostique », du vodou. Il souligne que l’on a trop souvent oublié dans des travaux sur les rituels et la mythologie du vodou que « les espaces religieux sont souvent des lieux de recours aux soins où les personnes en souffrance viennent chercher de l’aide dans la gestion de leurs infortunes et leurs épisodes de maladie ». Les chapitres qu’il présente apportent une intéressante documentation à ce propos et montrent combien cela est vrai en Haïti. Son étude du doktè-fèy comme figure thérapeutique est exemplaire à cet égard.
C’est tout autant dans ce qui relève de l’ordre des phénomènes naturels que la tradition et la modernité en matière de soin et d’interprétation des faits relatifs au corps, normal ou pathologique, s’interpénètrent. À propos de l’allaitement et de son inscription dans un temps rituel et donc porteur de significations, Obrillant Damus montre avec un grand soin comment il « prend sens dans les creusets culturels et sociaux ». Une ethnographie minutieuse lui permet de comprendre comment un acte apparemment simple est enveloppé d’une riche symbolique que de nombreuses pratiques mettent au jour.
Dans la prise en charge de la santé et de ses aléas, les malades font preuve d’un pragmatisme qui ne s’encombre pas des doctrines ni des contradictions apparentes. Ils suivent en tâtonnant un itinéraire qui combine des formes de recours issues de toutes les sources dont ils peuvent avoir connaissance. En ce sens, ils donnent une leçon de liberté aussi bien à ceux qui refusent toute collaboration avec des pratiques traditionnelles de soin qu’à ceux qui leur octroient une place exclusive. Dans leurs travaux, Johanne Tremblay, puis Marie Cauli montrent avec l’œil de l’observateur attentif et ouvert comment, par-delà les antagonismes et les contradictions et à la manière de ce que nous enseigne le cheminement des malades, les savoirs transmis par la tradition et les connaissances les plus actuelles peuvent coopérer en participant, chacun sous sa forme propre et dans son domaine, dans l’effort en vue d’alléger le fardeau de ceux qui sont soumis au malheur, à la douleur, à la proximité de leur mort ou de celle de l’un de leurs proches.
***
Ainsi, comprendre et aménager si cela est possible, les relations entre les diverses façons de concevoir et de prendre en charge la maladie n’est pas seulement une question académique ne concernant que des chercheurs, mais cela s’arrime directement aux réalités haïtiennes. Or la maladie étant une charge pour chacun et le combat pour l’alléger étant une tâche qui concerne chacun, cet effort pour comprendre, et sans doute pour mieux agir, a une dimension pratique, car les choix, les comportements des intervenants et leur capacité d’écoute dépendent de leur sensibilité en ce domaine. Ne pas se replier sur ce que l’on croit savoir, échapper aux doctrines et aux rigidités, rester ouvert à ce qui se fait, à ce qui est, à ce qui se pense et se transmet est une condition très importante de tout progrès non seulement dans la théorie, mais surtout dans la pratique quotidienne des soins.
Et se combinent ici plusieurs niveaux d’une exigence que l’on pourrait qualifier d’éthique si le mot n’était aussi galvaudé.
On doit d’abord savoir qu’on ne peut refuser aux malades d’Haïti le meilleur de la médecine au nom d’une quelconque tradition. N’oublions jamais qu’aucune « médecine traditionnelle » fut-elle chinoise, indienne, arabe ou européenne n’a accru l’espérance de vie, jugulé les épidémies, guéri la lèpre ou la peste, qu’aucune matrone n’a jamais réduit la mortalité des femmes enceintes ou des nouveau-nés.
Mais n’oublions pas non plus qu’on ne peut pas refuser d’entendre les malades. Ils ne sont pas que des corps, ni des cerveaux « dérangés ». Leurs maladies, ils les vivent, ils en souffrent, ils les interprètent, elles perturbent leur place dans la société, elles les placent devant l’angoisse de la mort. Leur société, leur culture ont élaboré des réponses. Elles savent comment aborder les malades, les convaincre et souvent les soigner. Médecines ? Le mot prend alors bien des sens et désigne bien des actes, bien des formes de recours et de secours. Simples pansements culturels ou vérité aux effets concrets, médecines du corps ou soins de l’âme, qu’importe, ils remplissent leur rôle en apportant un sens, en permettant d’harmoniser le malheur avec le destin, en donnant un espoir qui bien souvent efface certains des ravages du mal, quitte à ce que cet effacement soit éphémère. Il s’agit là de deux dimensions de la prise en charge de la maladie, car elle est à la fois malheur global de l’individu, vécu dans sa famille et dans sa communauté, et altération de son corps. Comment agir au profit des malades, dans l’authenticité d’une culture, en ne cédant jamais ni au simplisme biologisant ni aux facilités de certitudes idéologiques qui tiennent lieu de connaissance ? Comment respecter la culture et le religieux tout en balisant leur place et en admettant les limites de leur pouvoir sur le mal ? Comment prendre en charge le malheur, comment soigner la représentation du mal si on n’écoute pas, si on n’accepte pas la représentation du monde que vit le malade ? Et cela sans déroger à l’exigence éthique de lui donner accès à tout ce qui est acquis dans la lutte contre les fondements corporels de son mal ? En ce domaine, toute opposition, tout affrontement deviennent des luttes qui fragmentent le souffrant et le blessent au lieu de le soigner.
Panser et penser, soigner et prendre soin : écouter la société, écouter la culture sont nécessaires pour y parvenir. Belle tâche à laquelle ce livre apporte sa part.
