— Par Selim Lander —
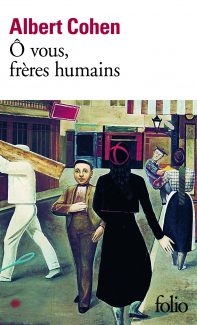 Un texte contre le racisme, un récit, pas une pièce de théâtre. Un vieil homme se remémore un incident de son enfance au cours duquel il s’est découvert brutalement autre que celui qu’il croyait, un être susceptible de provoquer la haine et le mépris ; dans sa logique enfantine, il a conclu qu’il était sans doute méchant pour être maltraité ainsi, sinon lui du moins sa race. Cela se passait à Marseille, tout-à-fait au début du XXe siècle. Sa famille s’est installée depuis peu dans le midi de la France, un pays qu’il idéalise, qu’il idolâtre même s’il faut en croire son récit, au point d’installer sur une étagère de l’armoire de sa chambre une sorte d’autel couvert de reliques des gloires de la France telles qu’il peut les percevoir, à neuf ans, jusqu’à un sachet de terre des colonies acquis auprès d’un de ses camarades d’école, graine d’escroc ! Au retour de l’école, le petit Albert s’est arrêté pour écouter un camelot dont il admirait la faconde, l’art de manier cette langue française tant aimée. Las, le bonimenteur a repéré bien vite en lui un « youpin », le lui a fait savoir et lui a enjoint de déguerpir. Ô nous frères humains est essentiellement le récit de cette épreuve fondatrice. Alain Timar, qui dirige le théâtre des Halles en Avignon, a fait appel à trois comédiens pour jouer ce texte, que l’on peut juger un peu trop « délayé » mais qui ne manque évidemment pas d’à-propos à l’heure où la France connaît des manifestations violentes de racisme : « Français » (dits « de souche ») contre « Arabes », « Arabes » contre Juifs et « Français », principalement.
Un texte contre le racisme, un récit, pas une pièce de théâtre. Un vieil homme se remémore un incident de son enfance au cours duquel il s’est découvert brutalement autre que celui qu’il croyait, un être susceptible de provoquer la haine et le mépris ; dans sa logique enfantine, il a conclu qu’il était sans doute méchant pour être maltraité ainsi, sinon lui du moins sa race. Cela se passait à Marseille, tout-à-fait au début du XXe siècle. Sa famille s’est installée depuis peu dans le midi de la France, un pays qu’il idéalise, qu’il idolâtre même s’il faut en croire son récit, au point d’installer sur une étagère de l’armoire de sa chambre une sorte d’autel couvert de reliques des gloires de la France telles qu’il peut les percevoir, à neuf ans, jusqu’à un sachet de terre des colonies acquis auprès d’un de ses camarades d’école, graine d’escroc ! Au retour de l’école, le petit Albert s’est arrêté pour écouter un camelot dont il admirait la faconde, l’art de manier cette langue française tant aimée. Las, le bonimenteur a repéré bien vite en lui un « youpin », le lui a fait savoir et lui a enjoint de déguerpir. Ô nous frères humains est essentiellement le récit de cette épreuve fondatrice. Alain Timar, qui dirige le théâtre des Halles en Avignon, a fait appel à trois comédiens pour jouer ce texte, que l’on peut juger un peu trop « délayé » mais qui ne manque évidemment pas d’à-propos à l’heure où la France connaît des manifestations violentes de racisme : « Français » (dits « de souche ») contre « Arabes », « Arabes » contre Juifs et « Français », principalement.
Cohen est un écrivain éminent. Belle du Seigneur fait partie des quelques très grands romans du XXe siècle en langue française. Dans Ô nous frères humains, il fait parler un enfant de neuf-dix ans, tout au moins pendant la plus grande partie du texte. Suivant la M.E.S. d’A. Timar il est représenté par trois comédiens d’âges différents. Le noir, Gilbert Laumor, est le plus âgé, le blanc, Paul Camus, est au milieu, enfin Issam Rachyd-Ahrad est un jeune acteur plein d’enthousiasme. On a admiré leur jeu, à commencer par celui de P. Camus. Par contre G. Laumor paraissait un peu en retrait lors de la soirée du 20 avril. Les mouvements d’ensemble sont particulièrement réussis, en particulier un intermède musical au cours duquel les comédiens jouent avec des chaises sans réussir à se poser quelque part, vivante illustration de la situation du jeune Albert qui ne sait plus, soudain, quelle est sa place dans la société. Le décor est constitué d’un simple paravent fleuri, à deux battants, ce qui permet de réduire ou d’augmenter l’espace scénique à volonté.
Le texte, on l’a dit, est écrit par un maître de la langue et la scène de l’humiliation est poignante. Donc on ne fera pas la fine bouche, même si A. Cohen se montre parfois trop prolixe. Le dynamisme de la mise en scène parvient, le plus souvent, à faire oublier les redondances.
On nous permettra néanmoins, pour finir, un peu de mauvais esprit. On sort « content » de ce spectacle, ce qui était sans nul doute l’objectif de tous ceux qui y ont contribué depuis l’auteur du texte jusqu’à celle qui a programmé la pièce en passant par les M.E.S. et les comédiens. De ce point de vue, il n’y a rien à faire sinon des compliments à tout le monde. Mais cela n’empêche pas de s’interroger sur le contenu du message. Car il y a une morale à la fin que l’on peut résumer ainsi : « Pardonnez leur [aux racistes] parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font ». S’il ne s’agit pas tout-à-fait de « tendre l’autre joue », on est bien loin du Dieu vengeur d’Israël ! Ainsi, sur ces vieux jours, lorsque l’auteur se remémore cet épisode fondateur de sa personnalité, penche-t-il vers l’indulgence. Sans nul doute, il se compare à ses persécuteurs de Marseille et ne peut, évidemment, que se juger supérieur. S’il ne le dit pas, il se voit tel qu’il est en réalité : un homme plus que gâté par la vie. L’intelligence brillante, le charme et les conquêtes féminines flatteuses, les amitiés choisies, les privilèges d’un fonctionnaire international : comment pourrait-il se plaindre ? Surtout quand il se compare aux « petites » gens qui l’ont humilié, enfant. Comment un homme tel que lui, s’il est un tant soit peu honnête, ne conclurait-il pas que ses persécuteurs étaient plus bêtes que méchants, bêtes parce qu’ils ne savaient pas, parce qu’ils n’avaient pas appris, parce qu’ils ne baignaient pas, eux, dans un milieu de privilégiés cosmopolites, etc. ?
Certes ! Sauf que cette généreuse compréhension de l’autre et de ses faiblesses nous entraîne sur la pente du relativisme moral. « Ils ne savaient pas, les pauvres » : c’est avec ce genre de raisonnement que des juges semblent se soucier souvent davantage du bien-être des coupables que de leurs victimes, de telle sorte que les coupables finissent par se croire innocents et que les victimes – pas toutes adeptes du relativisme moral – remâchent leur rancœur. A. Cohen déclare récuser la haine. Il serait en effet choquant qu’un homme comme lui, après avoir tant joui de la vie, conserve de la haine pour les « petites gens » qui s’attaquèrent à lui à l’âge où il était encore vulnérable. Cependant cette attitude n’est pas généralisable.
Fort-de-France, Théâtre municipal, du 20 au 22 avril 2017.
